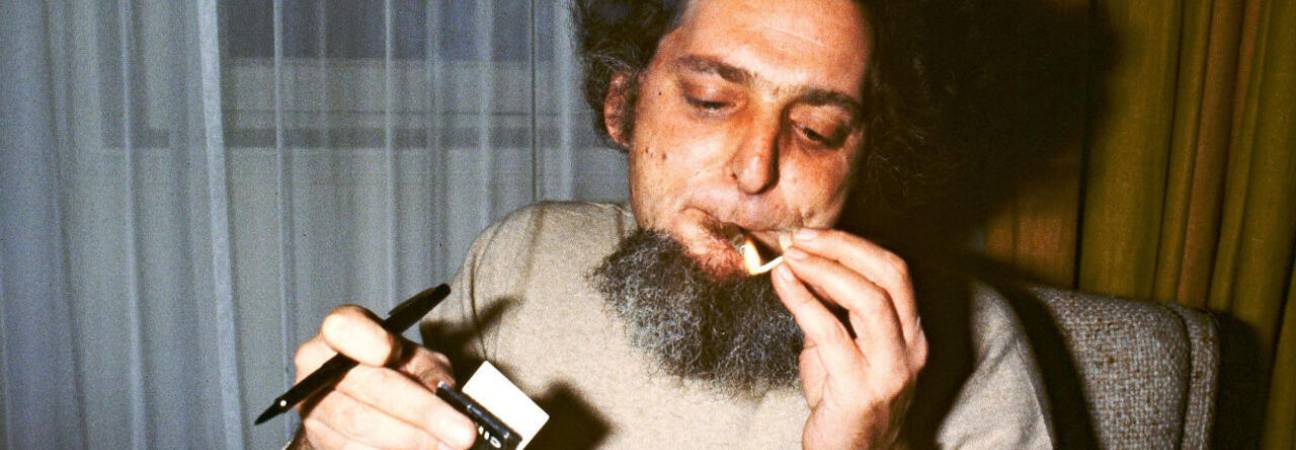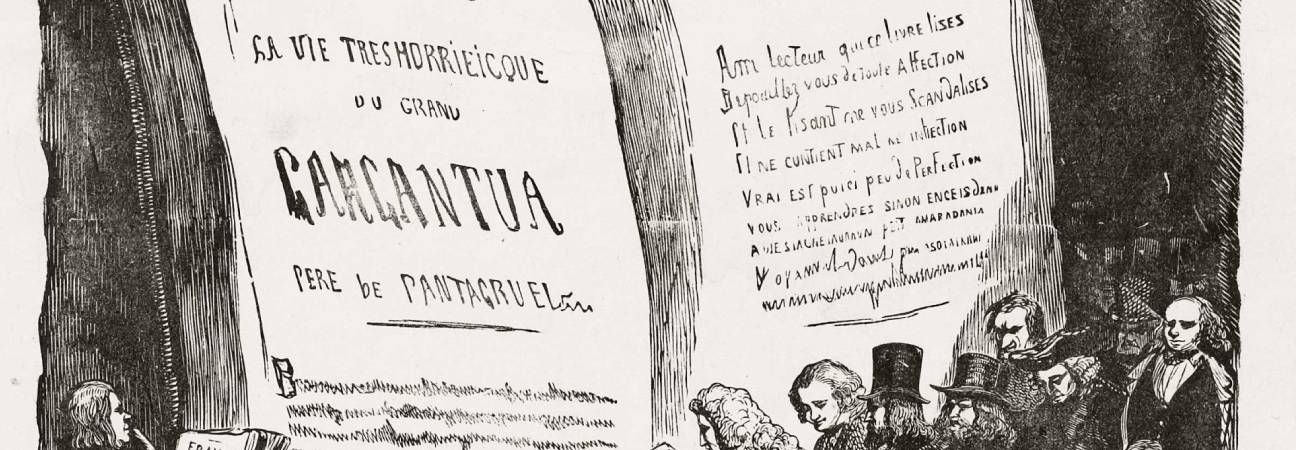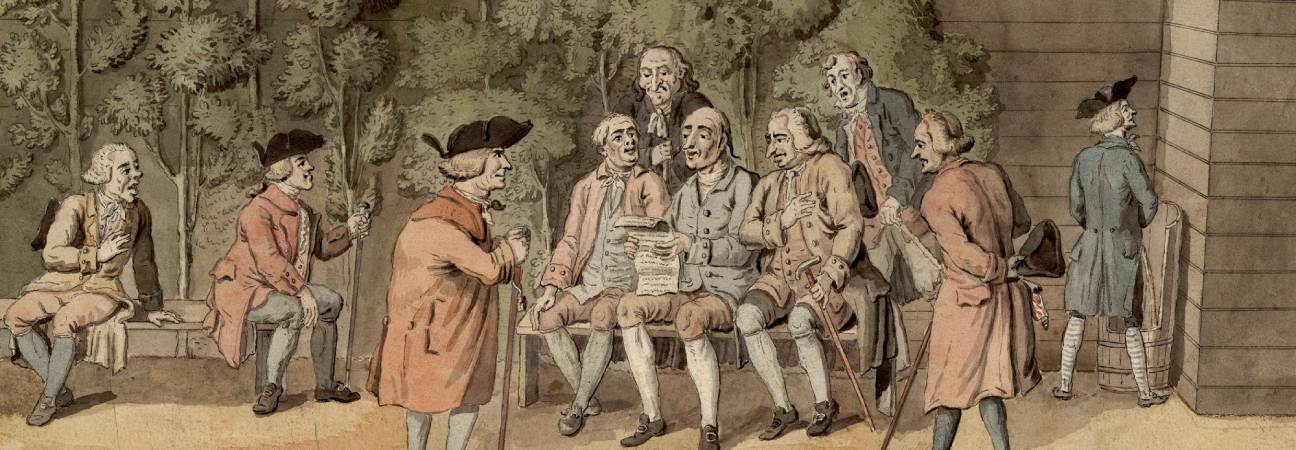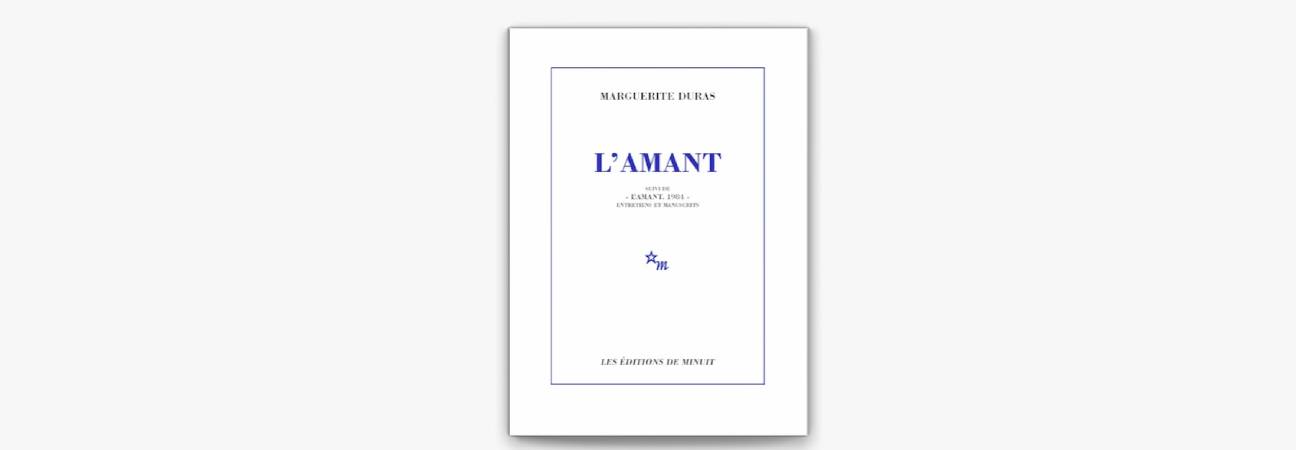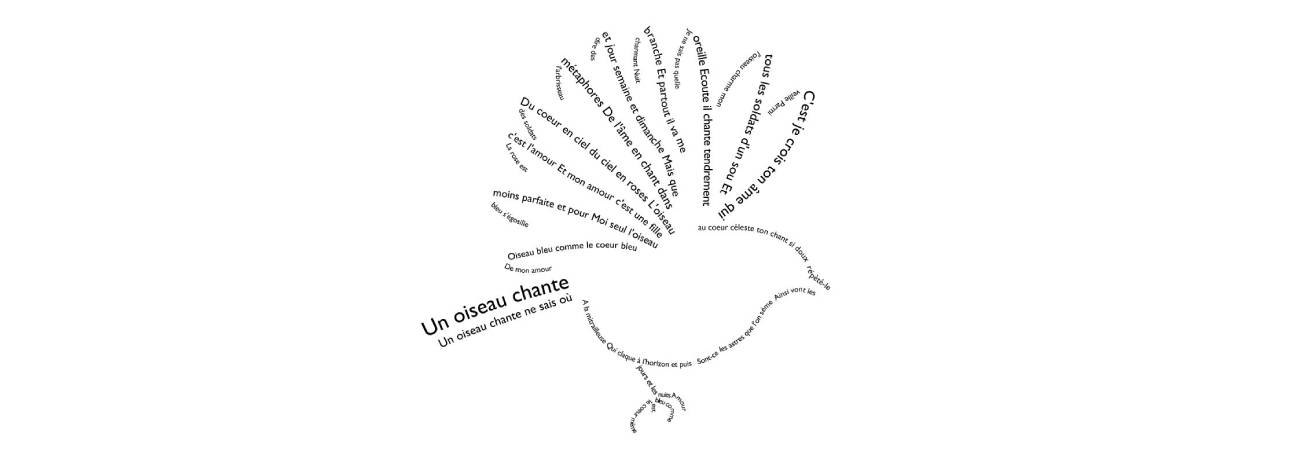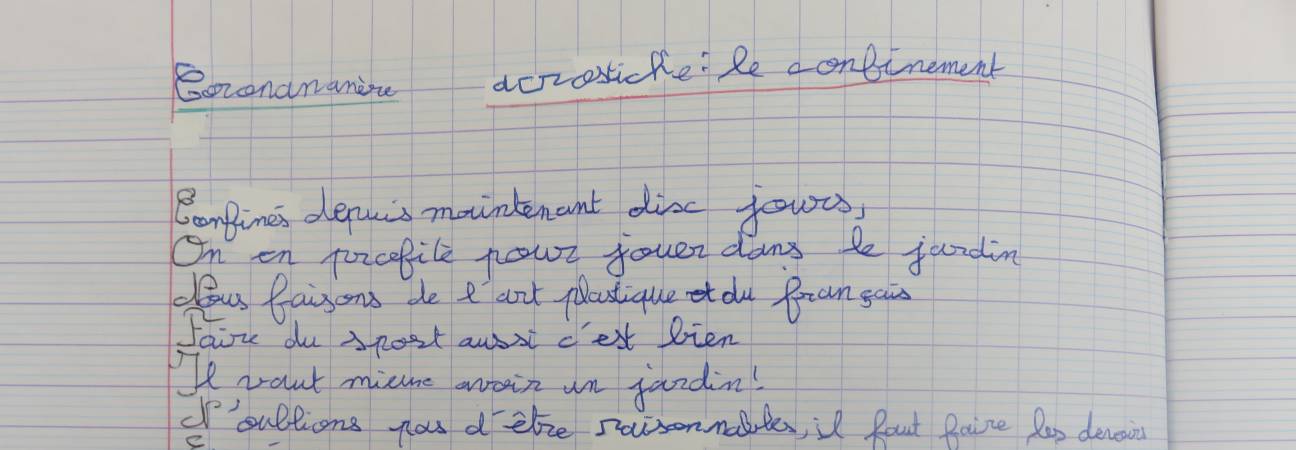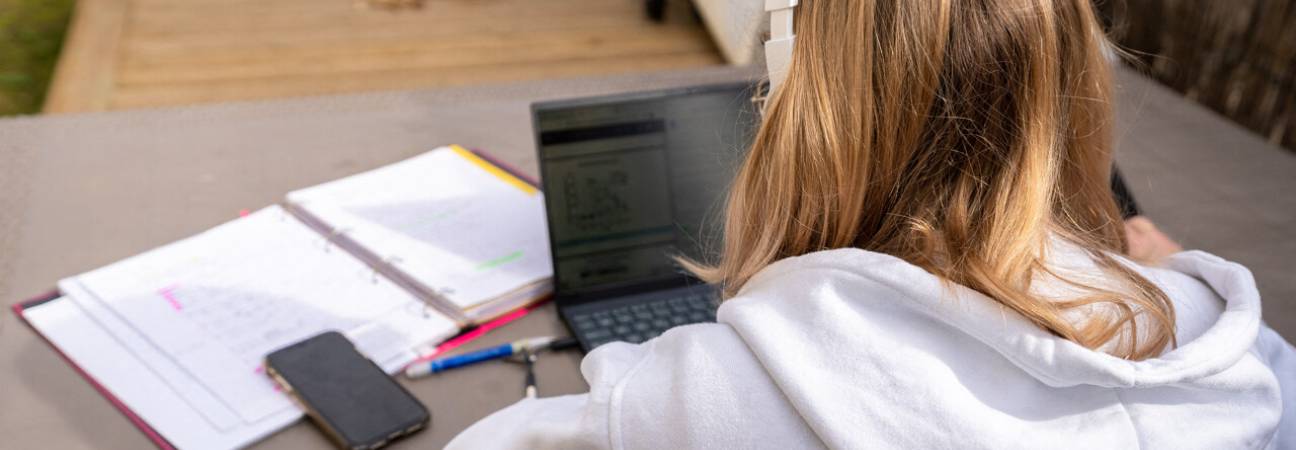Le terme est employé pour la première fois en 1957 par Émile Henriot, critique littéraire du journal Le Monde. À l’origine péjoratif, ce terme a été adopté par les écrivains du mouvement eux-mêmes.
Le contexte historique et littéraire
Le nouveau roman naît dans un contexte d’après-guerre marqué par la remise en question des valeurs humanistes. La littérature traditionnelle semble inadaptée à rendre compte du chaos du monde. Plusieurs influences marquent cette remise en cause :
- Les avant-gardes littéraires comme le surréalisme et le dadaïsme.
- Les écrivains étrangers : James Joyce, William Faulkner et Virginia Woolf, qui explorent de nouvelles techniques narratives.
- La psychanalyse, qui révèle la complexité de la conscience humaine.
Les grandes caractéristiques du nouveau roman
Un rejet du schéma narratif traditionnel
Le nouveau roman s’affranchit du schéma classique basé sur une intrigue bien définie avec un début, un développement et une fin. Les histoires sont souvent fragmentées, non linéaires et parfois sans résolution.
Une remise en question du personnage
Contrairement au roman classique qui développe des personnages psychologiquement construits, le nouveau roman les déconstruit. Les personnages sont souvent anonymes, désincarnés, réduits à des initiales ou des pronoms flous.
Une focalisation sur les objets
Plutôt que de se concentrer sur l’intériorité des personnages, le nouveau roman met en avant la description minutieuse des objets et de l’environnement. Cette approche crée une distance avec le lecteur et empêche toute identification émotionnelle forte.
Un point de vue narratif éclaté
- Abandon du narrateur omniscient : le narrateur ne sait pas tout et adopte souvent une focalisation interne ou multiple.
- Jeux sur la temporalité : les événements ne sont pas racontés dans l’ordre chronologique et les répétitions sont fréquentes.
- Utilisation du courant de conscience : technique qui retranscrit les pensées en flux continu, sans ordre apparent.
Les écrivains majeurs du nouveau roman
Nathalie Sarraute (1900-1999)
- Tropismes (1939) : analyse de micro-mouvements psychologiques.
- L’Ère du soupçon (1956) : essai qui définit les principes du nouveau roman.
Alain Robbe-Grillet (1922-2008)
- Les Gommes (1953) : intrigue déconstruite inspirée du polar.
- La Jalousie (1957) : narration subjective et observation minutieuse des détails.
Michel Butor (1926-2016)
- La Modification (1957) : roman écrit à la deuxième personne du pluriel, plongeant le lecteur dans l’esprit du personnage principal.
Claude Simon (1913-2005)
- La Route des Flandres (1960) : récit non linéaire inspiré de son expérience de la guerre.
Marguerite Duras (1914-1996)
- Moderato Cantabile (1958) et Le Ravissement de Lol V. Stein (1964) : romans où l’intrigue passe au second plan au profit d’une écriture minimaliste.
Un mouvement controversé
Le nouveau roman a suscité de nombreuses critiques. Ses détracteurs lui reprochent un manque d’émotion et une difficulté d’accès pour le lecteur. Certains y voient un exercice purement intellectuel, dépourvu de plaisir narratif. Cependant, ce mouvement a profondément influencé la littérature contemporaine et continue d’inspirer de nombreux écrivains.
L’héritage du nouveau roman
Si le mouvement s’essouffle dans les années 1970, ses innovations perdurent :
- Le renouvellement des structures narratives se retrouve chez des auteurs contemporains comme Jean Echenoz ou Patrick Modiano.
- L’expérimentation avec le langage et la perception continue d’influencer des écrivains et cinéastes.
Le nouveau roman a marqué un tournant décisif dans l’histoire de la littérature, en proposant une nouvelle approche de l’écriture et de la lecture. Il a élargi les possibilités narratives et a ouvert la voie à une littérature plus expérimentale et introspective.