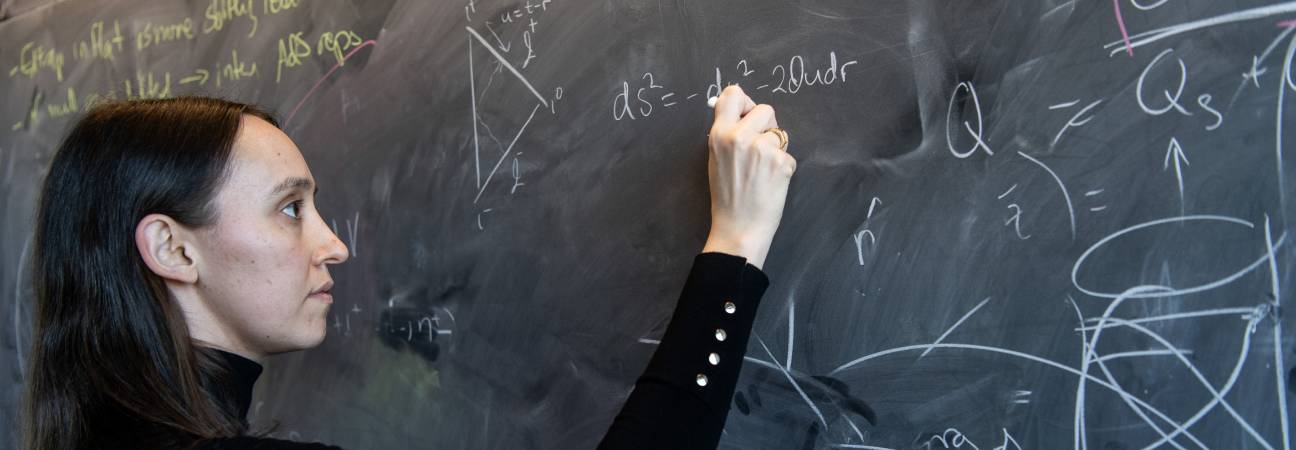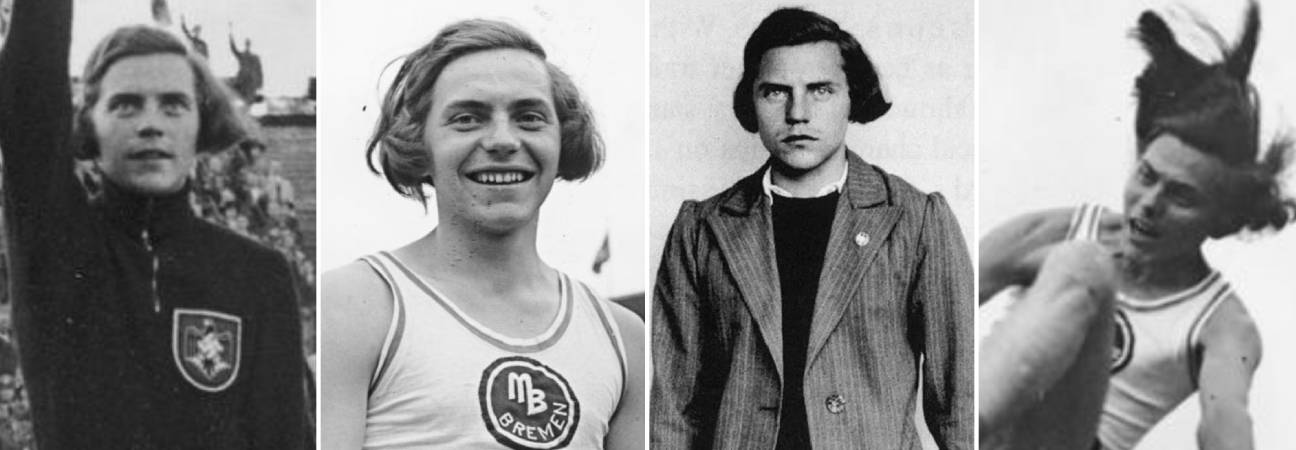Un enfant au cœur d’un foyer toxique
Edward Theodore Gein voit le jour le 27 août 1906 à La Crosse, Wisconsin. Il grandit avec un frère aîné, Henry, dans une famille dominée par une mère autoritaire, Augusta, et un père alcoolique, George. Augusta enseigne à ses fils que le monde est perverti, que les femmes (sauf elle) sont impures, et que le désir est un chemin vers l’enfer.
Isolement et discipline religieuse
Augusta isole ses fils du monde extérieur. Elle supervise leurs fréquentations, réprime toute envie d’indépendance. Ed est particulièrement dépendant d’elle, la voyant comme une figure salvatrice dans un univers hostile. Henry, lui, tente de se libérer de l’emprise maternelle.
La ferme de Plainfield : un décor propice à la dérive
Vers 1914, la famille emménage sur une ferme de Plainfield, Wisconsin, isolée dans la campagne. Ed quitte l’école vers l’âge de 13 ans, officiellement pour aider aux travaux, mais aussi parce que sa mère ne tolère pas ses « distractions sociales ». Il n’a quasiment pas d’amis, connaît le mépris de ses camarades, et développe sans doute des troubles psychiques en silence.
Des tragédies familiales qui fracturent
Plusieurs événements vont bouleverser la structure fragile de la famille Gein.
La mort du père (1940)
George meurent le 1ᵉʳ avril 1940 d’une insuffisance cardiaque, aggravée par l’alcoolisme. Sa disparition enlève à Ed le peu d’équilibre que représentait son père. Après cela, Augusta domine totalement le foyer.
La mort mystérieuse d’Henry (1944)
Le 16 mai 1944, un incendie de végétation se déclenche sur la propriété. Henry part avec d’autres pour aider à éteindre. Le soir, on ne le retrouve pas. Son corps est retrouvé face contre terre, sans trace de brûlure. Le rapport officiel évoque une crise cardiaque, mais certains remarquent des ecchymoses sur le crâne, insinuant une éventuelle violence. Aucun procès n’est jamais engagé contre Ed, faute de preuves.
La mort d’Augusta (1945)
Le 29 décembre 1945, Augusta décède suite à un AVC ou une détérioration de santé. Cette mort laisse Ed seul, désemparé. Il entre dans une période d’obsession morbide vis-à-vis de la figure maternelle. Beaucoup voient dans cet événement le point de bascule de sa psyché.
La chambre maternelle, sanctuaire immuable
Après la mort d’Augusta, Ed barricade les pièces qu’elle utilisait, laissant intacte la salle où elle vivait. Il ne la touche pas. Le reste de la maison se délite. Cette séparation physique illustre la scission intérieure de Gein entre souvenir sacré et descente dans l’impensable.
Du cimetière à l’horreur domestique

Avec le temps, Ed développe des pulsions de profanation de tombes, mêlées à des fantasmes de reconstitution de sa mère. Ses actes basculent dans le monstrueux.
Les exhumations nocturnes
Dans les nuits, Gein fouille les cimetières alentours. Il extrait des corps de femmes récemment enterrées, transporte les dépouilles jusqu’à sa ferme, puis les découpe. Il nie avoir combattu la chair, évoquant des odeurs trop fortes. Il se sert des « échantillons » : peau en abat-jours, crânes en bols, objets divers d’ameublement macabre.
Les homicides : Mary Hogan et Bernice Worden
Gein est formellement lié à deux meurtres :
- Mary Hogan : aubergiste disparue en 1954, jamais retrouvée. Ed admet avoir tué et mutilé son corps, affirmant cependant qu’il ne s’agissait pas de chair vivante mais de désarticulation post-mortem.
- Bernice Worden : le 16 novembre 1957, cette propriétaire de quincaillerie disparaît. Le matin, son magasin est ouvert, de la sang est vu au sol, la caisse est ouverte. Son fils, Frank Worden, soupçonne Gein car celui-ci était venu la veille pour acheter un galon d’antigel. Le reçu correspond. Lorsque la police fouille la ferme de Gein, la scène s’avère cauchemardesque : le corps de Bernice est pendu par les pieds dans le hangar, décapité, le torse ouvert. Dans la maison, des fragments humains, des objets fabriqués en peau, des crânes embellis sont retrouvés.
Totalement bouleversé, le monde judiciaire s’intéresse enfin à Gein. Mais la complexité de sa folie va rendre le procès énigmatique.
Procès, internement, questions de responsabilité
La trajectoire judiciaire d’Ed Gein fut chaotique : crime, folie, compétence à être jugé, verdicts contradictoires.
Accusations et internement (1957)
Le 22 novembre 1957, Gein est officiellement inculpé pour les meurtres de Worden et de Hogan. Il est immédiatement interné à l’hôpital psychiatrique de Waupun, car jugé mentalement aliéné. Les autorités acceptent d’ouvrir deux tombes (dont on espère retrouver des restes), mais elles sont vides. Le diagnostic initial déclare qu’il n’était pas sain d’esprit au moment des faits.
Débat sur la capacité à être jugé (1968)
Onze ans passent. En 1968, les experts réévaluent Gein et le jugent désormais apte à comparaître. Le procès se déroule rapidement : il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Pourtant, lors d’un troisième jugement, on le déclare non coupable en raison de sa folie légale, et il n’est jamais condamné à de la prison. Il est transféré dans des hôpitaux psychiatriques criminels, diagnostiqué schizophrène.
Une vie entre murs hospitaliers
Ed passe des années dans l’hôpital de Waupun, puis est transféré en 1978 au Mendota Mental Health Institute, à Madison. Il y décède le 26 juillet 1984, à l’âge de 77 ans, des suites d’un cancer de l’intestin et d’une insuffisance respiratoire. Son corps est inhumé à Plainfield, aux côtés de sa famille.
Les mystères non résolus
Plusieurs zones d’ombre subsistent :
- Le rôle exact d’Ed dans la mort de son frère Henry demeure non prouvé et controversé.
- Le nombre total de victimes : il avoue avoir profané une quinzaine de tombes, mais seuls deux meurtres sont retenus officiellement.
- Le cannibalisme n’est pas confirmé : Gein nie avoir mangé les cadavres, évoquant leur odeur insupportable.
La postérité terrifiante d’un nom

Au-delà de l’horreur, l’histoire d’Ed Gein a paradoxalement trouvé une existence durable dans la culture populaire.
Inspirateur de monstres fictifs
Gein est souvent nommé comme matrice d’icônes de l’horreur :
- Norman Bates (Psychose, 1960) : le complexe oedipien et la figure maternelle dominatrice.
- Leatherface (Massacre à la tronçonneuse, 1974) : masque en peau, violence abjecte.
- Buffalo Bill (Le Silence des agneaux, 1991) : fabrication d’un costume féminin à partir de peau.
Son influence s’étend bien au-delà du cinéma : littérature, séries true-crime, documentaires évoquent souvent son nom.
L’objet de fascination morbide
La pierre tombale d’Ed est souvent vandalisée, puis volée et placée dans un musée du comté de Waushara. Sa maison et sa voiture sont à leur tour devenues curiosités macabres.
Nouvelles représentations : « Monster : l’histoire d’Ed Gein »
En octobre 2025, la série Monster : l’histoire d’Ed Gein débarque sur Netflix. Elle retrace son enfance, sa relation avec sa mère, sa descente dans la folie. La série suscite des débats : dramatiser une tragédie réelle, est-ce acceptable ?
Pourquoi son nom fascine autant ?
Comment un homme reclus et silencieux est-il devenu le saint patron de tout l’horreur pop ? Trois clés pour comprendre :
La frontière entre réel et fiction
Ed Gein est d’abord un personnage vrai, effrayant parce qu’il n’est pas fictif. Les récits tirés de ses actes flirtent avec le romanesque — mais toujours à la limite de l’acceptable. Cette ambiguïté nourrissait déjà les journaux d’époque.
Un cas d’étude en psychopathie
Les psychiatres ont exploré sa psychose, sa schizophrénie, ses hallucinations, ses fixations. Gein est devenu une figure d’étude dans la criminologie.
L’image du monstre domestique
Ce n’est pas le criminel de la ruelle, mais l’homme ordinaire avec un visage banal. Il habitait une ferme, bricolait, semblait inoffensif — jusqu’au moment où l’horreur s’est révélée. Cette proximité rend le bouleversement d’autant plus fort.
Quelques mises en garde pour bien voir l’histoire
Pour éviter les simplifications ou les mythes trop forts :
- Ne pas confondre confession et preuve irréfutable : Gein a avoué des actes macabres, mais tous ne sont pas vérifiés.
- La folie juridique ne justifie ni n’explique tout : Gein a été jugé irresponsable au regard de la loi, mais cela ne neutralise pas le poids des actes.
- La fascination pour le macabre peut glisser vers le voyeurisme : rappeler que chaque objet, chaque victime, chaque nom cache une douleur. Toujours garder l’humain derrière l’horreur.
Un nom pour toujours dans l’imaginaire collectif
Ed Gein n’est pas une légende, il a existé — mais ses actes dépassent ce que beaucoup d’esprits peuvent supporter. Sa trajectoire, de fils à maman brimé à praticien d’abominations, interroge nos obsessions, nos peurs, nos récits sur la folie.
Il a inspiré des monstres de fiction, il alimente encore les débats sur la responsabilité, la représentation de la violence, l’éthique du crime raconté. Étudier Ed Gein, ce n’est pas se complaire dans l’horreur mais tenter de comprendre comment l’ombre peut surgir dans des vies presque ordinaires.