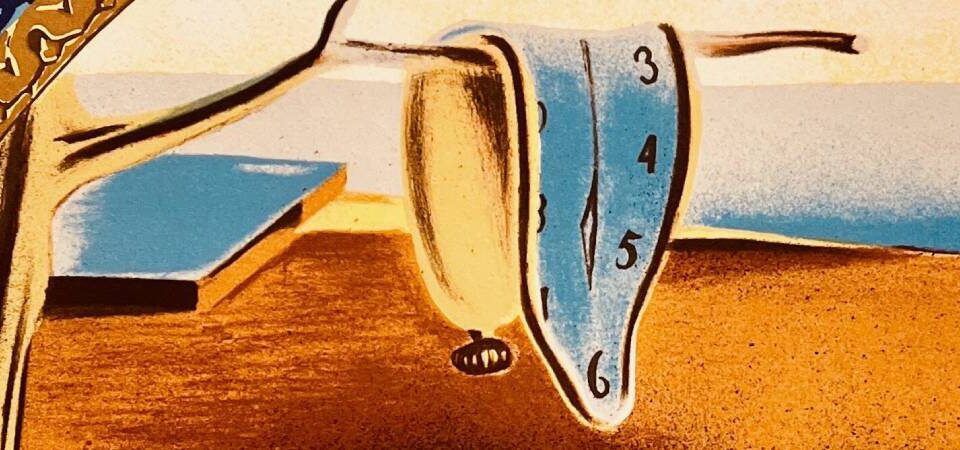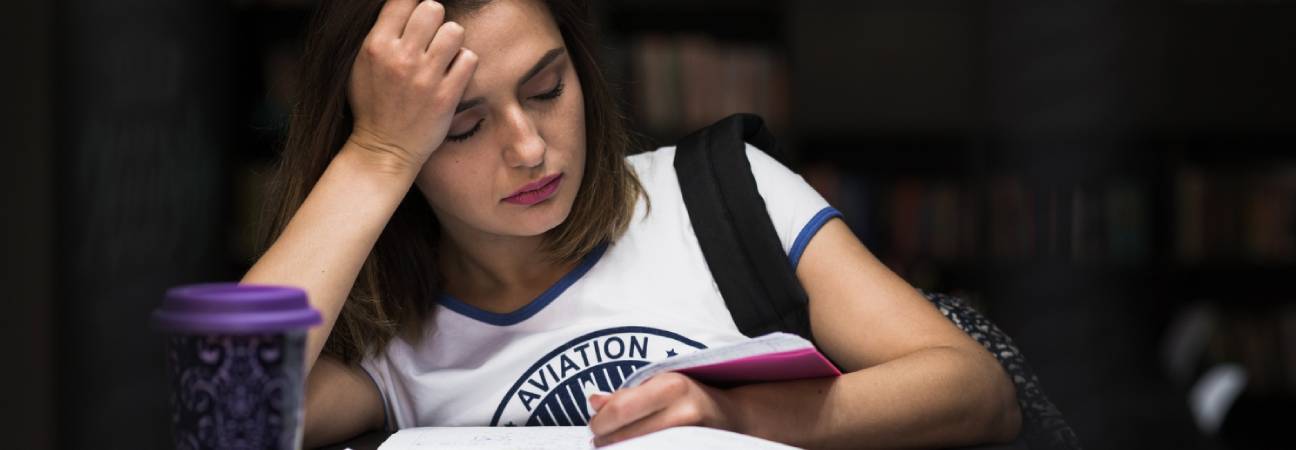La base à connaître
- Titre : La Persistance de la mémoire (dit « les montres molles »)
- Artiste : Salvador Dalí (1904–1989)
- Date : 1931 (période surréaliste)
- Technique / format : huile sur toile, 24 × 33 cm
- Lieu : Museum of Modern Art (MoMA), New York
- Sujet : des montres à gousset molles, un paysage de Portlligat, un arbre mort, des fourmis, une forme organique somnolente.
Ce que l’image met en scène
Un décor simple, des signes qui claquent
Premier plan : quatre montres – l’une retournée et grignotée par des fourmis, deux « fondues » (sur une branche et sur un parallélépipède), la dernière affalée sur une forme molle semblable à un profil endormi. Fond : mer calme, falaises ocres de Catalogne, lumière froide. Zéro personnage debout : le temps, seul, occupe la scène.
Pourquoi « molles » ? La relativité vue depuis la table
Dalí raconte avoir eu l’idée en voyant un fromage coulant au dîner. L’image de l’objet mou contaminerait alors l’objet dur par excellence — la montre. Le temps qui s’écoule devient perception : élastique, subjectif, vécu. L’écho à la physique (relativité, temps non absolu) reste poétique ici : Dalí peint la sensation avant la théorie.
« Le surréalisme, c’est moi. » — Salvador Dalí
Lire les symboles sans se perdre
Le temps : mesure technique vs. expérience vécue
- Montres molles : la mesure (raison, cadran) se dissout dans l’expérience (émotion, rêve). La montre « fatigue ». L’heure s’affaisse.
- Montre nette + fourmis : la seule montre « rigide » est attaquée. Corrosion du temps, putréfaction du vivant. Même le dur cède.
- Mouche (sur une montre) : l’instant fugitif. Le temps s’envole, littéralement.
Vie / mort : un montage choc et limpide
- Arbre mort : support précaire du temps — il plie, il casse.
- Forme organique endormie (au centre) : autoportrait-larvaire, fœtus qui rêve ; la vie comme potentiel, pas encore debout.
- Paysage réel de Portlligat : la mémoire sauve et cadre la scène. Au loin, la vie « persiste ».
Mou vs. dur : la grammaire dalinienne
Dalí aime opposer formes molles (instable, désir, rêve) et formes dures (structure, loi, logique). Ici, le mou gagne : le temps « dur » devient pâte molle. Ce renversement est tout l’effet de la méthode paranoïaque-critique de Dalí : laisser venir des images hallucinées, puis les organiser avec précision picturale.
Pourquoi le titre parle de « persistance »
Contraste volontaire : alors que le temps se déforme, c’est la mémoire qui tient. Le paysage de Catalogne (Portlligat) est un souvenir solide. La mémoire résiste à la fuite : elle fixe des images, elle ancre la vie. Les montres échouent à dompter le temps ; la mémoire persiste à le rendre habitable.
Contextes utiles pour la copie
Un tableau surréaliste, pas « justifié » par Freud
Dalí fait partie du surréalisme, mais s’en distingue : il ne peint pas l’inconscient « brut ». Il orchestre des visions avec une virtuosité classique. Son réalisme minutieux (ombres, matières, perspectives) crédibilise l’impossible. C’est ce réalisme qui rend les montres molles si troublantes.
Un paysage-biographie
La mer lisse, les falaises, la lumière : la Catalogne de Dalí n’est pas décorative, c’est un lieu de mémoire. Le fond « réel » stabilise l’avant-scène onirique. Le tableau tient sur cet alliance : réel fiable + rêve instable.
Résonances historiques
Peinte en 1931, l’œuvre émerge dans une Europe inquiète. L’arbre mort, les matières qui se délitent, l’angoisse du temps qui emporte : on peut y lire un climat d’époque (crises, mutations), sans réduire le tableau à un message politique.
Révision prépa : comment l’utiliser intelligemment
Cas d’école : sujet « Temps », « Mémoire », « Vivre / exister »
- Idée-phare : la mesure du temps (chronos) n’épuise pas l’expérience du temps (kairos). Les montres molles figurent l’écart entre l’horloge et la vie.
- Transition : « Si la technique prétend fixer l’instant, seule la mémoire le sauve. »
- Ouvertures : Proust (mémoire involontaire), Bergson (durée), Lamartine (Le Lac), Nietzsche (éternel retour), Ricoeur (mémoire/oubli), et bien sûr Dalí La Désintégration de la persistance de la mémoire (1952–54) pour montrer l’évolution du motif.
À dire à l’oral (khôlle) en 60–90 secondes
« La Persistance de la mémoire (1931) de Dalí met en scène des montres molles dans un paysage réel de Catalogne. Les montres, symbole de la mesure, deviennent pâte : le temps vécu déforme le temps des horloges. Fourmis et mouche disent la fugacité et la putréfaction. Pourtant, le titre insiste sur la mémoire, qui seule persiste et nous relie à un monde stable. Dalí oppose le dur au mou et, par sa méthode paranoïaque-critique, fixe l’instable avec un réalisme minutieux. »
Détails de lecture qui font la différence
Les trois « supports » du temps
Arbre mort, parallélépipède, forme organique : trois manières de « porter » le temps. On peut y voir passé (bois mort), présent (bloc concret), futur (organique en formation). Le tableau décale la chronologie en co-présence : tout est là en même temps.
Silence, immobilité, mer lisse
La mer paraît immobile. Le temps s’arrête pour mieux montrer qu’il fuit. Contradiction féconde : c’est l’immobilité qui révèle l’angoisse du mouvement.
Une technique hyper-lisible
Couleurs limpides, contours nets, ombres justes : la part « classique » de Dalí n’est pas un caprice. Elle légitime l’irrationnel. Plus c’est net, plus le rêve prend.
Citations utiles (à placer avec parcimonie)
« La mémoire, c’est l’avenir du passé. » — Paul Valéry
« Nous sentons bien qu’une heure n’est pas toujours une heure. » — Marcel Proust
Mini-lexique express
- Surréalisme : libérer l’imaginaire (rêve, hasard objectif) par des images inattendues.
- Méthode paranoïaque-critique : produire des visions « délirantes » puis les structurer avec une précision rationnelle.
- Dur/mou : opposition pilier chez Dalí, qui questionne la stabilité des choses et de nos repères.
Pour aller plus loin sans s’éparpiller
Œuvres-sœurs à citer vite
- La Désintégration de la persistance de la mémoire (1952–54) : fragmentation de l’espace ; la mémoire du spectateur « recolle » les morceaux.
- Le Grand Masturbateur (1929) : autoportrait transformé ; le motif du profil revient.
Connecteurs philosophiques (1 phrase chacun)
- Bergson : la durée est qualitative, elle ne se laisse pas réduire à la montre.
- Proust : la mémoire involontaire triomphe du temps qui fuit.
- Nietzsche : penser un temps qui revient change notre rapport au présent.
Résumé « prêt à caser »
Dans Les montres molles, Dalí montre que le temps mesuré n’est pas le temps vécu : les horloges fondent, la mémoire persiste. En mêlant précision classique et vision surréaliste, il donne une image simple et puissante d’un problème philosophique : comment habiter le temps qui passe ? Réponse dalinienne : par la mémoire, qui fixe l’éphémère sans le figer.