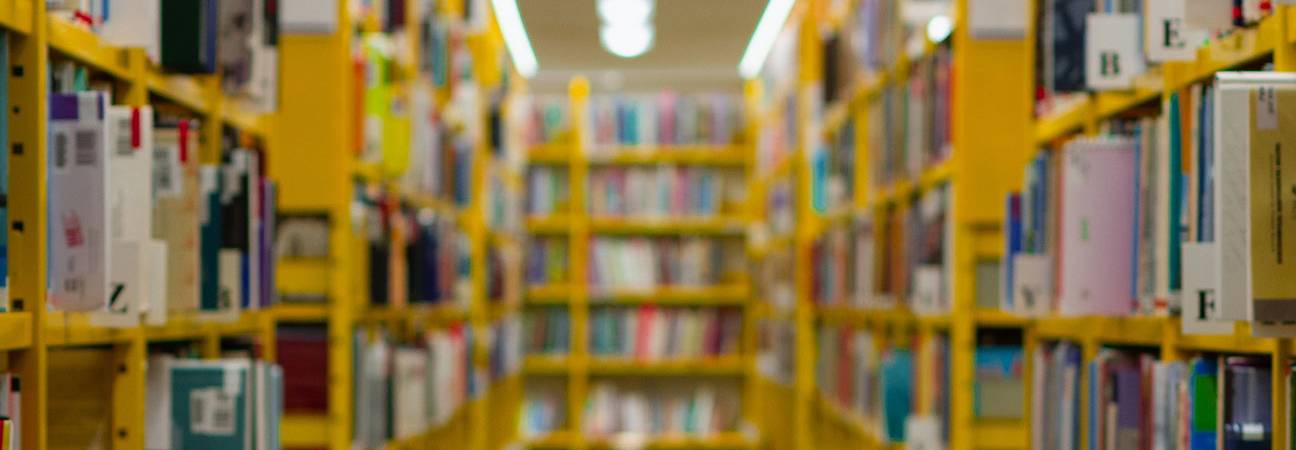Comprendre ce que sont les inégalités économiques
Les inégalités économiques se manifestent par des écarts de revenus, de patrimoine ou d’accès aux ressources entre individus ou groupes sociaux. Elles renvoient à des différences qui peuvent favoriser certains et en défavoriser d’autres de façon durable. Ces inégalités ne sont pas seulement chiffrables, elles ont un impact direct sur la vie quotidienne : logement, santé, éducation, mobilité sociale…
Elles posent donc une vraie question : faut-il les réduire au maximum, ou bien en tolérer une partie au nom de l’efficacité ?
Les arguments en faveur d’une certaine tolérance
Des inégalités qui peuvent stimuler l’économie
Certaines théories considèrent les inégalités comme un moteur de l’innovation et de la croissance. Quand une société récompense mieux ceux qui prennent des risques, qui innovent ou qui investissent, elle pousse les individus à entreprendre. C’est l’idée qu’on retrouve chez Hayek ou dans les débats autour du ruissellement : si les plus riches investissent et consomment plus, alors toute la société pourrait en bénéficier indirectement.
On peut aussi penser que certains biens et services n’auraient jamais vu le jour sans une clientèle fortunée prête à les payer très cher au départ. Ces produits finissent parfois par se démocratiser, et deviennent accessibles à une plus large partie de la population.
L’utilitarisme et la recherche du plus grand bien
Dans la pensée utilitariste, une politique est juste si elle maximise le bonheur total de la société. Si certaines inégalités permettent à l’ensemble de la population de mieux vivre, alors elles peuvent être acceptables.
Prenons un exemple : si une redistribution trop forte nuit à la croissance, et donc à l’emploi, alors même ceux qu’on veut aider pourraient en souffrir. Ce raisonnement met l’accent sur l’efficacité globale, même si tous n’en bénéficient pas de la même manière.
Les limites d’une trop grande tolérance aux inégalités
Des inégalités qui nuisent à la cohésion sociale
Quand les écarts deviennent trop importants, la société se fragmente. Les plus pauvres peuvent perdre confiance dans le système, se sentir exclu.e.s ou impuissant.e.s, et la méfiance augmente entre les classes sociales. L’écart trop grand entre les rêves qu’on projette et les réalités qu’on vit peut nourrir de la colère sociale, voire de l’instabilité politique.
De plus, l’accès à certains droits fondamentaux comme la santé ou l’éducation peut être compromis si les inégalités économiques ne sont pas régularisées. Les individus naissent alors avec des chances de réussir très inégales, ce qui remet en question la mérite et l’égalité des chances.
Une menace pour la croissance elle-même
Contrairement à la vision libérale classique, certains économistes comme Stiglitz montrent que trop d’inégalités peuvent freiner la croissance. Pourquoi ? Parce que lorsqu’une partie de la population n’a pas accès à l’éducation ou à la formation, son potentiel reste inutilisé. Cela bloque la mobilité sociale et réduit la capacité globale du pays à innover et à s’adapter.
D’autres études, menées par l’OCDE ou le FMI, confirment que l’écart de revenus excessif diminue les perspectives économiques sur le long terme. Là où les inégalités sont très fortes, les investissements chutent, la consommation ralentit et les tensions sociales augmentent.
L’approche par les capabilités : l’égalité des possibles
Pour l’économiste Amartya Sen, l’important n’est pas seulement ce que les gens possèdent, mais ce qu’ils peuvent faire. Il appelle cela les capabilités : les libertés réelles qu’a chacun de mener la vie qu’il souhaite. Dans cette vision, même si deux personnes ont le même revenu, elles ne sont pas égales si l’une est discriminée ou empêchée de faire certains choix.
Cela signifie qu’il ne suffit pas d’égaliser les ressources, il faut aussi travailler sur les conditions d’accès aux opportunités : écoles de qualité, système de santé efficace, logement digne, etc.
Les inégalités tolérables et les autres
Accepter certaines différences
Tolérer les inégalités ne veut pas dire tout accepter. Une différence de rémunération entre deux individus peut être justifiée par la compétence, l’effort, ou la responsabilité. Ce sont des inégalités méritocratiques, qui peuvent être perçues comme légitimes.
Le problème survient quand l’écart se creuse sans raison valable, ou qu’il empêche certains de vivre dignement. Une société juste devrait donc chercher un équilibre entre récompense de l’effort et solidarité collective.
L’importance des politiques publiques
C’est là que les politiques de redistribution prennent tout leur sens. Par l’impôt, les aides sociales, l’accès gratuit à certains services, l’État peut réduire les inégalités sans pour autant supprimer toutes les différences. Il ne s’agit pas de niveler par le bas, mais de garantir un socle de droits communs.
La question de la tolérance des inégalités ne trouve pas une seule réponse. Tout dépend du niveau atteint, des conséquences sociales et économiques, et du degré de justice que la société veut mettre en avant. Mais une chose est claire : les inégalités deviennent problématiques dès lors qu’elles bloquent les parcours, freinent les talents et abîment la confiance collective.