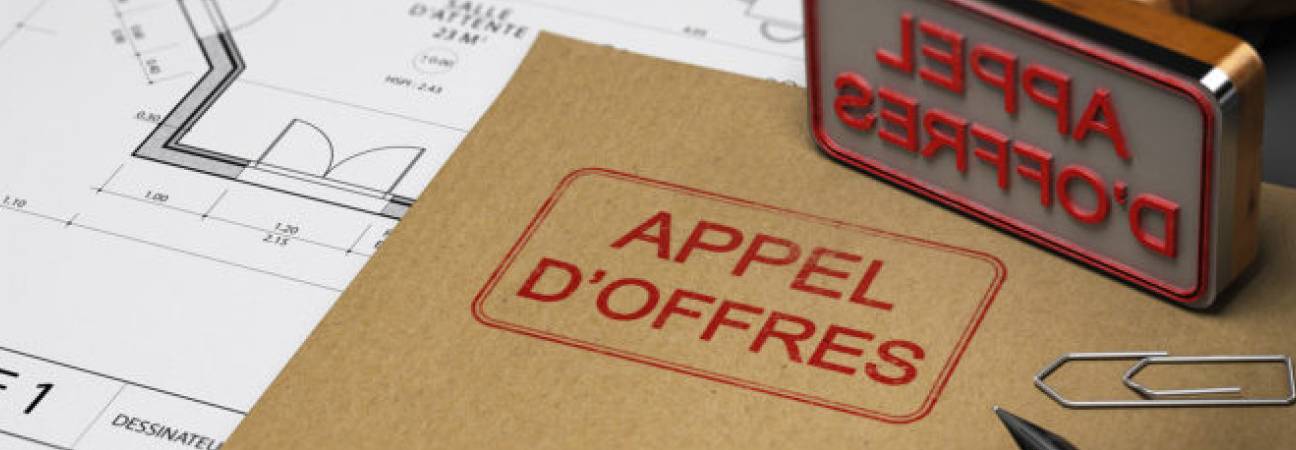Qu’est-ce que la politique de concurrence ?
La politique de concurrence regroupe toutes les mesures et réglementations destinées à garantir une concurrence libre et équitable sur les marchés économiques. Elle vise à contrôler les pratiques commerciales des entreprises afin d’assurer un bon fonctionnement du marché, protéger les consommateurs et favoriser l’innovation.
En Europe, cette politique relève principalement des institutions européennes depuis le Traité de Rome en 1957, et elle est mise en œuvre au niveau national par des organismes spécialisés comme l’Autorité de la concurrence en France.
Pourquoi une politique de concurrence est-elle nécessaire ?
Favoriser l’efficacité économique
L’objectif principal de la politique de concurrence est d’assurer l’efficacité économique à travers plusieurs dimensions essentielles :
- Efficience productive : les entreprises sont poussées à utiliser leurs ressources de manière optimale pour réduire leurs coûts et rester compétitives.
- Efficience allocative : elle garantit que les ressources économiques sont utilisées là où elles sont le plus nécessaires, répondant ainsi mieux aux besoins des consommateurs.
- Efficience dynamique : une concurrence saine pousse les entreprises à innover constamment pour gagner ou conserver des parts de marché.
Protéger les consommateurs
En régulant la concurrence, cette politique permet de protéger les intérêts des consommateurs, en assurant :
- Des prix plus compétitifs et abordables.
- Une variété plus large de produits et de services disponibles.
- Une amélioration continue de la qualité des biens et services.
Les outils principaux de la politique de concurrence
La lutte contre les cartels
Un cartel désigne une entente illégale entre plusieurs entreprises pour contrôler un marché, fixer les prix ou encore se répartir les clients. Ces pratiques sont interdites car elles limitent la concurrence et provoquent des hausses artificielles des prix.
En Europe, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) interdit explicitement les cartels. Un exemple célèbre est celui des fabricants de lessives en France, sanctionnés en 2011 pour avoir manipulé ensemble les prix.
Contrôle des concentrations et abus de position dominante
La politique de concurrence surveille également les opérations de concentration d’entreprises. Lorsqu’une entreprise prend une trop grande part du marché, elle risque de se trouver en position dominante, susceptible d’entraîner des abus comme :
- La fixation de prix très bas (prix prédateurs) pour éliminer la concurrence.
- Des clauses commerciales restrictives, comme des exclusivités.
- La vente forcée ou liée de plusieurs produits ou services.
Le contrôle préventif des fusions d’entreprises permet d’éviter ces abus en maintenant un équilibre sur le marché.
Encadrement des aides publiques
Les aides publiques sont des soutiens financiers apportés par les gouvernements aux entreprises. La politique européenne limite ces aides pour éviter des distorsions de concurrence entre les entreprises des différents pays membres de l’Union européenne. Les aides sont tolérées uniquement dans des cas précis, comme le soutien à l’innovation technologique, la protection de l’environnement ou le soutien à des régions économiquement fragiles.
Les débats autour de la politique de concurrence
Concurrence et politique industrielle
Il existe des tensions entre la politique de concurrence et les objectifs de la politique industrielle, qui vise à soutenir des entreprises nationales ou européennes capables d’être compétitives à l’échelle mondiale. Certaines critiques soulignent que la politique de concurrence, en interdisant les aides ou certaines concentrations, empêche l’émergence de « champions nationaux » nécessaires face à la concurrence internationale.
Historiquement, certains pays comme la Corée du Sud ont développé leur industrie grâce à des politiques protectionnistes et des aides massives à certaines entreprises, ce qui contraste fortement avec les règles strictes de concurrence appliquées aujourd’hui dans l’Union Européenne.
Concurrence et services publics
Un autre débat important concerne la libéralisation des services publics tels que l’énergie, les télécommunications ou les transports. Historiquement monopoles publics, ces secteurs ont progressivement été ouverts à la concurrence, ce qui suscite parfois des inquiétudes quant à la qualité et à l’accessibilité des services.
En effet, la mise en concurrence peut menacer l’accès universel à ces services essentiels, surtout dans les régions rurales ou isolées, moins rentables pour les entreprises privées. Cela remet en question le principe de péréquation tarifaire, qui garantit un tarif unique pour tous les consommateurs indépendamment du coût réel de la fourniture du service.
Un exemple concret est celui de La Poste en France, devenue une société anonyme en 2010 pour répondre aux exigences européennes de libéralisation. Malgré des efforts d’innovation et d’amélioration du service, cette transformation a entraîné des fermetures d’agences dans certaines régions rurales et une augmentation générale des tarifs.
Le paradoxe de la concurrence : la théorie des marchés contestables
L’économiste William Baumol introduit le concept de marché contestable, où la libre entrée et sortie des entreprises sur un marché garantit une concurrence efficace, même si une seule entreprise domine temporairement le marché. Selon cette théorie, la simple menace de l’arrivée d’un concurrent suffit à maintenir les prix bas et à encourager l’innovation.
Cette approche permet d’ajuster la politique de concurrence en acceptant des situations temporaires de monopole, à condition que le marché reste ouvert à la concurrence potentielle.
Conclusion sur les enjeux actuels
Aujourd’hui, la politique de concurrence demeure essentielle pour assurer un marché efficace et protéger les consommateurs, mais elle doit aussi évoluer pour mieux prendre en compte les réalités économiques globales et locales, notamment dans les secteurs stratégiques et les services publics. Trouver un équilibre entre concurrence et politique industrielle ou sociale reste ainsi un défi majeur pour l’avenir économique européen et national.