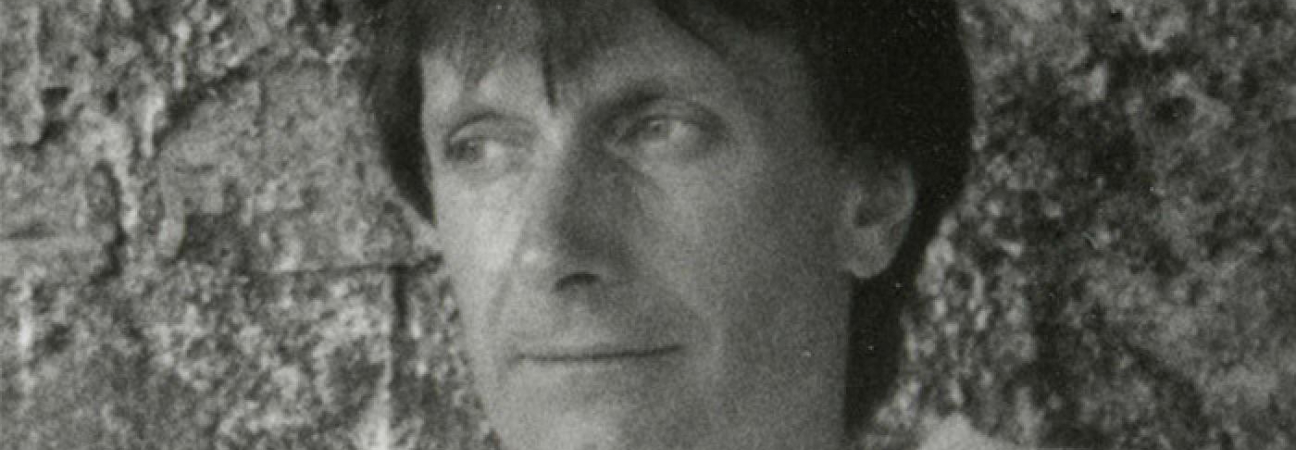En mars 2024, trois hommes ont déposé plainte contre le photographe Bernard Faucon, connu pour ses œuvres photographiques mettant en scène des adolescents. Les accusations portent sur des violences sexuelles, notamment des viols, tentatives de viols et agressions sexuelles, qui auraient été commises dans les années 1980. Les faits se seraient déroulés à Saint-Martian, une propriété familiale située dans le Vaucluse. À l’époque, les victimes avaient respectivement 16, 11 et 15 ans.
Deux des plaignants, Ferjeux van der Stigghel et Jean-Philippe Cecile, ont accepté de témoigner publiquement. Le troisième, qui préfère garder l’anonymat, avait déjà tenté d’alerter en 2006 et 2008, notamment à travers des commentaires sur des blogs et des courriers adressés à des associations d’aide aux victimes. Ces alertes coïncidaient avec une rétrospective majeure du travail de Bernard Faucon, organisée à la Maison européenne de la photographie à Paris.
Un système de prédation présumé
Les accusations mettent en lumière un système de prédation qui aurait été mis en place par Bernard Faucon et son entourage. Ferjeux van der Stigghel, aujourd’hui âgé de 61 ans, décrit un environnement à double visage : « Saint-Martian ressemblait à un conte de fées, mais c’était aussi un lieu où des prédateurs trouvaient leurs proies. » Ce lieu, autrefois une colonie de vacances tenue par les parents de Faucon, aurait été utilisé pour attirer des jeunes garçons, parfois très jeunes, sous prétexte de séances photographiques ou d’événements festifs.
Outre Bernard Faucon, les plaintes impliquent également Jean-Claude Larrieu, chef opérateur et proche collaborateur de Faucon, ainsi que Christian Caujolle, ancien directeur photo de Libération et fondateur de l’agence VU. Ce dernier est accusé d’avoir utilisé des promesses professionnelles, notamment des publications dans des journaux prestigieux, pour établir des relations inappropriées avec de jeunes garçons.
Bernard Faucon, né en 1950, est reconnu pour ses séries photographiques iconiques, comme « Les Idoles et les Sacrifices » ou « Les Chambres d’amour ». Ces œuvres, réalisées entre 1981 et 1987, mettent souvent en scène des adolescents dans des postures contemplatives, parfois dénudés. Si elles ont été saluées par le monde de l’art pour leur esthétique, elles suscitent aujourd’hui des interrogations sur les conditions dans lesquelles ces images ont été réalisées.
Les plaignants décrivent un univers où les jeunes garçons, âgés de 10 à 16 ans, étaient les principaux modèles. Ils évoquent des mises en scène dans des cabanons isolés, des séances nocturnes et une ambiance qu’ils qualifient de manipulatrice.
Malgré la gravité des faits, la loi française pourrait empêcher certaines poursuites en raison de la prescription. Actuellement, les victimes de viols disposent de 30 ans après leur majorité pour porter plainte. Si certains des actes dénoncés sont prescrits, les victimes espèrent que leurs témoignages encourageront d’autres personnes à briser le silence et à remettre en question les limites juridiques actuelles.
L’affaire Bernard Faucon jette une lumière crue sur certains milieux artistiques des années 1980, où les rapports de pouvoir et la vulnérabilité des jeunes étaient souvent exploités. La mise en cause de figures comme Christian Caujolle, influent dans le domaine de la photographie, suscite des débats sur la responsabilité éthique des institutions culturelles.
Les organisations et galeries associées au photographe n’ont pas encore pris position publiquement. Cependant, des voix s’élèvent pour appeler à une réflexion approfondie sur la manière dont le monde de l’art protège, ou échoue à protéger, les plus vulnérables.