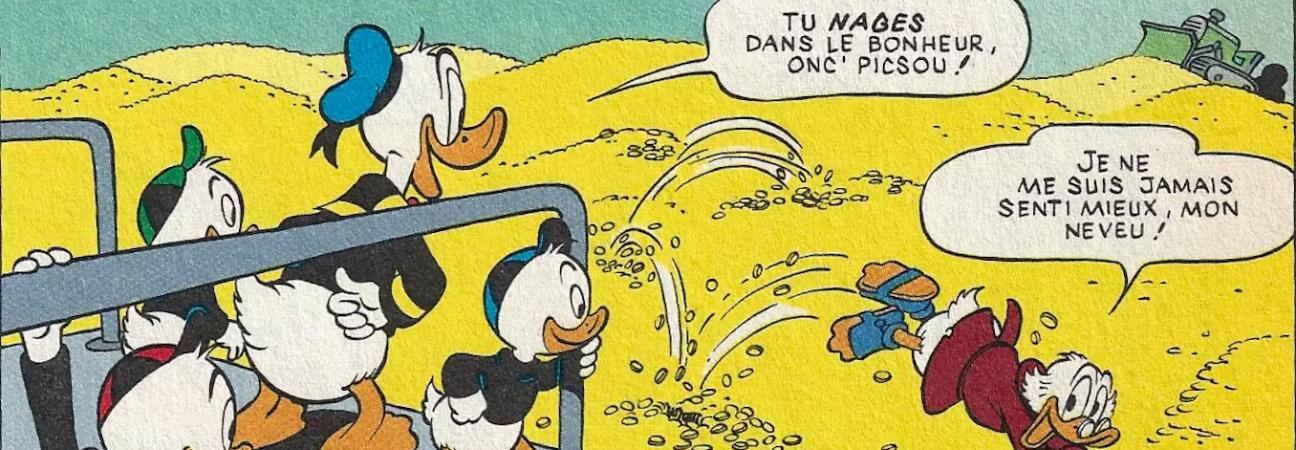Comment le financement public a changé la donne
Depuis une loi adoptée en 2014, l’État et les employeurs du privé financent directement les syndicats via un fonds spécifique. Concrètement, chaque entreprise privée verse 0,016 % des salaires bruts de ses employés à ce fonds. L’État complète ensuite la somme. En 2023, près de 150 millions d’euros ont été collectés, partagés à parts égales entre les syndicats et les organisations patronales.
Ce mécanisme est plutôt malin : plus les salaires augmentent, plus le montant du fonds grossit. Même si les adhérents sont de moins en moins nombreux, l’argent continue d’arriver. Cela explique comment les syndicats peuvent perdre des membres tout en voyant leurs caisses se remplir.
Alors que les syndicats comptaient 1,6 million d’adhérents en 2014, ils sont passés à 1,26 million en 2023. Pourtant, leur part de financement public a bondi, leur permettant de récupérer près de 20 millions d’euros supplémentaires en moins de 10 ans.
Une transparence pas vraiment au rendez-vous
La répartition de ces fonds est gérée par l’AGFPN (Association de gestion du fonds paritaire national). Mais ce n’est pas vraiment un modèle de transparence. Seules cinq personnes gèrent des dizaines de millions d’euros, et les tentatives pour obtenir des informations précises restent souvent sans réponse.
La Cour des comptes a souligné ce problème dans un rapport publié en février 2024. D’après elle, le contrôle de l’utilisation de ces fonds est quasiment inexistant. Un commissaire du gouvernement est censé superviser tout ça, mais dans les faits, il ne le fait pas.
Avec une part de plus en plus importante de leurs revenus qui vient de fonds publics ou patronaux, certains observateurs s’interrogent : les syndicats sont-ils encore totalement indépendants ? Quand une organisation dépend majoritairement de subventions plutôt que de ses membres, difficile de ne pas se poser la question.
Pourquoi les syndicats perdent autant d’adhérents
Les raisons de cette chute d’adhésions sont multiples. D’abord, beaucoup de jeunes ne se reconnaissent plus dans les syndicats traditionnels, qu’ils jugent trop bureaucratiques ou déconnectés de leurs réalités. Le monde du travail a changé : freelance, CDD, plateformes numériques… Autant de modèles qui n’entrent pas dans les cadres classiques de la représentation syndicale.
Certains salariés voient aussi les syndicats comme des machines politiques plutôt que comme des défenseurs du quotidien. Les grandes manifs, les négociations de haut niveau, c’est important, mais beaucoup aimeraient plus d’actions concrètes sur le terrain, au plus près des boîtes et des gens.
Les salariés, financeurs malgré eux
Même sans être syndiqué, un salarié participe indirectement au financement des syndicats via la contribution obligatoire de son employeur. Résultat, même ceux qui ne votent pas aux élections syndicales ou qui n’adhèrent pas participent au financement du dialogue social.
Pour certains, c’est normal : tout le monde bénéficie des accords négociés. Pour d’autres, cela ressemble plutôt à une taxe déguisée, surtout quand il n’y a pas de vraie transparence sur l’usage des fonds.
Avec moins d’adhérents, les syndicats sont parfois vus comme moins représentatifs. Pourtant, leur poids dans les négociations nationales reste important. Cela crée un décalage entre leur influence politique et leur ancrage réel sur le terrain. Moins proches des salariés, ils risquent de perdre encore davantage de crédibilité dans les années à venir.
Les syndicats n’ont pas le choix : s’ils veulent survivre, ils doivent se moderniser, rétablir la confiance et se reconnecter aux travailleurs, en particulier aux jeunes. Cela passe par :
- plus de transparence sur l’utilisation des fonds
- des actions concrètes et locales
- une communication adaptée aux nouvelles générations