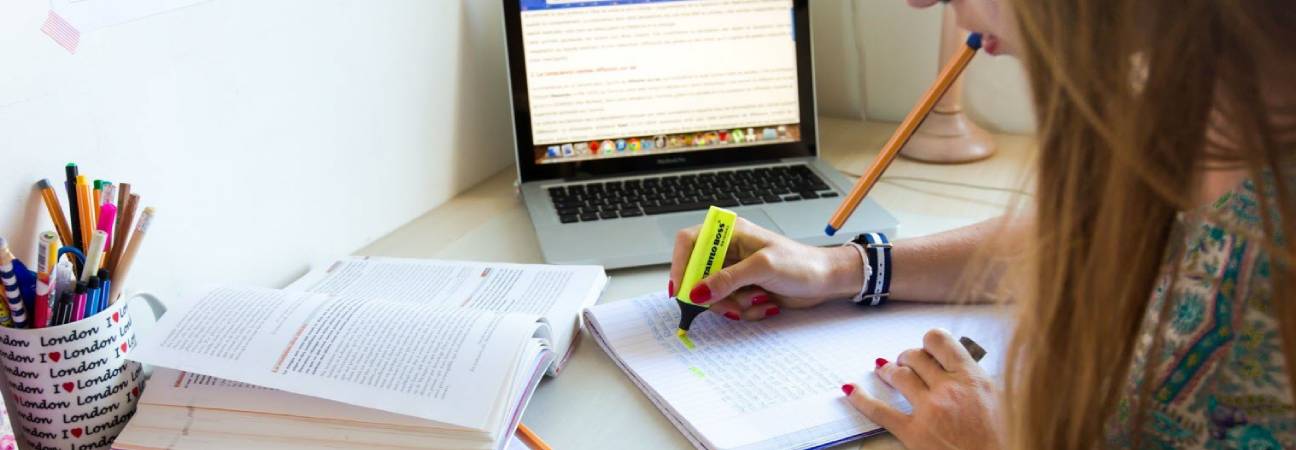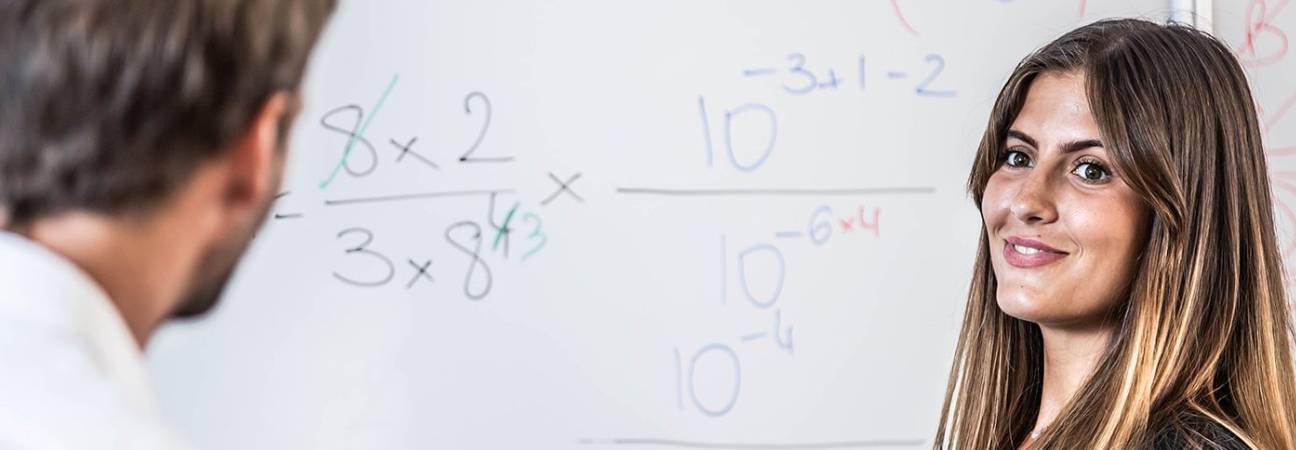Sujet 1 : notre avenir dépend-il de la technique ?
Analyse détaillée
Ce sujet interroge le rapport entre le progrès technique et notre devenir collectif. Il pose une question cruciale dans un monde où l’intelligence artificielle, les technologies numériques ou encore les avancées médicales modifient notre quotidien.
Problématique
Sommes-nous maîtres de la technique, ou devenons-nous ses assistés, voire ses victimes ? Notre futur est-il écrit par nos inventions ou par nos choix ?
Plan proposé
1. La technique transforme durablement le monde, donc notre avenir
La technique n’est pas neutre : elle modifie notre environnement, nos manières de vivre, de penser, de produire. L’invention de l’imprimerie a changé l’accès au savoir. L’électricité, les transports, Internet, les biotechnologies ont ouvert des mondes nouveaux.
Comme l’expliquait Simondon, chaque invention modifie les relations sociales. Ainsi, on peut dire que notre avenir est effectivement conditionné par les outils que nous créons.
2. Mais la technique est un moyen : c’est notre usage qui construit l’avenir
La technique, en elle-même, ne porte pas de projet. Elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Une même technologie (comme le nucléaire) peut produire de l’énergie propre ou des bombes. L’éthique et la politique orientent ses usages.
On rejoint ici la pensée de Hannah Arendt : ce n’est pas la technique qui est dangereuse, c’est l’absence de réflexion sur son usage. L’autonomie morale de l’humanité est ce qui peut faire la différence.
3. Notre avenir dépend donc à la fois de la technique et de notre capacité à la réguler
L’enjeu est de penser une technique responsable, respectueuse des équilibres sociaux, écologiques et humains. Le philosophe Hans Jonas parlait d’un principe responsabilité : il faut anticiper les conséquences de nos innovations sur les générations futures.
Notre avenir dépend donc moins de la technique elle-même que de notre lucidité et de notre capacité à en maîtriser les effets.
Sujet 2 : peut-on être libre sans lois ?
Analyse détaillée
La question semble paradoxale. Être libre, n’est-ce pas faire ce qu’on veut ? Et les lois ne viennent-elles pas justement limiter notre liberté ?
Problématique
La liberté est-elle possible dans l’absence totale de règles, ou est-elle au contraire rendue possible par la présence de lois ? Peut-on parler de liberté collective sans cadre commun ?
Plan proposé
1. Sans lois, pas de limites : la liberté semble absolue
Dans un monde sans lois, chacun pourrait faire ce qu’il veut. C’est une vision individualiste et anarchique de la liberté. On retrouve cette idée dans l’état de nature de Hobbes, où les hommes sont libres mais en guerre perpétuelle : la liberté devient alors une menace.
2. Les lois sont des garanties : elles rendent la liberté possible
En réalité, les lois permettent de protéger les droits de chacun. Elles définissent un cadre commun qui empêche les plus forts d’écraser les plus faibles. La liberté est alors partagée, organisée, protégée.
Chez Rousseau, la liberté consiste à obéir à la loi qu’on s’est prescrite à soi-même. C’est la vision de l’autonomie : une loi commune qui n’est pas une contrainte extérieure, mais une règle voulue collectivement.
3. La vraie liberté est l’autonomie, pas l’absence de loi
Chez Kant, être libre, ce n’est pas faire n’importe quoi. C’est se donner des règles, en conscience, pour vivre en accord avec la morale. Sans lois, il n’y a que les passions, le chaos, l’arbitraire.
La loi peut donc être une condition de la liberté, dès lors qu’elle est juste, réfléchie, partagée.
Commentaire de texte : Rawls, Théorie de la justice
Idée centrale du texte
Rawls explique que dans une démocratie, l’égalité politique formelle ne suffit pas. Il faut aussi une égalité concrète d’accès à l’information, au débat, à l’influence. Sinon, certains peuvent dominer les autres grâce à leur richesse ou leur position sociale.
Structure de l’argumentation
1. L’idéal démocratique : participation équitable de tous
Chaque citoyen devrait pouvoir comprendre les enjeux politiques, juger les décisions prises et proposer ses idées. C’est la base d’une société juste.
2. L’obstacle : la concentration des moyens d’influence
Ceux qui possèdent les ressources économiques (entreprises, médias, capital) ont un poids disproportionné dans les décisions publiques. Cela crée une inégalité masquée mais réelle.
3. La solution : réguler et compenser les déséquilibres
Pour garantir l’égalité, il faut redistribuer les moyens d’expression politique. Cela passe par des médias publics, des aides à la participation, des subventions gouvernementales.
Rawls propose ainsi une vision exigeante de la justice, où la démocratie n’est pas seulement un droit, mais une possibilité effective pour tous.
Conclusion générale
Ces sujets du bac philo 2025 illustrent bien les grandes tensions contemporaines entre liberté, technique et justice. Réfléchir à ce que nous voulons pour demain exige de comprendre les conditions de notre autonomie réelle, collective et responsable.