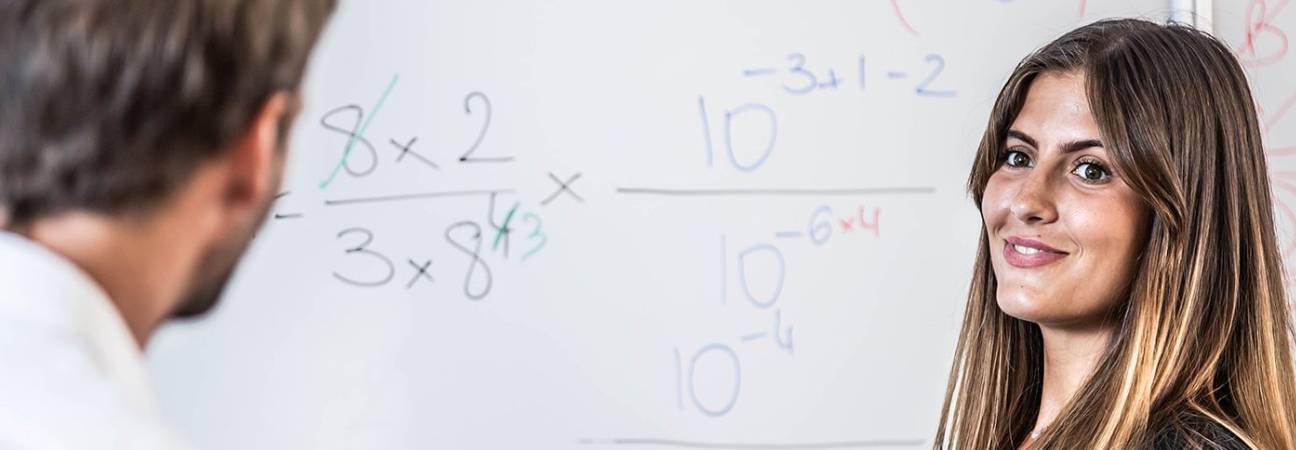Repères express
1906 : naissance à Joal (Sénégal). 1935 : agrégation de grammaire, une première pour un Africain. 1945 : début de la carrière politique. 1960–1980 : premier président du Sénégal indépendant. 1983 : premier Africain élu à l’Académie française. 2001 : décès à Verson (Normandie).
Enfance et formation : une double appartenance
Grandir à Joal, sur la côte sénégalaise, c’est naître entre l’Atlantique, les traditions sérères et la mission catholique. Senghor reçoit une éducation religieuse exigeante, apprend le français très tôt, sans perdre de vue la poésie des contes et des rythmes africains. Il excelle au collège à Dakar, décroche une bourse, et embarque pour la France en 1928. Objectif : comprendre le monde pour mieux y prendre place.
À Paris, il passe par le lycée Louis-le-Grand puis la Sorbonne. Il dévore les humanités, se lie d’amitié avec des étudiants venus d’ailleurs (dont Aimé Césaire), et découvre les angles morts du regard colonial. En 1935, il réussit brillamment l’agrégation de grammaire. Il devient professeur, mais n’oublie pas l’essentiel : écrire, et penser.
La Négritude : le mot, le monde
Avec Césaire et Léon-Gontran Damas, Senghor fait émerger un mot qui deviendra un mouvement : la Négritude. Derrière, une intuition claire : redonner voix, dignité et épaisseur à l’identité noire, niée ou caricaturée par la domination coloniale. La Négritude n’est pas un repli. C’est une manière d’affirmer un rapport au monde, une esthétique du rythme, de l’oralité, du commun et du sacré, ouverte au dialogue.
La poésie devient laboratoire. Chants d’ombre (1945) célèbre la mère, la femme noire, la mémoire. Hosties noires (1948) rend hommage aux tirailleurs africains, aux blessés de l’histoire. Les mots de Senghor cherchent une langue française élargie, traversée par les musiques africaines et les images du terroir. C’est une poétique et une politique.
« La Négritude est l’ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. »
Le concept suscite des débats (y compris avec Sartre ou certains penseurs africains). Senghor répond sur le fond : non, la Négritude n’est pas un « racisme à l’envers », mais une affirmation nécessaire pour entrer à égalité dans la conversation des cultures.
La guerre, l’épreuve, et l’entrée en politique
Mobilisé en 1939, Senghor est fait prisonnier en 1940. Il découvre l’absurde, la faim, et le racisme dans les camps. L’expérience marque sa poésie et son éthique. Libéré en 1942, il s’engage dans la Résistance intellectuelle, enseigne, publie et organise des réseaux.
En 1945, il est élu député du Sénégal à l’Assemblée nationale. Au Palais-Bourbon, il défend l’égalité des droits, la citoyenneté, la reconnaissance des cultures colonisées. Sa ligne : pas l’assimilation, mais une coopération qui respecte les identités. Il fonde bientôt son parti (l’Union progressiste sénégalaise), porte un projet : un fédéralisme africain, social et démocratique.
1960 : le Sénégal indépendant et le président-poète
Le 5 septembre 1960, le Sénégal devient indépendant. Senghor est élu premier président. Il restera au pouvoir vingt ans. Son cap : un « socialisme africain » ancré dans les solidarités villageoises, l’éducation, la santé, la planification douce. Il mise sur les institutions, sur la culture comme levier de développement, et sur une relation assumée avec la France, rééquilibrée mais durable.
Le bilan est contrasté, comme souvent dans les années post-indépendances. Points forts : stabilité politique, diplomatie active, inventivité culturelle (l’École de Dakar, le Festival mondial des arts nègres en 1966). Points faibles : centralisation, parti unique, économie fragile, contestations étudiantes et sociales (notamment en 1968). Senghor pratique le dialogue, mais gouverne ferme. Fait rare à l’époque : il démissionne volontairement en 1980, et passe le relais.
La francophonie : une politique de langue
Chez Senghor, la langue française n’est pas un trophée colonial, ni une simple technique. C’est un outil d’universel, capable de porter le dialogue des cultures. Avec Hamani Diori ou Habib Bourguiba, il milite pour une francophonie politique et coopérative. L’Agence de coopération culturelle et technique naît en 1970. Lui rêve d’un « Commonwealth à la française » rassemblant États et sociétés civiles autour d’actions concrètes : éducation, médias, sciences, création.
« La francophonie, c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre : une symbiose des énergies de tous les continents. »
La formule résume un fil rouge de sa pensée : la civilisation de l’Universel, où chaque culture s’enracine pour mieux s’ouvrir. En 1983, l’Académie française lui ouvre ses portes. Geste symbolique fort : un Africain siège au cœur d’une institution qui a longtemps fixé la norme de la langue.
Lire la poésie de Senghor aujourd’hui
La poésie de Senghor est une voix qui respire large. Elle puise dans les mythes, la liturgie, la mère Afrique, l’enfance, la mémoire des guerres. Elle invente des métissages de formes : hymnes, complaintes, élégies, poèmes en prose. Elle joue la musique du vers, le souffle de l’oralité, la scansion du tambour. Elle dit la blessure et la fierté.
Quelques jalons : Chants d’ombre (1945), Hosties noires (1948), Éthiopiques (1956), Nocturnes (1961), Poésie complète (1990). À côté, des essais et des speeches qui articulent esthétique et politique : Négritude, francité, universel. L’ensemble compose une œuvre où penser et chanter avancent ensemble.
Thèmes phares
- Identité et dignité : lutter contre les assignations, réaffirmer la valeur des cultures africaines.
- Mémoire : guerres, exil, tirailleurs, Thiaroye. Donner un nom aux oubliés.
- Femme et mère : figures centrales, sources de vie, d’érotisme, de cosmos.
- Langue : élargir le français par les images et les rythmes d’Afrique.
- Dialogue : faire tenir ensemble enracinement et ouverture.
Débats et critiques : l’autre face du portrait
Parler d’héritage sans parler de controverses serait tronquer Senghor. Des critiques lui reprochent l’autoritarisme des débuts, la longévité du parti unique, une relation avec la France jugée trop « étroite ». D’autres contestent certaines formules de la Négritude, perçues comme essentialistes. Ces débats existent, ils sont utiles.
Ils permettent aussi de comprendre la complexité d’une époque : tenir l’État à flots après l’indépendance, bâtir des institutions, négocier des partenariats, tout en réinventant un récit collectif. Senghor n’a pas esquivé ces tensions. Il a tenté une voie singulière : stabiliser et cultiver, gouverner et symboliser. Son geste le plus fort reste peut-être sa sortie volontaire du pouvoir.
Léopold Sédar Senghor : vie, œuvre et héritage pour la génération d’aujourd’hui
Pourquoi revenir à Senghor en 2025 ? Parce que ses idées recoupent des questions très actuelles : comment cohabitent les langues ? Comment réparer des mémoires blessées sans dresser des murs ? Comment faire du métissage une force et non une injonction ? Comment tenir ensemble culture et développement ?
Sa réponse tient en trois mots. Enracinement : assumer ses sources, ses appartenances. Ouverture : accueillir l’autre et se laisser déplacer. Création : inventer des formes nouvelles – poétiques, politiques, éducatives – pour tenir l’équilibre. C’est le cœur de Léopold Sédar Senghor : vie, œuvre et héritage : une méthode pour habiter le monde.
Dates et œuvres à connaître
Dates clés
- 1906 : naissance à Joal.
- 1928 : départ pour la France.
- 1935 : agrégation de grammaire.
- 1940–1942 : captivité, puis engagement dans la Résistance intellectuelle.
- 1945 : élu député.
- 1960 : président du Sénégal.
- 1966 : Festival mondial des arts nègres (Dakar).
- 1980 : démission de la présidence.
- 1983 : Académie française.
- 2001 : décès.
Œuvres repères
- Chants d’ombre (1945)
- Hosties noires (1948)
- Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache (1948)
- Éthiopiques (1956)
- Nocturnes (1961)
- Poésie complète (1990)
Un style et une vision
Senghor écrit comme on respire après l’orage. Il mêle lyrisme et concepts, sens du rythme et architecture de la phrase. Il parle du village et des villes, des femmes, des dieux, des arbres et des livres. Il fait du français une langue traversée par d’autres souffles. Il rêve d’un universel qui ne gomme pas les différences mais les articule.
Sa vision politique n’a pas réponse à tout. Elle a cependant offert une ossature à un pays naissant, et une grammaire à une génération d’artistes et de penseurs. Aujourd’hui encore, ses notions — Négritude, francophonie, civilisation de l’Universel — servent d’outils pour lire le réel, discuter, et créer.
Pourquoi le lire (et le relire) maintenant
Parce que les pages de Hosties noires rappellent la dette envers des soldats restés dans l’ombre. Parce que la ferveur de Chants d’ombre console et réarme. Parce que ses discours sur la langue et la culture donnent des arguments solides à celles et ceux qui veulent concilier mémoire et avenir. Parce que Léopold Sédar Senghor : vie, œuvre et héritage est plus qu’un titre : c’est un chemin à parcourir, sans hagiographie ni procès, mais avec exigence.
Lire Senghor, c’est entendre une voix qui propose un pacte : « S’enraciner pour s’ouvrir ». Il y a là un programme d’étudiant, d’artiste, de responsable public, de citoyen curieux. En bref, un programme pour notre temps.