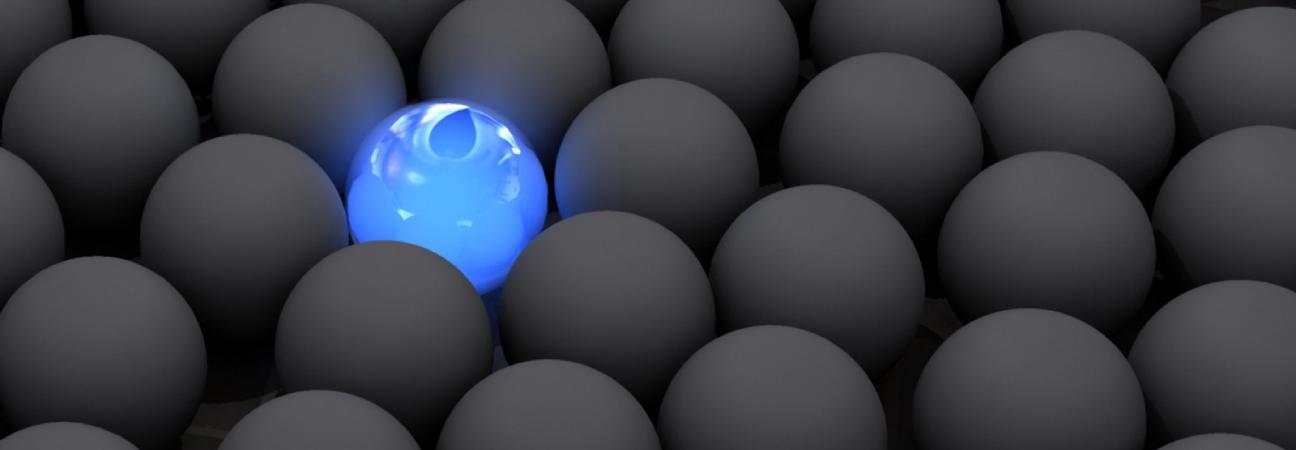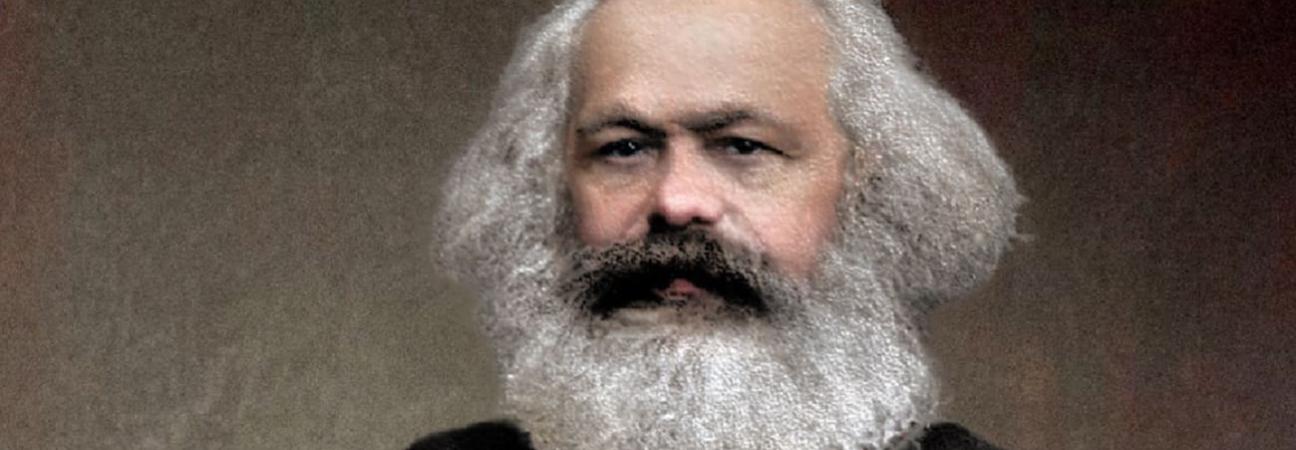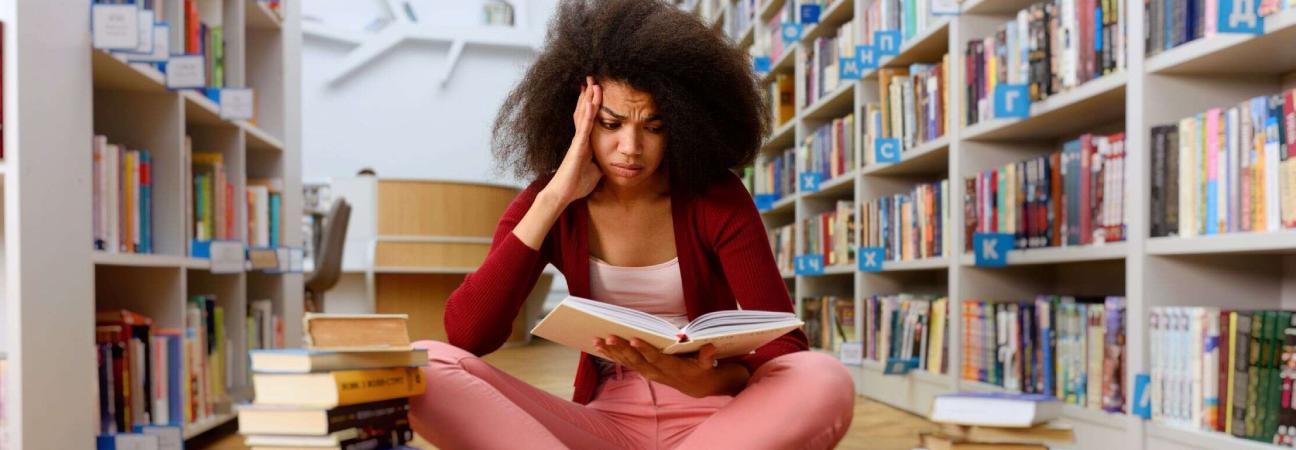L’état de nature selon Hobbes
Avant l’instauration de l’État, les hommes vivent dans ce que Hobbes appelle l’état de nature. Cet état n’est pas un moment historique, mais une hypothèse de travail permettant de comprendre les conditions d’existence de l’ordre politique.
Dans cet état de nature, chaque individu cherche avant tout à assurer sa propre survie, ce qui le pousse à se défier des autres et à utiliser la force pour préserver son intérêt. Hobbes décrit une situation où la peur, la compétition et la méfiance règnent en permanence. Il en découle ce qu’il nomme l’état de guerre de tous contre tous, une condition dans laquelle il n’existe ni justice ni sécurité, et où la loi du plus fort prévaut.
Le droit naturel et la loi naturelle
Dans cet état de nature, les hommes possèdent un droit naturel, qui leur permet de faire tout ce qui leur semble nécessaire à leur survie. Cependant, ce droit absolu de chacun sur tout engendre un climat de chaos et de violence.
Pour échapper à cet enfer, les hommes sont poussés à reconnaître une loi naturelle : une règle dictée par la raison, selon laquelle il faut rechercher la paix et renoncer à une partie de son droit naturel pour garantir la sécurité commune. La loi naturelle ne peut cependant être appliquée qu’avec l’instauration d’une autorité capable d’imposer son respect : le souverain.
Le contrat social et l’instauration du souverain
Pour sortir de l’état de nature, les hommes doivent conclure un contrat social, c’est-à-dire un accord par lequel chacun accepte de renoncer à son droit de faire ce qu’il veut en échange d’une protection garantie par une autorité supérieure. Ce pacte donne naissance à l’État et au souverain, qui devient détenteur du pouvoir suprême.
Le souverain peut prendre plusieurs formes : un monarque absolu, une assemblée ou toute autre entité politique capable d’incarner l’unité et la force de la société. Mais ce qui importe, c’est qu’il détienne un pouvoir absolu. Selon Hobbes, un pouvoir limité serait source de divisions et de chaos, ramenant la société vers l’état de nature.
La soumission au souverain : un choix rationnel
Une fois le contrat social conclu, les individus deviennent les sujets du souverain et doivent lui obéir en toutes circonstances. Ce n’est pas un choix moral mais une nécessité rationnelle : sans obéissance au souverain, l’État s’effondre et les hommes retombent dans l’insécurité de l’état de nature.
Le souverain doit donc disposer de la totalité du pouvoir, y compris celui de décider de la justice, des lois et des croyances de ses sujets. La crainte du châtiment est un moteur essentiel de la soumission : les hommes obéissent parce qu’ils ont peur des conséquences d’une désobéissance.
La puissance absolue du souverain
Parce qu’il détient l’autorisation collective de gouverner, le souverain ne peut pas être contesté. Il décide seul des lois, de la guerre, des punitions et des croyances de son peuple. Le souverain étant le garant de la paix, toute opposition à son pouvoir est une menace contre la stabilité de l’État.
Cependant, la soumission n’est pas sans limites : le souverain n’a pas le droit d’ordonner aux sujets de se tuer eux-mêmes ou de se livrer à leur propre destruction. Le but de l’État étant de garantir la survie des individus, les citoyens ont toujours le droit de se défendre si leur vie est directement menacée par le pouvoir.
Crainte et consentement : les deux piliers de l’autorégulation de l’État
Le système de Hobbes repose sur un équilibre entre consentement et crainte. Le consentement initial au contrat social garantit la légitimité du pouvoir, tandis que la crainte des sanctions assure la stabilité de l’ordre politique.
L’obéissance au souverain est donc plus qu’une obligation : c’est une condition de survie. Un pouvoir trop faible ou trop contesté conduit inexorablement à la guerre civile, qui ramène les individus à l’état de nature. Mieux vaut un pouvoir fort et absolu qu’une anarchie où chacun doit lutter pour sa propre existence.
L’impact de la pensée de Hobbes aujourd’hui
La théorie hobbésienne a influencé de nombreux penseurs politiques modernes et sert encore aujourd’hui à justifier l’existence des États forts. Son idée selon laquelle l’homme accepte la soumission pour échapper à la peur résonne dans de nombreux débats sur la sécurité, la surveillance et le pouvoir des gouvernements.
Si la conception d’un pouvoir absolu peut sembler extrême, l’idée que l’ordre et la paix nécessitent une autorité forte reste très actuelle. La pensée de Hobbes invite donc à réfléchir sur les limites de la liberté individuelle et les exigences de la vie en société.