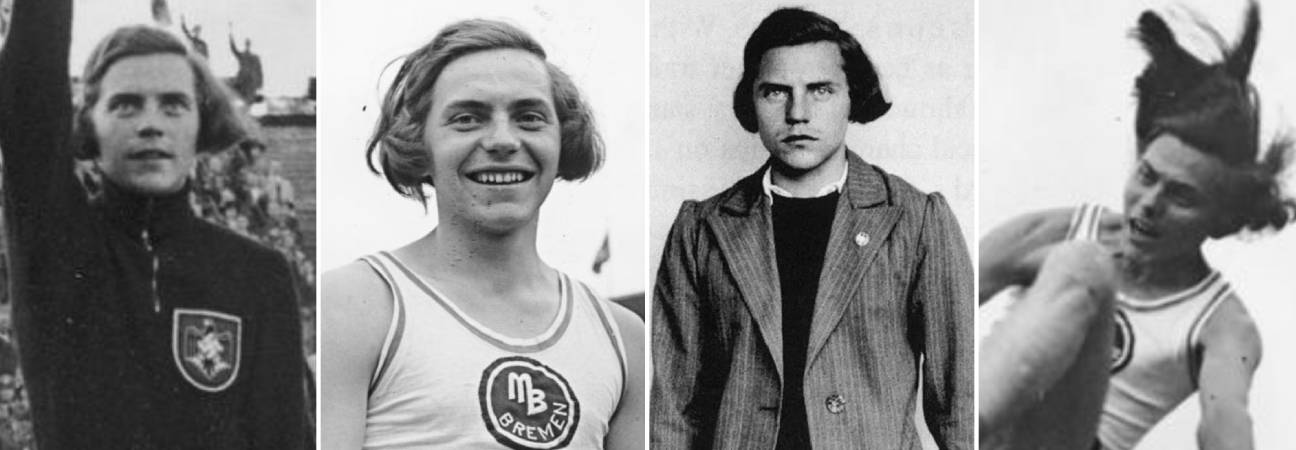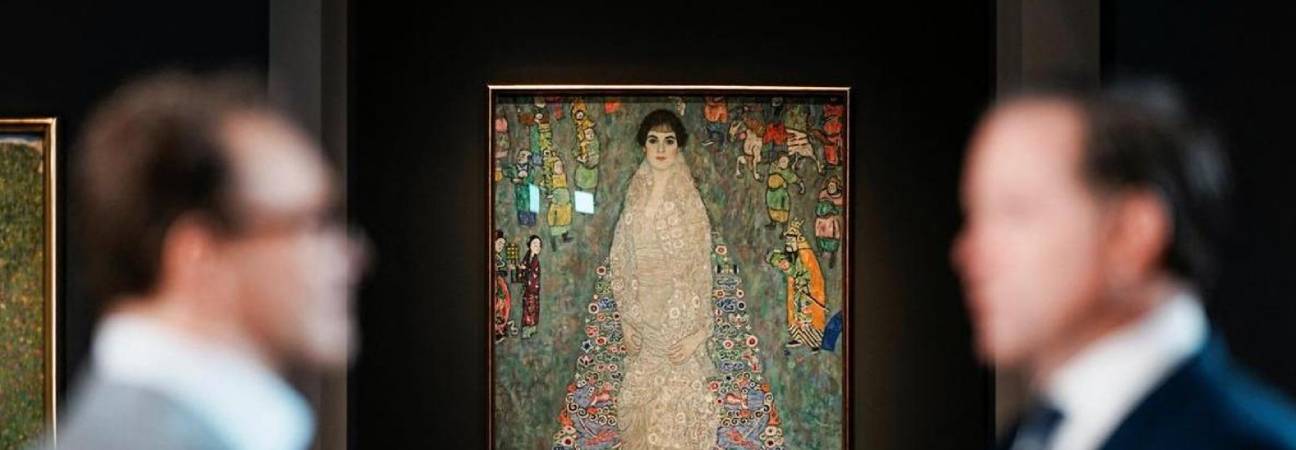Les origines de la fève dans la galette
La fève trouve ses premières traces dans les Saturnales, fêtes romaines célébrées entre décembre et janvier en l’honneur de Saturne, dieu de l’agriculture. Pendant ces festivités, les rôles sociaux étaient inversés : esclaves et maîtres partageaient un repas sur un pied d’égalité, et un roi fictif était désigné grâce à une fève cachée dans un gâteau.
La fève, légumineuse courante à l’époque, était choisie pour sa symbolique de fertilité. Elle représentait la renaissance et la vie, un thème central lors des célébrations du solstice d’hiver. En outre, sa résistance à la cuisson en faisait un choix pratique.
Avec l’avènement du christianisme, les Saturnales ont laissé place à l’Épiphanie, célébrée le 6 janvier, commémorant la visite des Rois mages à l’enfant Jésus. Bien que la galette des rois ne soit pas mentionnée dans les Évangiles, la tradition de tirer un roi parmi les convives a perduré.
Au Moyen Âge, la fève était utilisée lors de la « fête des fous », où les rôles sociaux étaient encore inversés. Celui qui trouvait la fève dans le gâteau devenait le roi de la journée, symbolisant l’éphémère et la dérision du pouvoir.
De la graine à la porcelaine
Jusqu’au XIXe siècle, la fève utilisée était encore une simple graine, souvent un haricot blanc ou une fève classique. Toutefois, pour éviter que les participants ne l’avalent accidentellement ou ne trichent, elle a été remplacée par des objets plus solides et visibles.
En 1875, la première fève en porcelaine a été fabriquée en Allemagne, inspirée par les figurines en biscuit de porcelaine alors très populaires. Ces fèves représentaient souvent des symboles de chance comme des bébés emmaillotés ou des couronnes.
Au fil des ans, les fèves se sont diversifiées pour inclure des personnages de la culture populaire, des animaux ou même des objets publicitaires. Cette diversité a donné naissance à une véritable passion : la fabophilie, ou collection de fèves.
Pourquoi la galette de l’Élysée n’a pas de fève ?
Chaque année, une immense galette est offerte au président de la République par les boulangers-pâtissiers. Cependant, cette galette ne contient ni fève ni couronne. La raison est protocolaire : un président ne peut être couronné roi, un symbole jugé incompatible avec le rôle républicain. Cette tradition remonte à 1975, sous Valéry Giscard d’Estaing.
Entre tradition et innovation
Aujourd’hui, les fèves en porcelaine, plastique ou résine sont produites en masse, souvent en Asie, mais certains artisans français continuent à fabriquer des fèves de manière traditionnelle. Les boulangeries rivalisent de créativité pour proposer des fèves uniques, parfois en séries limitées, rendant la quête encore plus excitante.
Certaines galettes incluent des fèves en or ou d’autres matériaux précieux, transformant cette tradition en un véritable jeu de chasse au trésor. Par exemple, certaines boulangeries cachent des fèves d’une grande valeur pour attirer les amateurs et les collectionneurs.
Le rituel de la galette des rois est un moment de partage familial ou amical. La personne la plus jeune se place sous la table pour désigner à qui revient chaque part, un geste visant à garantir l’équité du tirage. Celui qui découvre la fève devient le roi ou la reine et reçoit une couronne symbolique.
La galette des rois est bien plus qu’un dessert : elle incarne une tradition séculaire qui mêle héritage païen, symbolisme chrétien et culture populaire. Aujourd’hui, elle se décline en plusieurs versions – frangipane, brioche, pomme, chocolat – reflétant la richesse de la gastronomie française.