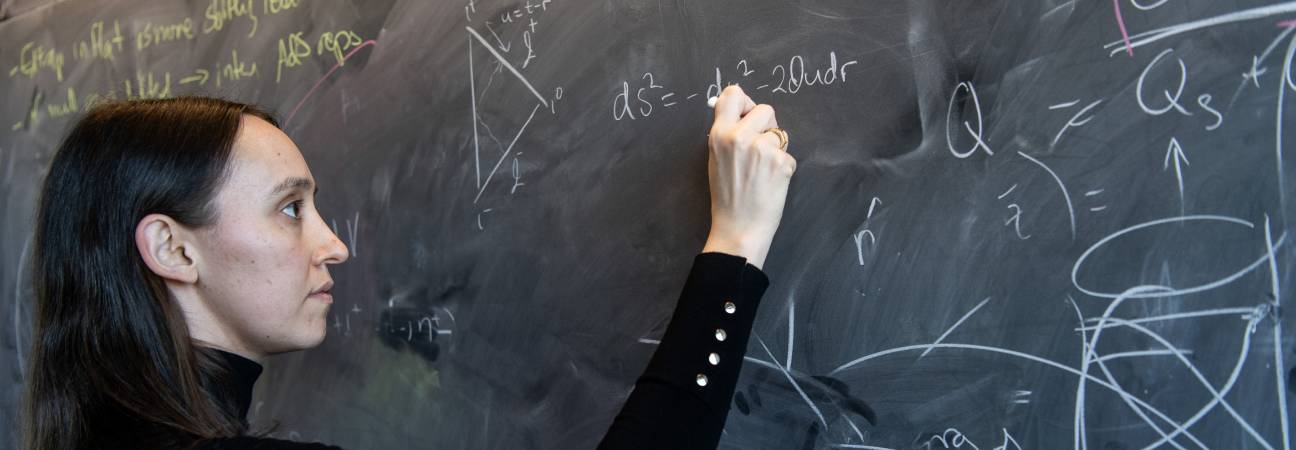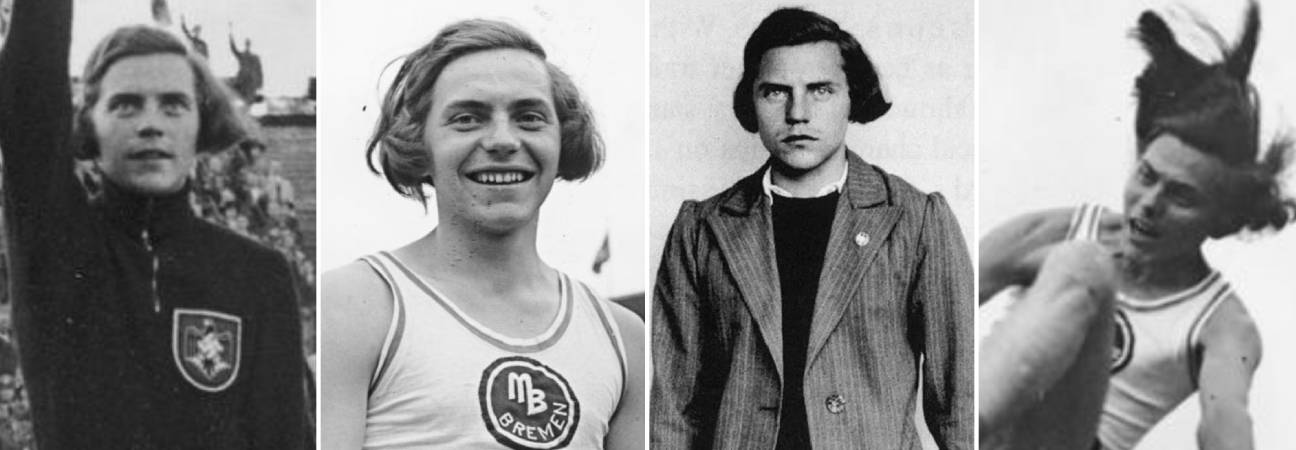Une « tradition » qui cache une violence extrême
Une pratique centrée sur des garçons réduits au divertissement
Le terme Bacha bazi vient du dari et signifie littéralement « jouer avec les garçons ». Il désigne un système dans lequel des hommes entretiennent des garçons prépubères ou adolescents, les bacha bereesh (« garçons imberbes »), pour qu’ils dansent lors de soirées privées et servent de jouets sexuels.
Concrètement, ces garçons sont souvent habillés en robes, maquillés, parés de bijoux. Ils apprennent des chorégraphies qu’ils exécutent devant un public composé uniquement d’hommes. Une fois la fête terminée, la dimension « divertissement » laisse place à la réalité brutale : beaucoup subissent des violences sexuelles de la part de leur « maître » ou des invités.
Dans certaines régions, posséder un bacha est perçu comme un signe de prestige social. Les hommes qui en ont sont souvent des chefs de guerre, des commandants de police, des responsables politiques ou des notables locaux. Cette position de pouvoir rend les poursuites extrêmement difficiles, même lorsque des lois existent.
Des garçons presque toujours issus de milieux très pauvres
Les victimes du Bacha bazi viennent majoritairement de familles très précaires ou sont des enfants des rues. Certaines familles, acculées par la pauvreté, acceptent que leur fils soit « pris en charge » par un notable en échange d’argent, de nourriture ou de promesses d’un avenir meilleur. D’autres garçons sont tout simplement kidnappés ou « adoptés » sous un faux prétexte.
Une fois entrés dans ce système, ils se retrouvent totalement dépendants : logement, nourriture, protection… tout passe par leur exploiteur. Rompre le lien, parler à la police ou fuir expose à des risques énormes : représailles, rejet de la famille, absence totale de protection institutionnelle.
Des racines anciennes, une réalité très actuelle
Une pratique ancienne d’Asie centrale
Le Bacha bazi n’est pas né avec les conflits récents. Des récits de voyageurs et de diplomates occidentaux évoquent, dès le XIXe siècle, des « garçons danseurs » dans différentes régions d’Asie centrale, notamment au Turkestan et en Afghanistan. Ils y sont décrits comme des jeunes garçons habillés en femmes, dansant devant des assemblées exclusivement masculines.
Historiquement, la frontière entre danse, compagnie et exploitation sexuelle pouvait varier selon les lieux et les époques. Ce qui est certain, c’est que la guerre, la circulation massive des armes et l’effondrement des institutions ont transformé cette coutume en une pratique beaucoup plus violente, marquée par l’esclavage sexuel systématique et la marchandisation des corps.
Interdictions, résurgences et nouvelle criminalisation
Pendant leur premier passage au pouvoir dans les années 1990, les talibans ont officiellement interdit le Bacha bazi, estimant qu’il était contraire à la charia. Des témoignages évoquent alors des peines très lourdes, voire la peine de mort, pour les hommes accusés de cette pratique.
Après la chute du régime taliban en 2001, le paysage change. De nombreux anciens seigneurs de guerre et chefs de milices reviennent au pouvoir ou obtiennent des postes dans la police, l’armée ou les gouvernorats. Dans ce contexte de grande insécurité, l’État central a peu de prise sur ces acteurs locaux, et le Bacha bazi regagne du terrain, parfois au vu et au su de tous.
Face à la pression internationale, l’Afghanistan adopte en 2017 un nouveau code pénal qui intègre pour la première fois une incrimination spécifique du Bacha bazi. La pratique est assimilée à de la traite et à des violences sexuelles, avec des peines pouvant aller jusqu’à la perpétuité dans les cas les plus graves.
Sur le papier, le Bacha bazi est donc clairement illégal. En pratique, les rapports de l’ONU, d’ONG spécialisées et de l’All Survivors Project montrent que la pratique reste répandue dans plusieurs provinces, simplement plus discrète, poussée dans la clandestinité par la peur des dénonciations.
Pauvreté, guerre et patriarcat : pourquoi ça continue
Garçons vulnérables, hommes puissants
Pour comprendre pourquoi le Bacha bazi persiste, il faut regarder les facteurs structurels. La plupart des chercheurs et ONG citent trois éléments principaux : pauvreté extrême, genre ultra-ségrégué et culture des armes.
Dans un pays ravagé par des décennies de guerre, où beaucoup d’enfants sont orphelins ou déplacés, les garçons deviennent des cibles faciles. L’absence de femmes dans l’espace public, combinée à la pression sociale autour de la masculinité et à l’impossibilité financière de se marier, crée un terrain où certains hommes justifient ces pratiques comme une « alternative » tolérée, alors même qu’il s’agit une forme de violence sexuelle sur mineurs.
À cela s’ajoute un niveau élevé de corruption : quand l’auteur est un commandant local ou un responsable de la police, les familles savent qu’elles risquent davantage de représailles que de justice. Résultat : beaucoup de cas ne sont jamais signalés, et l’impunité reste la norme.
Une pratique parfois normalisée dans certains milieux
Dans certaines zones, le Bacha bazi est encore présenté comme une « tradition locale » qui n’aurait rien à voir avec la pédophilie. Posséder un « beau garçon » serait un symbole de statut social, presque comparable à une voiture de luxe ou à une grande maison. Des enquêtes montrent que des hommes exhibent fièrement les photos de leurs bachas sur leurs téléphones, sans se considérer comme criminels.
Des ONG résument souvent la situation ainsi : pour certains hommes, renoncer au Bacha bazi, ce serait renoncer à un privilège intime, normalisé depuis des générations.
Dans ce contexte, les lois restent difficiles à appliquer sans un changement de mentalité profond, qui touche à la fois aux rapports de genre, à la masculinité, au pouvoir et à la place des enfants dans la société.
Quelles conséquences pour les garçons victimes ?
Les effets du Bacha bazi sur les garçons concernés sont dévastateurs. Sur le plan physique, ils peuvent subir des blessures, des infections, des grossesses non voulues n’étant pas en jeu mais des IST graves, et un accès quasi nul aux soins. Mais c’est surtout le traumatisme psychologique qui marque durablement.
Beaucoup souffrent de troubles anxieux, de dépression, de cauchemars récurrents. Certains se tournent vers l’alcool ou les drogues pour supporter ce qu’ils ont vécu. D’autres intériorisent une très forte honte, se sentant coupables alors qu’ils sont victimes d’un système de domination extrême.
À l’adolescence ou au début de l’âge adulte, lorsque les garçons ne sont plus jugés « désirables » par leurs exploiteurs, ils sont souvent abandonnés. Sans formation, rejetés par leur communauté, marqués par la stigmatisation, ils peinent à se réinsérer. Certains restent enfermés dans des réseaux de prostitution, d’autres rejoignent des groupes armés, parfois par désir de vengeance contre ceux qui les ont exploités.
Ce que fait la communauté internationale (et ses limites)
Rendre visible une violence longtemps cachée
Pendant longtemps, le Bacha bazi a été très peu médiatisé à l’étranger. Un tournant important survient en 2010 avec le documentaire « The Dancing Boys of Afghanistan », diffusé par PBS, qui suit un journaliste afghan infiltrant ce milieu et donnant la parole à des garçons victimes ainsi qu’à leurs exploiteurs.
Des rapports successifs de l’ONU, de l’UNICEF, de l’All Survivors Project et d’ONG locales ont ensuite documenté l’ampleur des violences, le rôle de certains membres des forces de sécurité afghanes et l’inaction (ou l’impuissance) de la communauté internationale.
Des militaires étrangers déployés en Afghanistan ont raconté avoir été témoins d’abus sur des garçons par des forces alliées, sans avoir l’autorisation d’intervenir, sous prétexte de « respect de la culture locale ». Ces témoignages ont créé un véritable malaise dans plusieurs armées et relancé le débat sur les limites du relativisme culturel quand il s’agit de droits humains fondamentaux.
Des lois nouvelles, mais peu appliquées
Juridiquement, le pays a fait quelques pas importants : criminalisation explicite du Bacha bazi dans le code pénal révisé, reconnaissance de cette pratique comme une forme de traite des êtres humains, renforcement des peines lorsque les victimes sont utilisées dans les combats.
Mais sans système judiciaire stable, sans indépendance des juges et sans protection réelle des témoins et des familles, ces textes restent largement théoriques. Les rapports signalent très peu de procès et quasi aucune condamnation médiatisée pour Bacha bazi, alors même que le phénomène est décrit comme « courant » dans plusieurs provinces.
🔴 En Afghanistan, la ségrégation des femmes est si extrême qu’elle a fait naître une pratique déroutante : le bacha bazi, qui signifie littéralement « jouer avec les garçons ».
— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) November 6, 2025
De jeunes garçons, souvent issus de familles modestes, sont choisis pour danser et divertir des… pic.twitter.com/SfFayFClxU