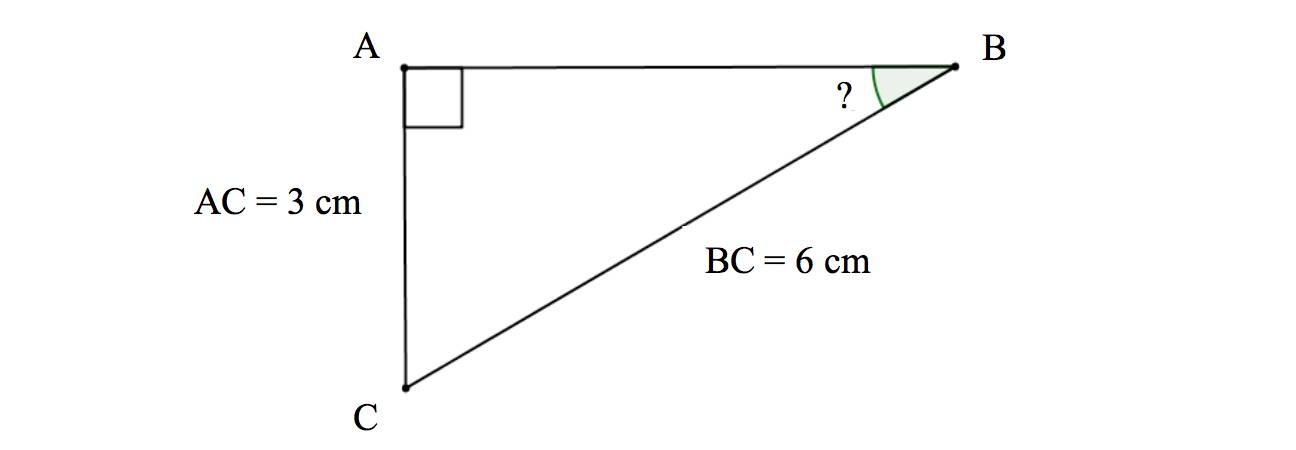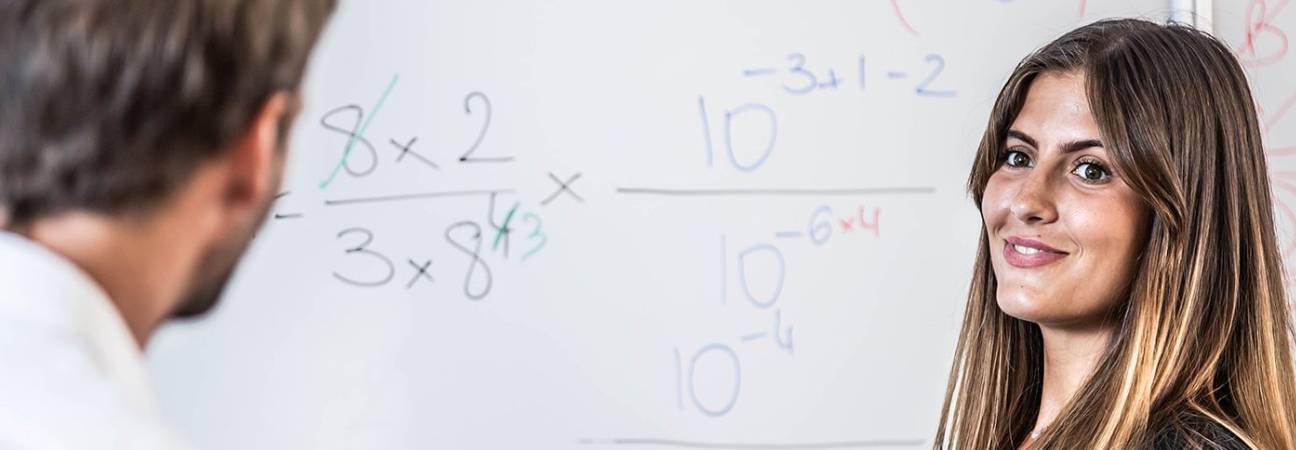Un format d’épreuve en trois parties
L’épreuve dure 2 heures et se divise en trois exercices notés sur 50 points au total : 20 points pour l’histoire, 20 points pour la géographie, et 10 points pour l’EMC. La nouveauté cette année : les notes d’histoire-géo et d’EMC sont désormais séparées, même si les exercices restent regroupés dans la même copie.
Pour bien gérer le temps, les candidats sont conseillés de passer 45 minutes sur l’analyse de documents, 40 minutes sur la rédaction argumentée, et 15 à 20 minutes sur la partie EMC. Une bonne gestion du temps est essentielle pour ne pas bâcler les dernières réponses.
Le sujet de géographie : les espaces productifs
Focus sur la « vallée de la batterie »
En géographie, les candidats ont étudié deux documents centrés sur la région Hauts-de-France, surnommée la « vallée de la batterie ». Cette zone se distingue par l’installation de gigafactories, ces usines spécialisées dans la production de batteries électriques.
Les questions posées
- Définir ce qu’est une gigafactory.
- Identifier les acteurs impliqués dans le développement de cet espace (publics et privés).
- Situer précisément la vallée de la batterie sur le territoire.
- Caractériser cet espace productif industriel.
- Expliquer les atouts et dynamiques économiques de cette région.
Une étude qui met l’accent sur l’aménagement du territoire
Les élèves devaient montrer que cet espace bénéficie de ressources logistiques, humaines et politiques importantes, et que l’implantation des industries est soutenue par les collectivités locales et l’État.
Le sujet d’histoire : l’indépendance d’une colonie
Un classique du programme de troisième
Les collégiens devaient rédiger un développement construit d’une vingtaine de lignes sur le processus d’indépendance d’une colonie de leur choix. Le sujet leur demandait de présenter les étapes majeures, les principaux acteurs et les conséquences de cette décolonisation.
Exemples souvent traités
Deux sujets reviennent fréquemment : l’Inde, avec Gandhi et la partition de 1947, et l’Algérie, avec la guerre d’indépendance et les accords d’Évian de 1962. Ces exemples permettent d’aborder à la fois la résistance locale et la réaction des puissances coloniales.
Une deuxième partie sur les repères historiques
Les élèves devaient également placer des événements sur une frise chronologique ou analyser des objets historiques (comme des pièces commémoratives). Cela testait leur capacité à mobiliser leurs connaissances chronologiques sur des événements mondiaux majeurs depuis 1945.
Le sujet d’EMC : égalité femmes-hommes
Des documents pour réfléchir et agir
Le sujet reposait sur deux documents : une affiche de sensibilisation à l’égalité filles-garçons dans les études scientifiques, et un extrait de la Constitution rappelant le principe d’égalité devant la loi. À partir de ces éléments, les élèves devaient répondre à plusieurs questions, puis rédiger un discours pour le 8 mars.
Un discours engagé attendu
Dans ce discours, il fallait montrer que des inégalités de genre persistent, tout en proposant deux actions concrètes à mener dans leur collège pour sensibiliser à ce sujet. Par exemple : organiser une exposition sur les femmes scientifiques ou inviter une professionnelle du numérique à témoigner.
Une épreuve stratégique dans la course aux mentions
Cette épreuve d’histoire-géo et EMC vaut 50 points sur les 800 du diplôme national du brevet. Une bonne note dans cette matière peut vraiment booster la moyenne générale, surtout pour viser une mention bien ou très bien.
Une fois l’épreuve terminée, les élèves peuvent consulter les corrigés complets sur différents sites spécialisés. Ces corrections détaillées permettent de vérifier ses réponses, de mieux comprendre ce qui était attendu, et de préparer sereinement les épreuves suivantes comme les sciences.