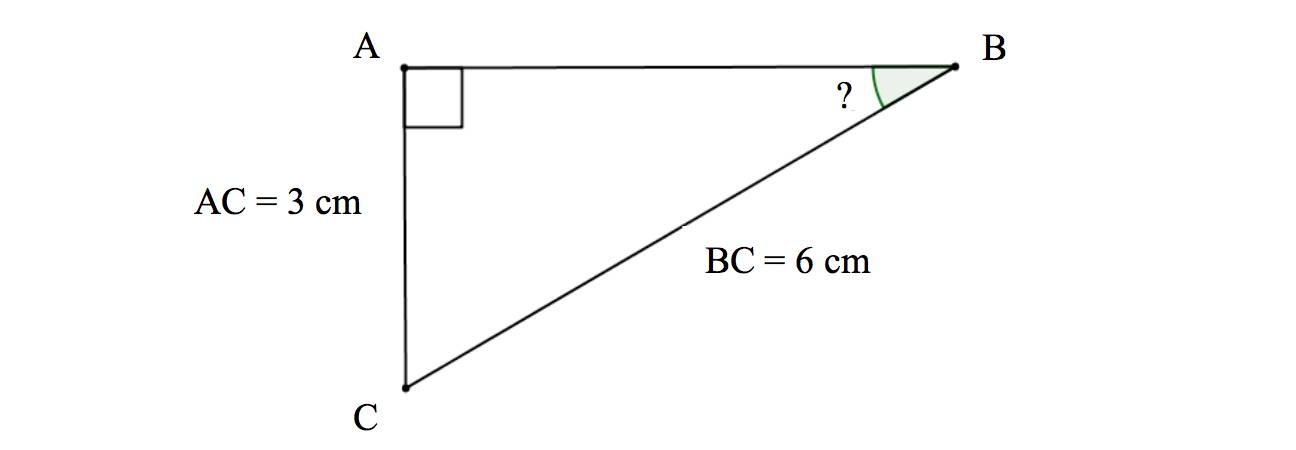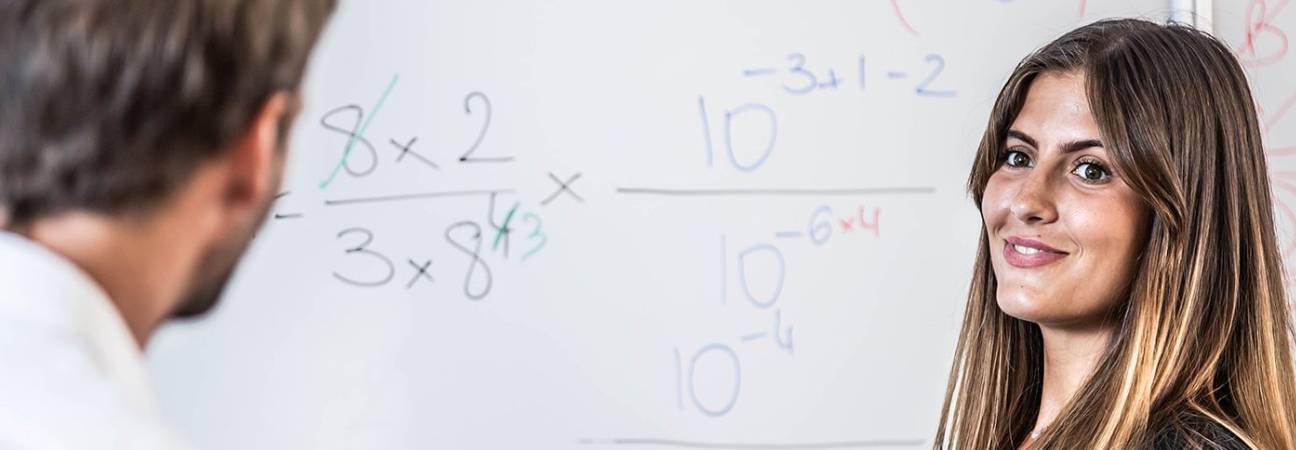Une progression globale depuis les années 1990
Des chiffres qui grimpent au fil des décennies
En 1991, le taux de réussite au brevet tournait autour de 65 %. À cette époque, les épreuves étaient moins structurées qu’aujourd’hui, et le contrôle continu n’avait pas encore le poids qu’on lui connaît aujourd’hui. Progressivement, le taux s’est amélioré, atteignant 75,2 % en 1999.
En 2010, on franchit un cap avec plus de 81 % d’élèves admis. En 2016, le brevet enregistre un record avec 87,3 % de réussite. Cette évolution peut s’expliquer par plusieurs facteurs : des dispositifs d’aide renforcés, une meilleure préparation en classe de troisième et une part de contrôle continu de plus en plus importante.
Zoom sur la décennie 2010-2020
Durant cette période, les taux de réussite sont restés élevés, oscillant entre 85 % et 88 %. En 2018, le ministère annonce un taux de 87,2 %, un chiffre stable qui semble valider les réformes engagées. Pourtant, plusieurs voix s’élèvent pour pointer une certaine baisse d’exigence.
« L’absence de toute exigence dans la connaissance de la grammaire semble extrêmement inquiétante » — Rapport du SNES, 2013.
Des critiques récurrentes émergent, notamment sur le niveau des épreuves de français ou d’histoire-géographie jugées trop faciles, voire « simplifiées » selon certains enseignants.
Classement des taux de réussite par année
| Année | Taux de réussite (%) |
|---|---|
| 1991 | 72,8 |
| 1992 | 73,5 |
| 1993 | 72,2 |
| 1994 | 73,1 |
| 1995 | 73,5 |
| 1996 | 74,7 |
| 1997 | 74,3 |
| 1998 | 73,8 |
| 1999 | 74,7 |
| 2000 | 77,9 |
| 2001 | 77,8 |
| 2002 | 78,2 |
| 2003 | 78,0 |
| 2004 | 78,9 |
| 2005 | 79,1 |
| 2006 | 78,7 |
| 2007 | 81,7 |
| 2008 | 82,1 |
| 2009 | 82,7 |
| 2010 | 83,5 |
| 2017 | 89,2 |
| 2018 | 87,5 |
| 2019 | 86,6 |
| 2020 | 90,5 |
| 2021 | 89,0 |
| 2022 | 88,7 |
| 2023 | 90,3 |
| 2024 | 86,8 |
L’impact du contrôle continu sur les résultats
Un poids de plus en plus important
Depuis la réforme Blanquer, le brevet est noté sur 800 points, dont 400 issus du contrôle continu. Cela signifie qu’un élève ayant de bons résultats tout au long de l’année peut valider le brevet, même avec des épreuves finales moyennes.
Ce système a mécaniquement fait grimper les taux de réussite. Pourtant, il ne gomme pas les disparités territoriales.
Des écarts marqués selon les académies
En se basant uniquement sur les épreuves finales, le Conseil national d’évaluation du système scolaire a observé une chute du taux de réussite dans certaines zones sensibles :
- 57,5 % dans les quartiers très favorisés d’Île-de-France
- 24,3 % dans les zones cumulant précarité et difficultés scolaires
Des chiffres qui montrent que le contrôle continu permet de lisser les résultats, mais ne reflète pas toujours les écarts réels de niveau.
Les taux de réussite récents (2021-2025)
Une stabilité globale jusqu’en 2023
Les données récentes montrent des taux relativement constants :
- 2021 : 88 %
- 2022 : 87,5 %
- 2023 : 87,7 %
Les résultats demeurent élevés malgré une période marquée par les effets post-Covid. Le système éducatif semble avoir absorbé les perturbations liées à la pandémie.
Une baisse marquée en 2024
En 2024, le taux global tombe à 85,6 %. En série générale, il s’établit à 86,8 % et en série professionnelle à 75,1 %. Cette chute s’explique par la fin des « correctifs académiques ».
« Une mesure du choc des savoirs visant à restituer des notes plus fidèles au niveau réel des élèves. »
Cette réforme a clairement impacté les notes, les rendant moins généreuses, mais peut-être plus représentatives du niveau réel des élèves.
Mentions et reconnaissance symbolique
En 2024, environ 70 % des admis décrochent une mention :
- 26 % mention « très bien »
- 23,1 % mention « bien »
- 20 % mention « assez bien »
Les mentions ne servent pas à accéder à la seconde, mais elles peuvent débloquer une bourse au mérite pour les élèves boursiers. Cette aide peut aller jusqu’à 1 002 € par an, versés en trois fois.
Les filles réussissent mieux que les garçons au brevet. En 2016, 90 % des filles étaient admises, contre 84,3 % des garçons. Une tendance qui se confirme dans les années suivantes.
Un diplôme de moins en moins déterminant ?
Obtenir le brevet n’est pas une condition pour passer en seconde, ni pour entrer en CAP. Les résultats sont publiés après les affectations lycée, ce qui rend le diplôme presque symbolique pour la suite du parcours scolaire.
Le brevet est un diplôme de niveau 3, encore requis pour certains concours de la fonction publique de catégorie C : surveillant pénitentiaire, agent du Trésor, ou encore policier municipal. Il reste donc un atout pour ceux qui souhaitent intégrer la fonction publique sans diplôme supérieur.