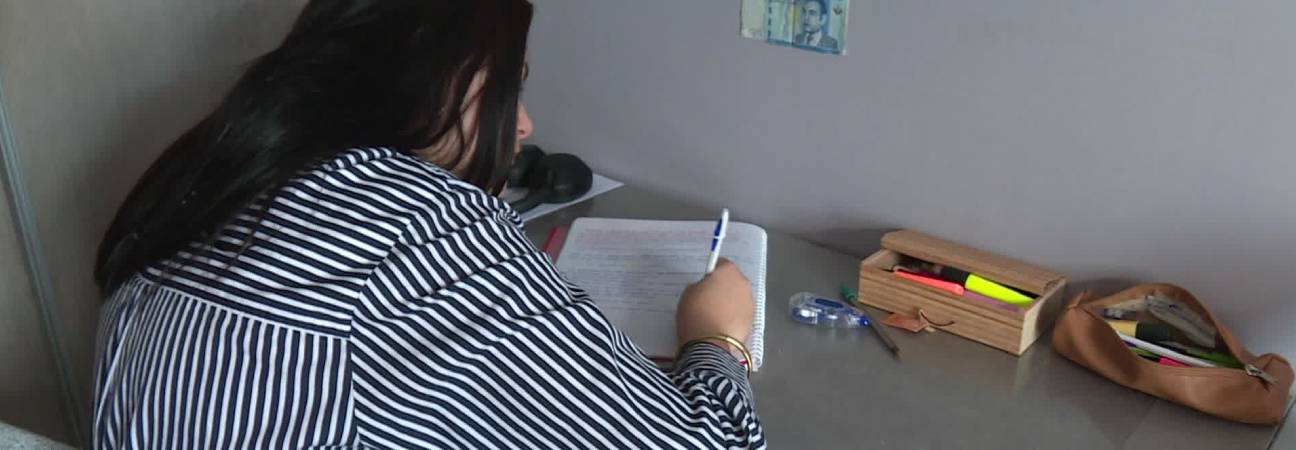Entre 2016 et 2023, les régions de France ont versé un total impressionnant de 1,2 milliard d’euros en subventions supplémentaires aux établissements d’enseignement privé sous contrat, selon une enquête approfondie de Mediapart. Ce montant vient s’ajouter aux 3 milliards d’euros que la loi impose déjà à ces collectivités de verser, mettant en lumière une pratique légale mais controversée, surtout dans un contexte de restrictions budgétaires pour l’enseignement public.
Une manne financière pour les lycées privés
Ces subventions exceptionnelles, bien que légales, soulèvent des questions sur l’équité et la transparence dans le financement de l’éducation en France. Selon la législation en vigueur, les régions doivent financer les frais de fonctionnement de tous les lycées, qu’ils soient publics ou privés, via le forfait d’externat. Toutefois, elles ont également la possibilité de financer des dépenses supplémentaires, comme la rénovation énergétique, les équipements sportifs, ou encore les aides sociales pour les frais de scolarité. C’est ainsi que 1,2 milliard d’euros ont été injectés dans des lycées privés, au-delà des obligations légales, entre 2016 et 2023.
Ce montant supplémentaire, représentant un bonus de plus d’un tiers par rapport aux sommes légalement dues, bénéficie principalement à des établissements privés qui sélectionnent leurs élèves et visent un public socialement favorisé, échappant aux contraintes imposées aux lycées publics, comme la mixité sociale ou la carte scolaire.
Des régions de droite en tête de file
Les régions dirigées par la droite se démarquent particulièrement par leur générosité envers les établissements privés. Auvergne-Rhône-Alpes, sous la présidence de Laurent Wauquiez, se classe en tête avec 261 millions d’euros de subventions supra-légales, suivie de près par les Pays de la Loire, dirigée par Christelle Morançais, avec 234 millions d’euros. En termes de financement par élève, c’est la Bretagne, sous la gouvernance du socialiste Loïg Chesnais-Girard, qui arrive en tête avec une subvention moyenne de 5 610 euros par lycéen privé.
Ces chiffres révèlent une tendance claire : les régions à gouvernance de droite tendent à favoriser les établissements privés, souvent catholiques, par des subventions importantes, dépassant largement leurs obligations légales. Cette pratique, si elle est permise par la loi, soulève des interrogations sur l’utilisation des fonds publics, surtout dans un contexte où l’enseignement public fait face à des difficultés croissantes.
Une répartition inéquitable des ressources
L’octroi de ces subventions à l’enseignement privé renforce une concurrence déloyale entre le public et le privé. Alors que les établissements privés voient leurs moyens augmenter, les lycées publics, notamment en Île-de-France, continuent de souffrir de bâtiments obsolètes et de moyens insuffisants. Cette iniquité dans la distribution des ressources publiques contribue à aggraver la ségrégation sociale et scolaire, à rebours des principes d’égalité et de mixité sociale que l’école publique est censée défendre.
De plus, ces subventions sont parfois attribuées à des établissements privés malgré des manquements graves aux obligations légales, comme le non-respect de la laïcité ou des programmes scolaires. Le soutien financier à des établissements comme le lycée Sainte-Geneviève de Versailles ou le lycée Stanislas, qui ont reçu respectivement 1,6 million et 1,5 million d’euros, malgré des enquêtes administratives pour des comportements inadéquats, est particulièrement controversé.
Une pratique légale mais contestée
Bien que ces subventions soient légales, leur ampleur et leur répartition posent des problèmes d’équité et de transparence. Mediapart révèle que l’ampleur de ces financements complémentaires, bien qu’autorisé par la loi, n’avait jamais été quantifiée avant cette enquête. Cela soulève des questions sur la transparence et la surveillance des fonds publics, notamment lorsque ces sommes sont attribuées à des établissements déjà privilégiés.
La gestion opaque de ces subventions crée un déséquilibre qui favorise l’enseignement privé, renforçant son attractivité et sa capacité à offrir des infrastructures de pointe, tandis que l’enseignement public est souvent contraint de faire plus avec moins. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans un contexte où l’école publique, confrontée à des défis grandissants, voit ses ressources diminuer.
Plusieurs régions ont fait le choix d’augmenter les subventions à l’enseignement privé, souvent sous le couvert de la défense de la liberté de choix des parents. Cependant, cette décision est avant tout idéologique, favorisant un enseignement qui, de fait, s’adresse à une élite sociale, renforçant ainsi l’entre-soi.
Le cas de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes est emblématique de cette politique. En allouant des centaines de milliers d’euros à la modernisation de l’établissement La Chartreuse en Haute-Loire, il a choisi de privilégier des investissements dans des infrastructures déjà bien dotées, alors que de nombreux établissements publics restent sous-équipés et délabrés. Cette approche met en lumière une vision conservatrice de l’éducation, où l’égalité des chances passe au second plan.
Face à ces pratiques, l’État doit reprendre la main pour garantir une utilisation plus équitable des fonds publics. Il est nécessaire de réguler les subventions versées aux établissements privés, en les conditionnant à des critères de mixité sociale et en assurant une transparence totale dans leur attribution. La formule « école publique, argent public ; école privée, argent privé » doit devenir une réalité pour préserver les valeurs républicaines d’égalité et de justice sociale dans l’éducation.