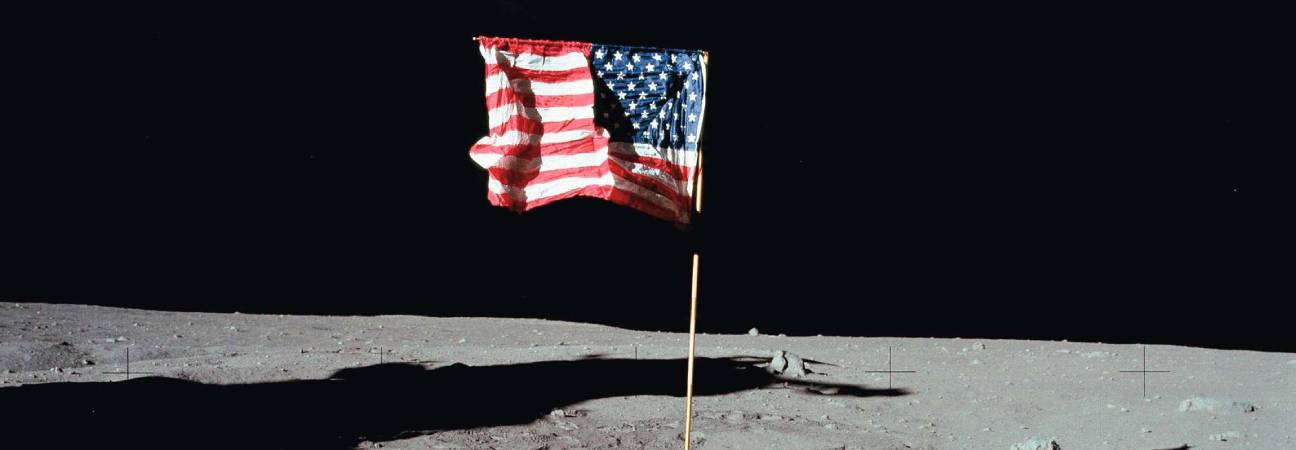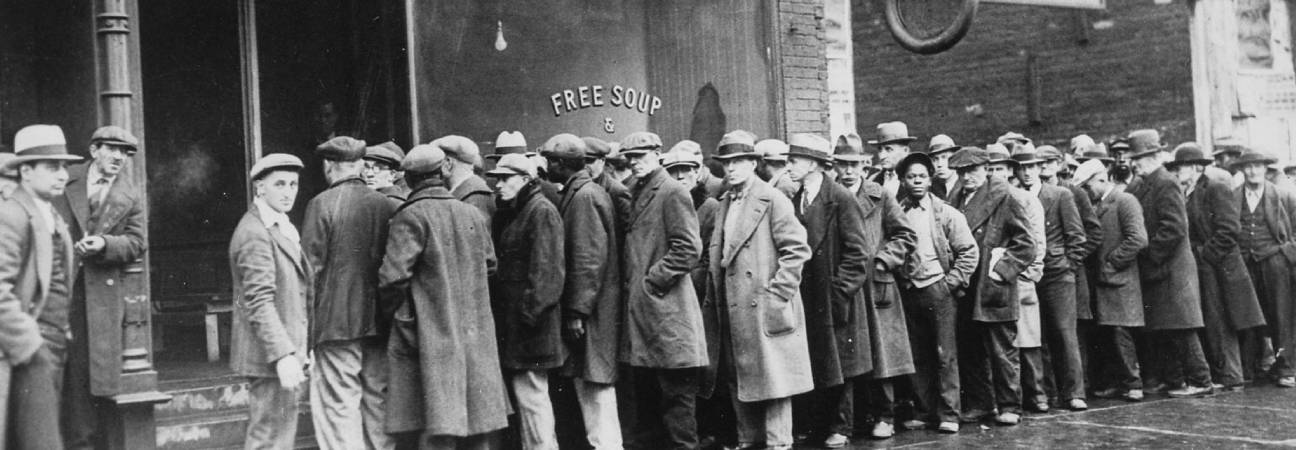Un conflit colonial d’une intensité unique
Une guerre de décolonisation violente
La guerre d’Algérie débute le 1er novembre 1954, avec une série d’attentats organisés par le FLN (Front de libération nationale). La France, qui considère l’Algérie non pas comme une colonie mais comme un territoire français, refuse l’indépendance réclamée par une partie croissante de la population algérienne.
Pendant huit ans, une guerre asymétrique s’installe, marquée par des attentats, des embuscades, une répression militaire massive et l’usage systématique de la torture. Les appels du contingent, jeunes Français mobilisés pour le service militaire, deviennent les témoins et les acteurs de cette guerre brutale.
Des populations opposées dans un même territoire
Les tensions opposent plusieurs groupes :
- les pieds-noirs, colons européens installés depuis plusieurs générations ;
- les Algériens musulmans, souvent déshérités et exclus des droits politiques ;
- les harkis, Algériens engagés aux côtés de l’armée française ;
- les soldats français, parfois engagés, souvent appelés.
La guerre d’Algérie fait tomber la IVe République et provoque le retour au pouvoir du général de Gaulle. En 1959, il reconnaît le droit à l’autodétermination. L’indépendance est finalement acquise le 5 juillet 1962, après la signature des accords d’Évian.
Des mémoires multiples et conflictuelles
La mémoire officielle : le silence politique
En France, l’État choisit dans un premier temps le silence. On parle d’« opérations de maintien de l’ordre », et non de guerre. Les lois d’amnistie votées dans les années 1960 et 1980 enterrent les responsabilités. Le sujet est écarté des manuels scolaires, les archives restent fermées. Les premières commémorations officielles n’apparaissent qu’au tournant des années 2000.
La mémoire des pieds-noirs : une nostalgie douloureuse
Les rapatriés d’Algérie, plus d’un million, arrivent en métropole avec le sentiment d’avoir été abandonnés. Leur intégration est difficile. Beaucoup conservent la nostalgie de l’Algérie perdue, appelée la « Nostalgérie« . Cette mémoire reste vivace, parfois politisée.
La mémoire des harkis : une trahison jamais oubliée
Les harkis, considérés comme traîtres par le FLN, ont été abandonnés par la France. Beaucoup ont été massacrés en Algérie, d’autres parqués dans des camps en France, dans l’indifférence générale. Il faut attendre les années 2000 pour que leur rôle soit publiquement reconnu.
La mémoire militante : refus de l’oubli
Des intellectuels, des historiens, des militants dès les années 60 et 70 dénoncent les pratiques de guerre, notamment la torture. Des ouvrages comme La question d’Henri Alleg ou La torture dans la République de Pierre Vidal-Naquet remettent la guerre sur le devant de la scène.
La mémoire algérienne : une unité mise en scène
En Algérie, le FLN au pouvoir dès l’indépendance construit une mémoire officielle du conflit : une lutte héroïque et unitaire contre la France. Les divisions internes, les violences du FLN, les rôles des Kabyles ou du MNA sont volontairement passés sous silence. L’histoire enseignée dans les écoles algériennes est encore aujourd’hui très orientée.
Un tournant dans les années 1990-2000
L’ouverture des archives
Dans les années 1990, les premières archives militaires et gouvernementales sont ouvertes aux chercheurs. Cela permet un travail historique rigoureux, nourri par les faits. L’État commence à assumer certaines de ses responsabilités.
Les reconnaissances officielles
En 1999, la France reconnaît officiellement qu’il s’agit bien d’une guerre. En 2001, le massacre du 17 octobre 1961 est commémoré publiquement pour la première fois par Bertrand Delanoë. En 2012, François Hollande parle de « souffrances infligées » aux Algériens. En 2021, Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de l’État dans la mort de Maurice Audin et Ali Boumendjel.
Le rapport Stora et la question de la réconciliation
Commandé par Emmanuel Macron en 2020, le rapport Stora propose des pistes pour apaiser les mémoires. Il encourage la reconnaissance, l’éducation, la coopération scientifique entre les deux pays. Ce rapport est bien reçu en France, mais froideusement accueillis par l’Algérie, qui demande toujours des excuses officielles.
La guerre d’Algérie dans la société d’aujourd’hui
Des cicatrices toujours visibles
Près de 5 millions de personnes en France sont concernées directement ou indirectement par la guerre d’Algérie : pieds-noirs, harkis, enfants d’immigrés, anciens appelés. Le passé colonial reste très présent dans les débats contemporains sur l’identité, le racisme, ou la place de l’islam en France.
Le rôle de l’école et des médias
Depuis les années 2000, le conflit est abordé dans les programmes scolaires. Des films, des séries documentaires, comme En guerre(s) pour l’Algérie (2022), participent à une diffusion médiatique plus large de cette histoire. Le témoignage de toutes les mémoires est valorisé.
Le travail des historiens : une mission d’utilité publique
Les historiens contemporains ont pour mission de croiser les sources, recueillir les témoignages, analyser les discours mémoriels. Ils permettent à la société de comprendre les zones d’ombre du passé. Leur travail n’est pas de juger, mais d’éclairer. C’est une histoire exigeante, mais nécessaire pour faire évoluer les mentalités.
Une mémoire toujours vive
La guerre d’Algérie reste une plaie ouverte, car ses enjeux continuent de traverser la société française. La pluralité des mémoires reflète la complexité du conflit, et rappelle que l’histoire n’est jamais figée. Elle vit à travers les générations, les témoignages, les recherches, les questions toujours en suspens.