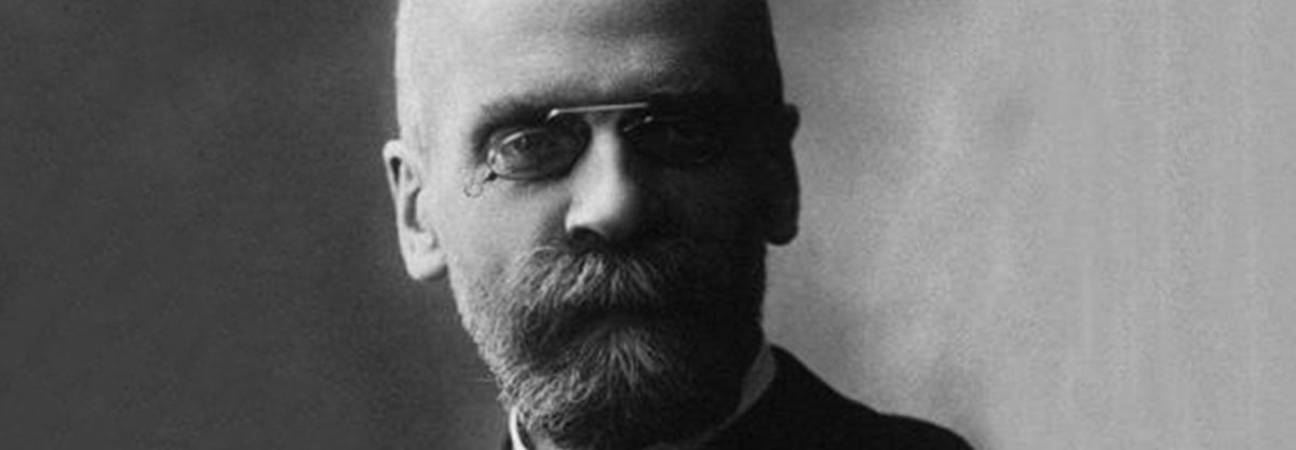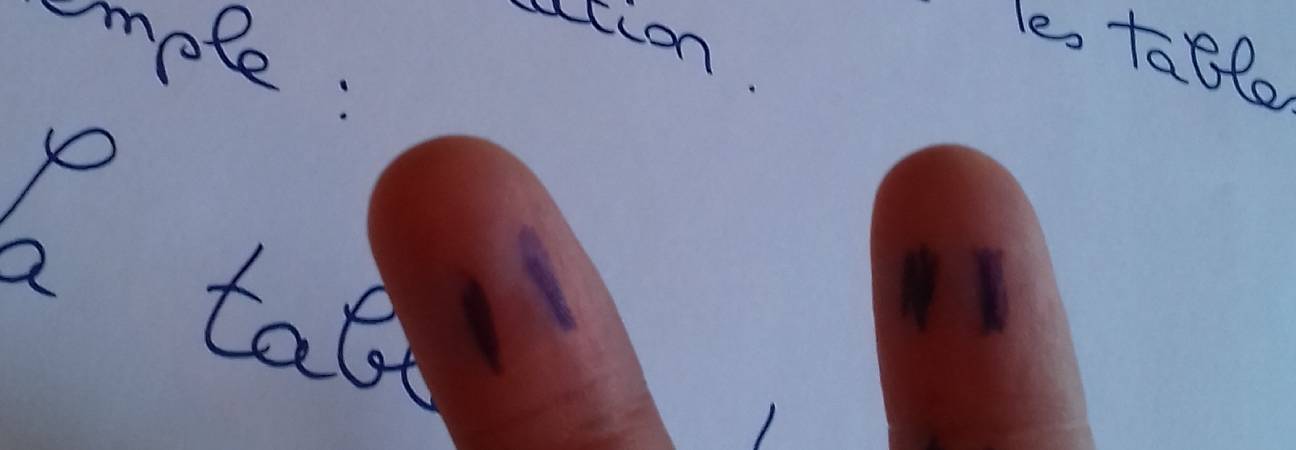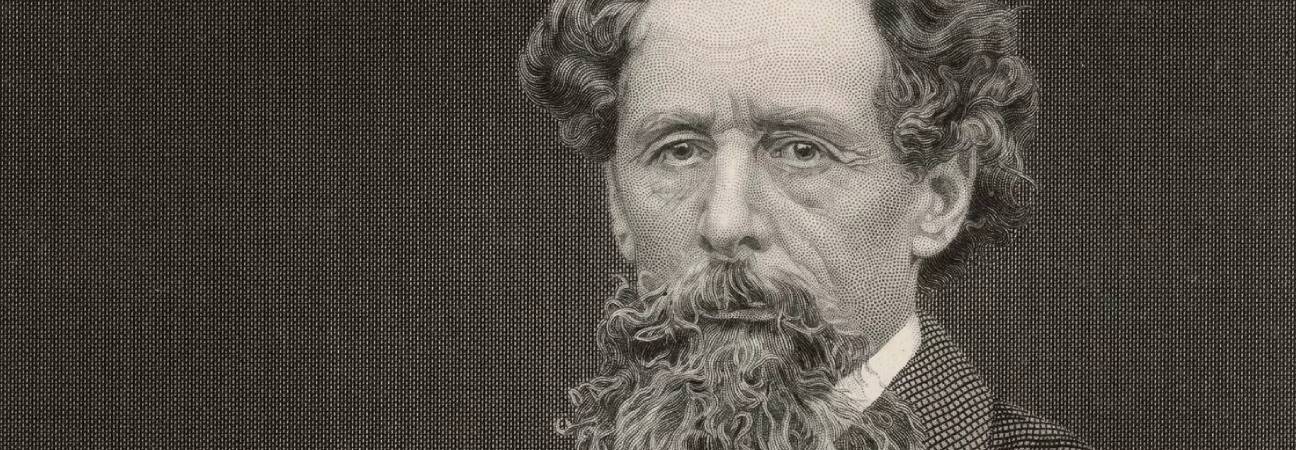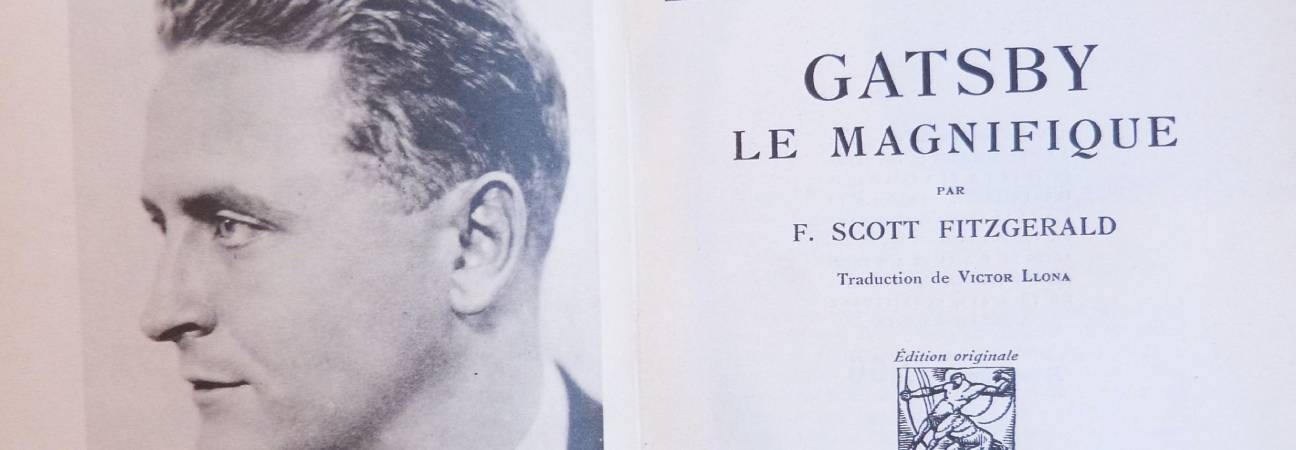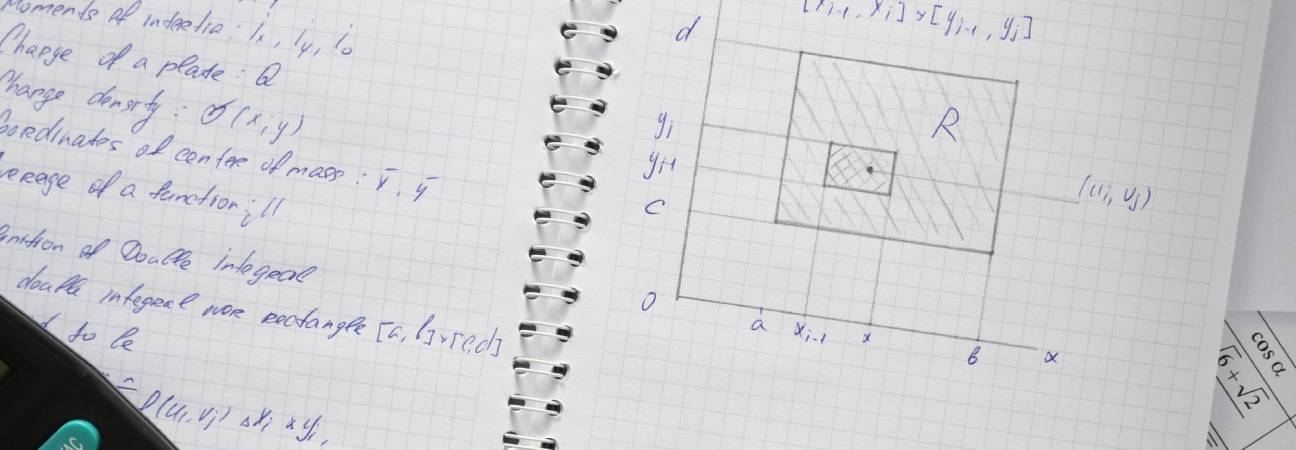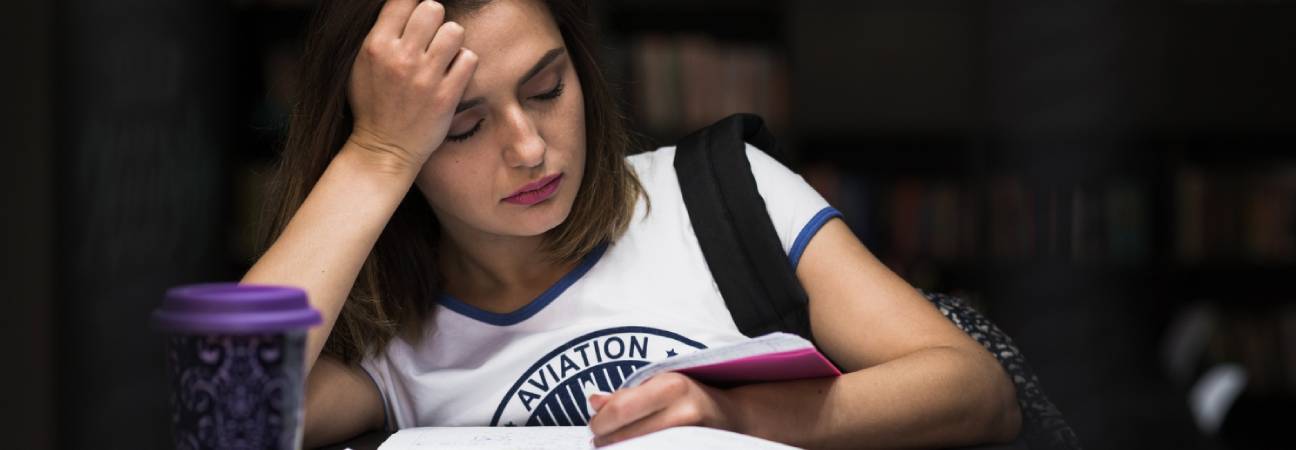Les formes de la solidarité sociale selon durkheim
La division du travail et la solidarité
Dans son ouvrage De la division du travail social, Durkheim examine comment la division du travail influence les relations entre les individus. Il identifie deux formes principales de solidarité : la solidarité mécanique et la solidarité organique. Ces concepts permettent de comprendre comment la société maintient sa cohésion malgré les différences et les spécialisations croissantes entre les individus.
- Solidarité mécanique : Cette forme de solidarité caractérise les sociétés traditionnelles, où les individus sont reliés par des similitudes. Les membres de la société partagent les mêmes croyances, valeurs et normes. La conscience collective est très forte et impose des pratiques uniformes. Dans ce type de société, le lien social est puissant et la cohésion est assurée par la conformité de chacun aux normes collectives. Ceux qui s’écartent de ces normes sont sévèrement sanctionnés.
- Solidarité organique : Elle est propre aux sociétés modernes, où la division du travail est plus développée. Les individus sont reliés par leurs différences et leur complémentarité. Chacun occupe une place spécifique dans la société, ce qui les rend interdépendants. La conscience collective est moins forte, car la conscience individuelle prime. Les individus ne sont plus unis par des similitudes, mais par la nécessité de coopérer pour le bien-être de l’ensemble de la société.
Le lien social et l’intégration
Le lien social est essentiel pour maintenir la cohésion de la société. Il s’agit de l’ensemble des relations qui relient les individus les uns aux autres et leur permettent de s’intégrer dans la collectivité. Selon Durkheim, la division du travail, en plus de sa fonction économique, joue un rôle crucial dans la création de ce lien social. Elle détermine une partie des relations entre les individus et contribue à leur intégration.
L’intégration sociale peut être envisagée sous deux angles :
- L’intégration de la société : Il s’agit de la capacité d’un groupe social à maintenir une cohésion suffisante. Une société est dite intégrée lorsqu’il existe des liens stables et forts entre les individus qui la composent.
- L’intégration dans la société : Elle désigne la situation d’un individu ou d’un groupe au sein d’une collectivité. Un individu est intégré lorsqu’il occupe une place reconnue dans la société et se considère comme partie prenante de celle-ci.
Durkheim souligne également l’importance des règles dans les groupes et leur application. Dans les sociétés modernes, la conscience individuelle prend le pas sur la conscience collective, entraînant une transition de la solidarité mécanique vers la solidarité organique.
L’individualisme et ses conséquences
La remise en cause des liens sociaux
Avec le développement des sociétés modernes, Durkheim observe un affaiblissement des liens sociaux traditionnels, remplacés par des relations plus individualistes. Cette évolution peut mener à des situations d’anomie, un concept clé dans l’œuvre de Durkheim. L’anomie est un état dans lequel les règles sociales ne régulent plus efficacement les conduites des individus.
Quand la solidarité mécanique s’affaiblit, la régulation sociale devient moins efficace. Les normes et valeurs traditionnelles perdent de leur force, remplacées par de nouveaux faits sociaux plus diversifiés. Les individus peuvent alors ressentir une perte de repères, ce qui peut se traduire par un sentiment de désorientation et un manque d’orientation.
L’individualisme et le lien social
L’individualisme représente un autre aspect de l’évolution des liens sociaux. Pour Durkheim, il ne s’agit pas simplement d’un retrait des individus vis-à-vis de la collectivité. L’individualisme est également un processus d’autonomisation par rapport aux règles collectives. Dans les sociétés modernes, les individus peuvent appartenir à divers « cercles sociaux » (famille, travail, associations, etc.), ce qui leur permet de cultiver leur individualité.
Cependant, Durkheim reconnaît que l’individualisme peut engendrer des risques d’isolement et de désengagement social. L’individu peut s’éloigner des instances de socialisation traditionnelles, ce qui peut affaiblir les liens sociaux. Mais l’individualisme peut aussi être un créateur de liens, en permettant aux individus de choisir librement leurs affiliations et leurs engagements.
Les instances de socialisation et leur évolution
La transformation de la famille
La famille est une instance de socialisation essentielle, où les enfants apprennent les normes et valeurs de la société. Cependant, depuis les années 1970, la structure et les normes familiales ont beaucoup évolué. On observe un recul des mariages, une augmentation des divorces, et un nombre croissant de familles monoparentales et recomposées. Ces transformations reflètent un changement de valeurs, avec une émancipation des femmes et une recherche d’épanouissement personnel plutôt que collectif.
Le rôle de l’école et du travail
L’école joue également un rôle clé dans la socialisation. Elle transmet des savoirs, des qualifications, des normes et des valeurs communes. Pourtant, l’école fait face à des défis, tels que la persistance des inégalités sociales et le lien distendu entre diplômes et emploi. Le travail, de son côté, est un lieu d’intégration sociale. Il contribue à l’identité sociale des individus et à leur reconnaissance. Cependant, les mutations du marché du travail, comme l’augmentation du chômage et la précarité des emplois, affaiblissent cette fonction intégratrice.
Le conflit et le changement social
Le conflit comme indicateur de cohésion sociale
Durkheim voit le conflit comme un indicateur de la cohésion sociale. Une augmentation des conflits signale un défaut d’intégration de la société. Cependant, il reconnaît également que les conflits peuvent renforcer la solidarité et créer de nouvelles relations sociales. Pour lui, le conflit n’est pas seulement pathologique, il peut aussi être une forme particulière de relation sociale qui favorise le dialogue et l’adaptation.
Le conflit comme moteur de changement
Les conflits sociaux peuvent être des vecteurs de changement. Ils révèlent les tensions et les inégalités présentes dans la société, incitant les décideurs politiques à intervenir. Les conflits du travail, par exemple, ont conduit à l’élaboration de lois sociales et à des avancées dans les droits des travailleurs. Les conflits sociétaux, comme les mouvements écologistes ou féministes, ont également contribué à des changements dans les normes et valeurs de la société.
Les idées de Durkheim sur la cohésion sociale et l’individualisme offrent une perspective profonde sur les mécanismes qui régissent les sociétés modernes. En mettant en lumière la complexité des liens sociaux et les défis posés par l’individualisme, Durkheim nous aide à comprendre comment la société évolue et maintient son intégrité face aux transformations et aux conflits.