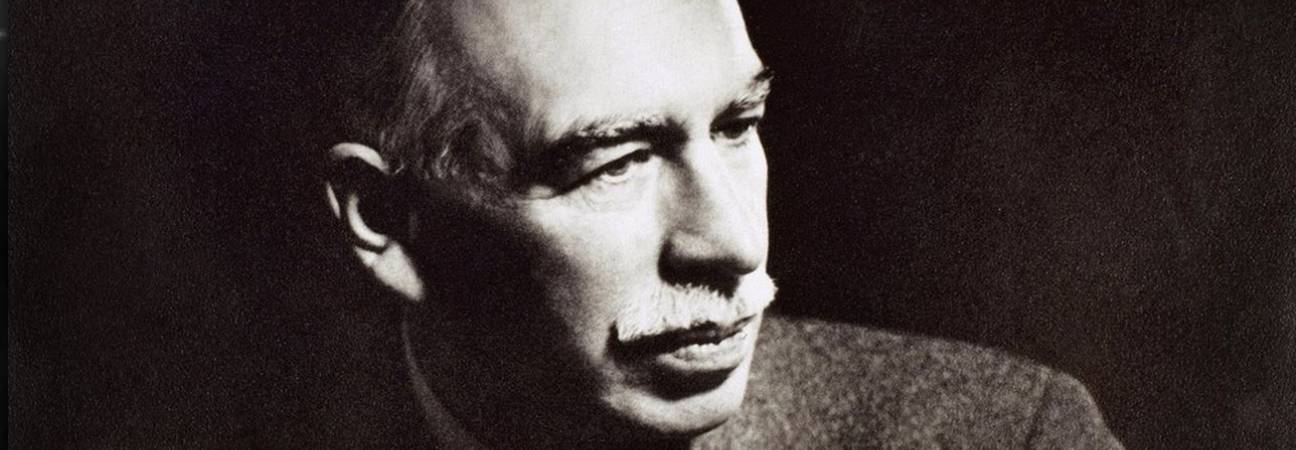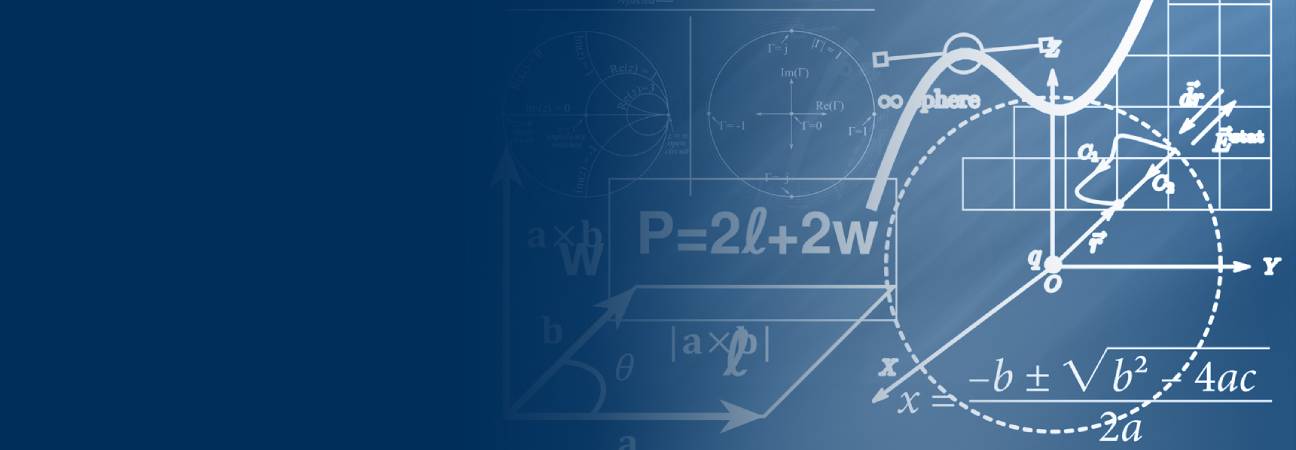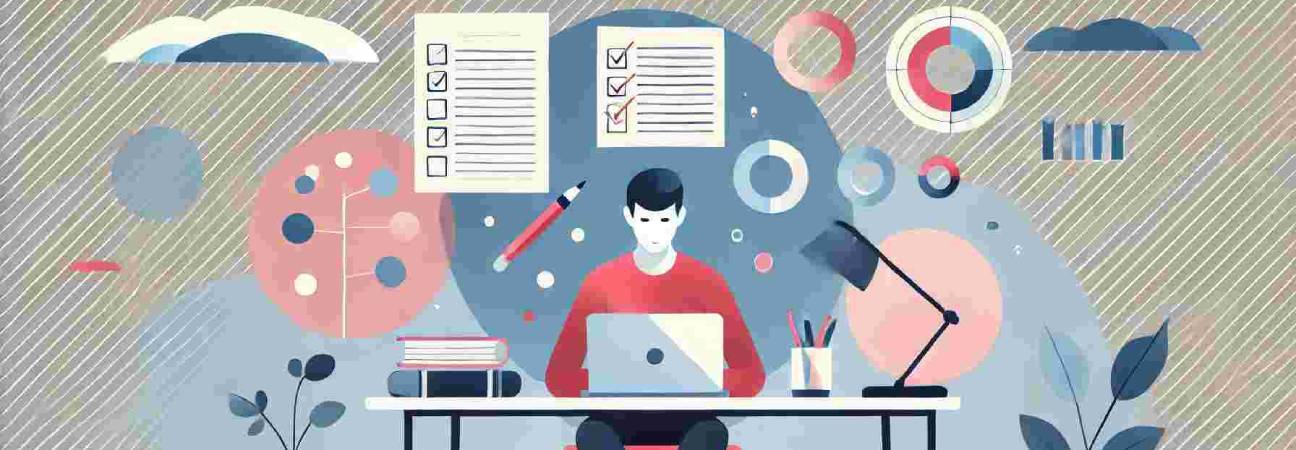Les fondements de la théorie keynésienne
La théorie keynésienne repose sur plusieurs concepts clés. D’abord, Keynes conteste la loi de Say qui soutient que l’offre crée sa propre demande. Il propose une approche inversée où la demande détermine l’activité économique. Selon lui, une insuffisance de la demande effective – la somme de la consommation et des investissements anticipés – conduit à un chômage involontaire et à un équilibre de sous-emploi.
La demande effective est au centre de la pensée keynésienne. Elle désigne la quantité de biens et de services que les entreprises produisent en fonction de leurs anticipations de consommation future. Si cette demande est faible, les entreprises ralentissent leur production, entraînant une baisse de l’investissement et de l’emploi.
Le rôle de l’État dans l’économie
L’une des principales contributions de Keynes est la nécessité d’une intervention active de l’État. Il estime que dans certaines circonstances, comme les périodes de récession, le marché ne peut pas se rétablir seul. L’État doit alors augmenter les dépenses publiques pour stimuler la demande. Cela peut se faire via des investissements dans les infrastructures, des programmes d’aide sociale ou d’autres mesures qui augmentent les revenus des ménages, encourageant ainsi la consommation.
Par ailleurs, Keynes soutient que l’État doit adopter des politiques budgétaires expansionnistes pour relancer l’économie en période de sous-emploi. Contrairement à l’idée néoclassique du budget équilibré, il propose de financer ces dépenses par un déficit temporaire, qui sera comblé par les retombées économiques positives.
Les politiques monétaires doivent également être ajustées pour maintenir des taux d’intérêt faibles, favorisant ainsi le crédit et l’investissement. Une situation où les taux d’intérêt sont si bas que même une politique monétaire expansive ne parvient pas à relancer l’économie est appelée trappe à liquidité.
L’importance de l’investissement et de l’épargne
Keynes accorde une grande importance à l’investissement comme moteur de la croissance. Il note que les anticipations des investisseurs sont cruciales : une confiance faible dans l’avenir peut ralentir les investissements, contribuant à un équilibre de sous-emploi. C’est pour cela que l’intervention de l’État est primordiale pour restaurer la confiance des entrepreneurs en période de crise.
L’épargne, selon Keynes, joue également un rôle majeur. Contrairement aux théories classiques qui voient l’épargne comme bénéfique, il souligne qu’une surépargne peut nuire à l’économie. Lorsqu’une trop grande part des revenus est épargnée au lieu d’être consommée, cela freine la demande globale, réduisant ainsi la production et l’emploi.
Critiques de la théorie keynésienne
La théorie keynésienne n’a pas échappé aux critiques, en particulier de la part des économistes libéraux. Ces derniers reprochent à Keynes de minimiser l’efficacité des marchés et de favoriser une trop grande intervention de l’État. Ils soutiennent que les politiques keynésiennes, notamment l’augmentation des dépenses publiques, peuvent conduire à des problèmes d’inflation et de dette publique.
En période de relance, l’État peut en effet devoir recourir à l’emprunt pour financer ses dépenses, augmentant ainsi le niveau d’endettement. De plus, une intervention publique prolongée pourrait entraîner un effet d’éviction : les fonds utilisés par l’État pour ses investissements seraient indisponibles pour le secteur privé, limitant ainsi l’investissement privé.
L’héritage de Keynes et son influence contemporaine
Keynes est reconnu comme le père de la macroéconomie moderne, ayant profondément influencé les politiques économiques du XXe siècle. Ses idées ont contribué à la mise en place de l’État-providence et ont été appliquées pendant les Trente Glorieuses, une période de croissance soutenue après la Seconde Guerre mondiale.
Des concepts comme l’État-providence, où l’État prend une part active dans la redistribution des richesses et la protection sociale, trouvent leurs racines dans les théories de Keynes. Pendant la Grande Dépression et après la crise financière de 2008, les gouvernements ont de nouveau adopté des politiques keynésiennes pour stimuler la demande.
Lors de la crise du COVID-19, les mesures keynésiennes ont été largement reprises avec des plans de relance massifs, comprenant des aides aux ménages et aux entreprises ainsi qu’une baisse des taux d’intérêt par les banques centrales. Ces politiques ont permis de stabiliser l’économie mondiale face aux impacts de la pandémie.
Cependant, la critique néolibérale reste pertinente. Des économistes comme Milton Friedman, figure du monétarisme, ont mis en avant les risques inflationnistes et les effets négatifs à long terme de l’intervention de l’État, plaidant pour un rôle plus limité du gouvernement dans l’économie.
Les théories de Keynes ont transformé la manière dont nous comprenons l’économie, mettant en avant l’importance de l’intervention publique pour corriger les dysfonctionnements du marché. Néanmoins, ses idées doivent être appliquées avec discernement. Si l’intervention étatique est essentielle en période de crise, elle doit être accompagnée d’une gestion rigoureuse pour éviter des déséquilibres à long terme, comme l’inflation ou un endettement excessif.
Aujourd’hui, les politiques keynésiennes continuent d’influencer les décisions économiques, notamment dans les économies avancées. Le défi pour les gouvernements reste de trouver un équilibre entre l’intervention nécessaire pour stimuler la croissance et la maîtrise des conséquences à long terme, comme la dette et l’inflation.
Les débats autour des idées de Keynes, entre les partisans de l’intervention publique et les défenseurs du libéralisme économique, montrent que sa pensée reste aussi pertinente que jamais.