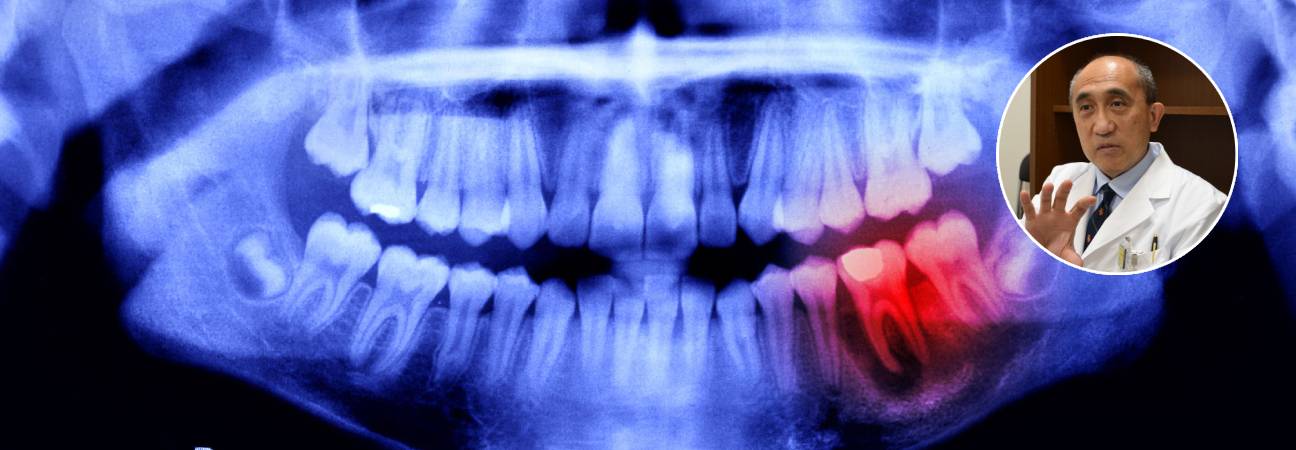Une génération qui dit : « j’oublie tout »
Pendant longtemps, les troubles de la mémoire étaient associés au vieillissement. Pourtant, entre 2013 et 2023, la part d’adultes américains déclarant des difficultés à se concentrer, se souvenir ou prendre des décisions est passée de 5,3 % à 7,4 %. Là où ça surprend vraiment, c’est que la hausse est portée surtout par les 18–39 ans : dans cette tranche d’âge, on passe de 5,1 % à 9,7 %. Autrement dit, presque un jeune adulte sur dix se dit régulièrement gêné par son cerveau qui décroche.
Pour mesurer cette « chute de mémoire », les chercheurs ont utilisé une question simple : « En raison d’un problème physique, mental ou émotionnel, avez-vous de sérieuses difficultés à vous concentrer, à vous souvenir ou à prendre des décisions ? ». Ceux qui répondaient « oui » étaient considérés comme ayant un handicap cognitif. Ce n’est pas un diagnostic médical, mais c’est un bon thermomètre de la manière dont les gens ressentent le fonctionnement de leur cerveau au quotidien.
Ce que montre l’étude en chiffres
Pour y voir plus clair, voici un résumé simplifié des résultats marquants sur dix ans.
| Catégorie | 2013 | 2023 |
|---|---|---|
| Ensemble des adultes | 5,3 % déclarent un trouble cognitif | 7,4 % |
| 18–39 ans | 5,1 % | 9,7 % |
| 70 ans et plus | 7,3 % | 6,6 % (légère baisse) |
| Revenus < 35 000 $/an | 8,8 % | 12,7 % |
| Sans diplôme du secondaire | 11,1 % | 14,3 % |
Derrière ces pourcentages, on voit se dessiner un schéma clair : les moins de 40 ans, les personnes les plus précaires et celles qui ont quitté l’école tôt sont les plus touchées. À l’inverse, les diplômés de l’enseignement supérieur et les revenus les plus élevés restent mieux protégés, même si la tendance est aussi à la hausse.
Pourquoi les jeunes cerveaux décrochent plus vite
Stress, précarité et cerveau sous pression
Les scientifiques ne pointent pas une seule cause, mais un ensemble de facteurs qui se cumulent. D’abord, la situation économique : quand on jongle entre études, loyers qui explosent, petits boulots mal payés ou contrats précaires, le stress chronique devient un mode de vie. Or, le stress prolongé agit directement sur la mémoire et l’attention. Il dérègle le sommeil, favorise l’anxiété, augmente la charge mentale et laisse l’impression d’avoir le cerveau constamment saturé.
Les données montrent d’ailleurs que les jeunes qui gagnent moins de 35 000 dollars par an sont beaucoup plus nombreux à déclarer un handicap cognitif que ceux qui disposent de revenus confortables. Quand l’avenir est flou, qu’on se demande comment payer le mois prochain, il devient plus difficile de retenir un cours, de se concentrer sur un dossier ou simplement de prendre des décisions posées.
Écrans, multitâche et attention en miettes
Autre facteur mis en avant : l’environnement numérique. Notifications permanentes, flux d’infos infini, travail sur écran, messageries et réseaux sociaux ouverts en continu, le cerveau est sollicité dans tous les sens. Il doit passer d’une tâche à l’autre sans répit, souvent dans l’urgence. Or, la mémoire fonctionne mieux quand l’attention est stable. En mode multitâche constant, une partie des informations ne s’encode même pas. Résultat : on a l’impression de « perdre la mémoire », alors qu’en réalité, elle n’a jamais eu le temps d’enregistrer.
Une génération qui ose davantage dire « ça ne va pas »
Les chercheurs rappellent aussi un point positif : les jeunes adultes sont plus à l’aise avec le vocabulaire de la santé mentale et cognitive. Ils repèrent mieux les signaux faibles, parlent plus facilement de fatigue mentale ou de brouillard cérébral, et n’hésitent pas à cocher « oui » quand un questionnaire demande s’ils ont des difficultés à se concentrer. Une partie de la hausse vient donc probablement d’une meilleure sensibilisation, et pas seulement d’un cerveau qui va « plus mal » qu’avant.
« Les troubles de la mémoire et de la pensée deviennent un vrai problème de santé publique chez les adultes, notamment les plus jeunes », résume l’un des auteurs de l’étude.
Faut-il s’inquiéter si on oublie plein de trucs à 25 ou 30 ans ?
Bonne nouvelle : dans la majorité des cas, ces oublis ne signifient pas que le cerveau est en train de dégénérer de façon irréversible. Ils traduisent surtout un mode de vie qui malmène l’attention : manque de sommeil, stress, temps d’écran XXL, absence de pauses réelles, multitâche permanent. Quand on corrige ces paramètres, la mémoire peut clairement s’améliorer.
En revanche, certains signaux méritent d’en parler avec un professionnel de santé : se perdre dans des trajets pourtant connus, oublier systématiquement des rendez-vous importants, ne plus réussir à suivre une conversation simple, ou sentir que ces difficultés s’aggravent rapidement. Même chez les moins de 40 ans, un avis médical est utile pour faire la part entre surmenage, anxiété, dépression ou problème neurologique plus rare.
Six réflexes simples pour chouchouter sa mémoire avant 40 ans
1. Protéger son sommeil comme un rendez-vous important
Le cerveau consolide la mémoire pendant la nuit. Se coucher tous les jours à une heure différente, scroll jusqu’à 2 h du matin et enchaîner sur un réveil brutal, c’est le combo parfait pour flinguer l’attention. Viser 7 à 9 heures de sommeil, avec des horaires réguliers et au moins 30 minutes sans écran avant de dormir, reste l’un des meilleurs hacks pour améliorer sa concentration.
2. Faire une pause aux écrans, même courte
On ne va pas disparaître des réseaux, mais on peut apprendre à les cadrer : notifications coupées pendant le travail, plages sans téléphone (repas, transport, avant de dormir), applications rangées dans des dossiers pour limiter le réflexe d’ouverture compulsive. Offrir de vraies plages de focus au cerveau lui permet de mieux encoder les informations.
3. Simplifier la charge mentale avec des outils externes
La mémoire de travail n’est pas faite pour tout stocker. Utiliser une to-do list, un agenda partagé, des rappels automatiques, ce n’est pas « tricher », c’est libérer de la place pour ce qui compte vraiment. Plus on externalise les petites tâches, plus on garde de ressources pour réfléchir, créer, apprendre.
4. Bouger un peu plus souvent
L’activité physique régulière améliore la circulation sanguine, réduit le stress et soutient les fonctions cognitives. Pas besoin de devenir marathonien : marcher vite 20 à 30 minutes par jour, prendre les escaliers, faire un peu de sport avec des amis suffit déjà à envoyer un signal positif au cerveau.
5. Ne pas sous-estimer l’impact de l’alcool et du tabac
Les données de l’étude montrent que les fumeurs et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires déclarent davantage de troubles cognitifs. Sans tomber dans la morale, réduire l’alcool récurrent et la cigarette quotidienne, c’est aussi un geste pour sa mémoire future.
6. Parler tôt quand ça déraille
Se sentir largué en permanence, saturé d’infos, incapable de se concentrer plus de cinq minutes, ce n’est pas une fatalité. Un médecin généraliste, un psychologue ou un service de santé universitaire peuvent aider à comprendre ce qui se joue : anxiété, burn-out, TDAH non diagnostiqué, dépression masquée… Mettre des mots permet souvent de retrouver des solutions concrètes.
Les moins de 40 ans, une génération à protéger
La phrase « les moins de 40 ans perdent la mémoire plus vite que prévu » fait peur, mais elle dit surtout une chose : notre manière de vivre, d’étudier et de travailler pèse lourd sur le cerveau. Les jeunes adultes sont pris entre précarité, hyperconnexion et pression de performance permanente. Les chiffres de l’étude rappellent qu’il ne s’agit pas juste de « fatigue passagère », mais d’un vrai enjeu de santé publique. À l’échelle individuelle, la marge de manœuvre existe : ralentir un peu, mieux dormir, filtrer les écrans, demander de l’aide quand on sent que la mémoire flanche. À l’échelle collective, le sujet dépasse largement la responsabilisation individuelle et pose une question simple : dans quel environnement la société laisse-t-elle son cerveau grandir, apprendre et se concentrer.