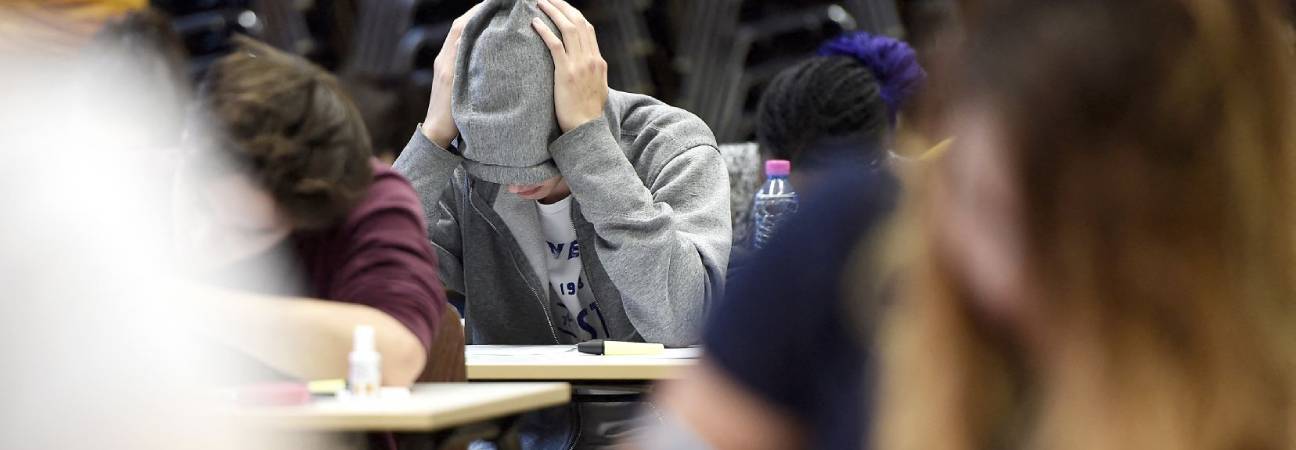Chaque année, 950 000 étudiants entament une licence, mais une grande partie d’entre eux abandonne en cours de route ou met beaucoup plus de temps que prévu pour finir leur cursus. Ce manque d’efficacité coûte cher à l’État : 534 millions d’euros sont engloutis chaque année en redoublements, réorientations et abandons.
Des difficultés structurelles
Plusieurs raisons expliquent cette hémorragie dans l’enseignement supérieur. Parmi elles, le manque d’accompagnement des étudiants. Contrairement à d’autres pays où des dispositifs d’orientation sont mis en place très tôt, en France, la plupart des lycéens se retrouvent projetés à l’université sans préparation réelle.
Les enseignants eux-mêmes, souvent surchargés et peu formés à l’orientation, peinent à guider les jeunes vers des filières qui leur correspondent. Le rôle du professeur principal ne suffit pas, et les étudiants se retrouvent rapidement livrés à eux-mêmes, ce qui explique en partie les taux d’abandon.
Un problème d’accessibilité pour les jeunes en zones rurales
L’université peine à inclure tous les jeunes, en particulier ceux issus de zones rurales. Dans certains départements comme la Haute-Marne, la Meuse ou les Vosges, seuls 20 % des jeunes obtiennent un diplôme du supérieur, contre une moyenne nationale de 32 %.
Le coût des études et la distance avec les centres universitaires constituent un frein majeur. Les bourses actuelles ne prennent pas suffisamment en compte cette inégalité géographique. Pour remédier à cela, la Cour des comptes propose d’adapter les aides en fonction de la distance et de simplifier les démarches via un guichet unique.
Des dispositifs d’accompagnement inefficaces
Malgré les milliards investis pour améliorer la réussite universitaire, les résultats restent décevants. Depuis 2018, la loi « Orientation et Réussite des étudiants » (ORE) a permis d’injecter 1,4 milliard d’euros dans l’enseignement supérieur pour améliorer l’encadrement et la pédagogie. Pourtant, les chiffres montrent que les avancées sont trop lentes.
Des dispositifs comme le tutorat, le mentorat ou encore les parcours progressifs ont été mis en place, mais aucune évaluation claire n’a été faite pour mesurer leur impact réel. Certaines initiatives, comme les « cordées de la réussite », qui accompagnent les lycéens dans leurs études, sont passées de 80 000 bénéficiaires en 2019 à 180 000 en 2023. Pourtant, aucune donnée fiable ne prouve leur efficacité.
Un sous-investissement dans les licences
Le financement des formations universitaires est très inégal. Un étudiant en licence coûte en moyenne 3 700 euros par an à l’État, contre 6 541 euros pour une licence professionnelle et 9 747 euros pour un BUT. Quant aux classes préparatoires, elles bénéficient d’un investissement de 13 400 euros par élève.
Cette différence se traduit directement par un manque de moyens pour encadrer les étudiants en licence, qui se retrouvent souvent dans des amphithéâtres surchargés avec peu de suivi individuel. Face à cette situation, la Cour des comptes estime que « le sous-investissement dans les licences coûte cher, et son rattrapage l’est encore plus« .
Des recommandations pour une réforme urgente
Pour améliorer la réussite universitaire, plusieurs solutions sont mises en avant :
- Renforcer l’accompagnement des étudiants dès leur entrée à l’université.
- Améliorer l’orientation au lycée pour réduire les erreurs de parcours.
- Rééquilibrer les financements pour donner plus de moyens aux licences.
- Prendre en compte la distance géographique dans l’attribution des bourses.
- Mieux évaluer les dispositifs d’aide pour ne garder que les plus efficaces.
Ces mesures pourraient redonner du souffle à l’université française et permettre à plus d’étudiants d’atteindre le diplôme tant convoité.
Lire aussi : les écoles les plus prestigieuses en France