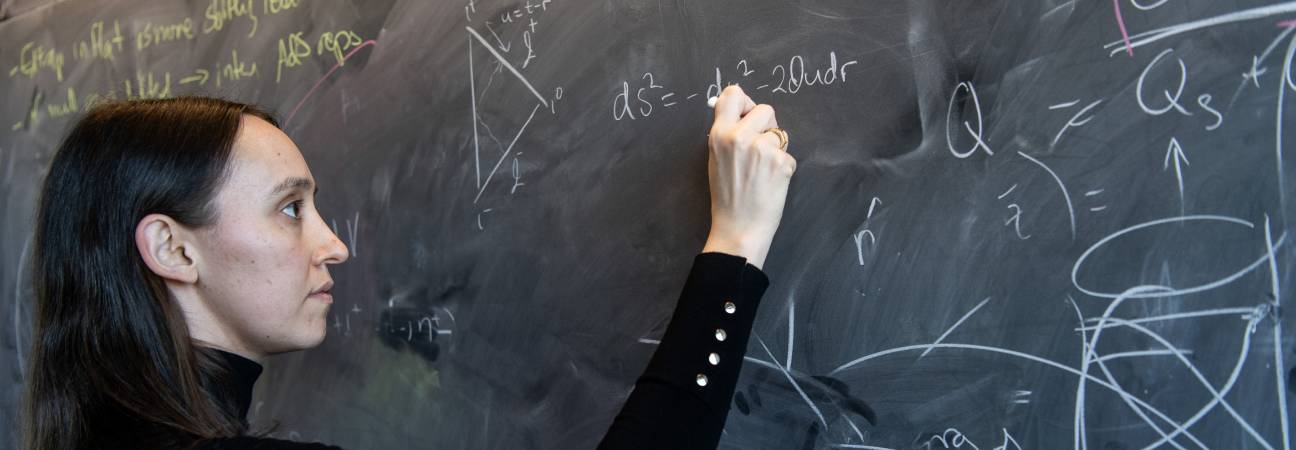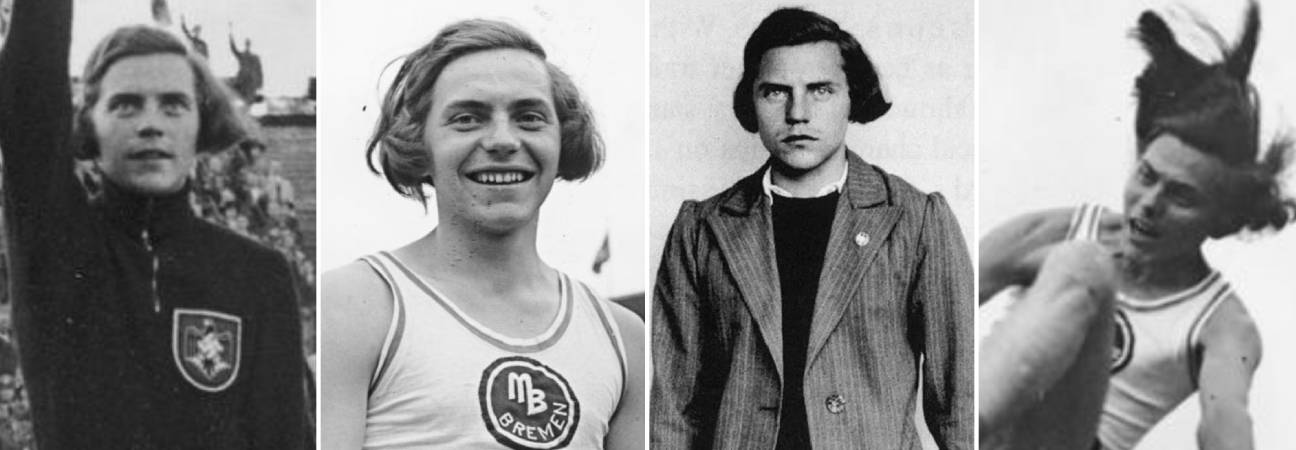1. Le droit de grève (1864)
Avant 1864, faire grève pouvait te coûter ta liberté. Cette année-là, le député Émile Ollivier a fait adopter une loi autorisant les travailleurs à cesser le travail sans risquer la prison. C’est la première pierre du droit à la contestation dans le monde du travail. Sans cette loi, aucun des autres acquis n’aurait pu exister.
2. La reconnaissance des syndicats (1884)
Autre étape clé : la loi Waldeck-Rousseau. Elle autorise la création des syndicats professionnels. Avant ça, toute organisation de salariés était illégale. Cette loi marque le début d’un dialogue social institutionnalisé, où les travailleurs peuvent se regrouper et défendre leurs intérêts collectifs.
3. La journée de huit heures (1919)
Travailler douze heures par jour, six jours sur sept, c’était la norme avant 1919. Grâce à la mobilisation des syndicats, la journée de huit heures et la semaine de 48 heures deviennent la règle. Une avancée énorme pour la santé et la vie personnelle des travailleurs.
4. Les congés payés (1936)
Le Front populaire et les grèves massives de 1936 mènent à une victoire historique : deux semaines de congés payés. C’est la première fois que les travailleurs peuvent partir en vacances tout en continuant à être rémunérés. Un tournant social et culturel majeur.
5. La Sécurité sociale (1945)
Portée par le Conseil national de la Résistance, la création de la Sécurité sociale marque la naissance d’un système de protection universel. Santé, retraite, allocations familiales : chaque citoyen bénéficie d’un accès aux soins et à une couverture en cas de coup dur.
6. Le salaire minimum (1950)
Le SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti) voit le jour en 1950, avant de devenir le SMIC en 1970. Objectif : garantir un salaire décent pour tous, éviter les abus et réduire les inégalités. Les syndicats ont été au cœur de cette revendication.
7. La troisième puis la cinquième semaine de congés (1956 et 1982)
Après 1936, les syndicats continuent le combat pour élargir le droit au repos. Résultat : une troisième semaine en 1956, puis une cinquième en 1982. Aujourd’hui, ces congés semblent évidents, mais ils sont le fruit d’un siècle de mobilisations.
8. La réduction du temps de travail à 35 heures (1998)
La loi Aubry fixe la durée légale hebdomadaire à 35 heures. L’objectif : mieux partager le travail et améliorer la qualité de vie. Cette mesure, encore débattue aujourd’hui, reste une victoire syndicale majeure dans la modernisation du monde professionnel.
9. L’assurance chômage (1958)
Créée pour protéger les salariés en cas de perte d’emploi, l’assurance chômage est une avancée sociale essentielle. Née d’un compromis entre syndicats et patronat, elle incarne la solidarité entre actifs et demandeurs d’emploi. Une idée simple : personne ne doit tomber dans la précarité après un licenciement.
10. La médecine du travail et les droits à la sécurité au travail
Depuis les années 1940, les syndicats se battent pour la protection de la santé au travail. La création de la médecine du travail en 1942 et la reconnaissance des accidents du travail comme une responsabilité patronale ont profondément changé la condition ouvrière. Aujourd’hui encore, les syndicats jouent un rôle clé dans la prévention des risques professionnels.
Pourquoi ces acquis comptent encore aujourd’hui
Ces victoires syndicales ne sont pas des reliques du passé. Elles façonnent encore notre quotidien : le rythme de nos journées, notre sécurité, notre droit au repos. Et elles rappellent que les droits sociaux se défendent, pas seulement une fois acquis.
“Ce que la lutte a gagné, seule la lutte peut le garder.” – slogan syndical des années 70