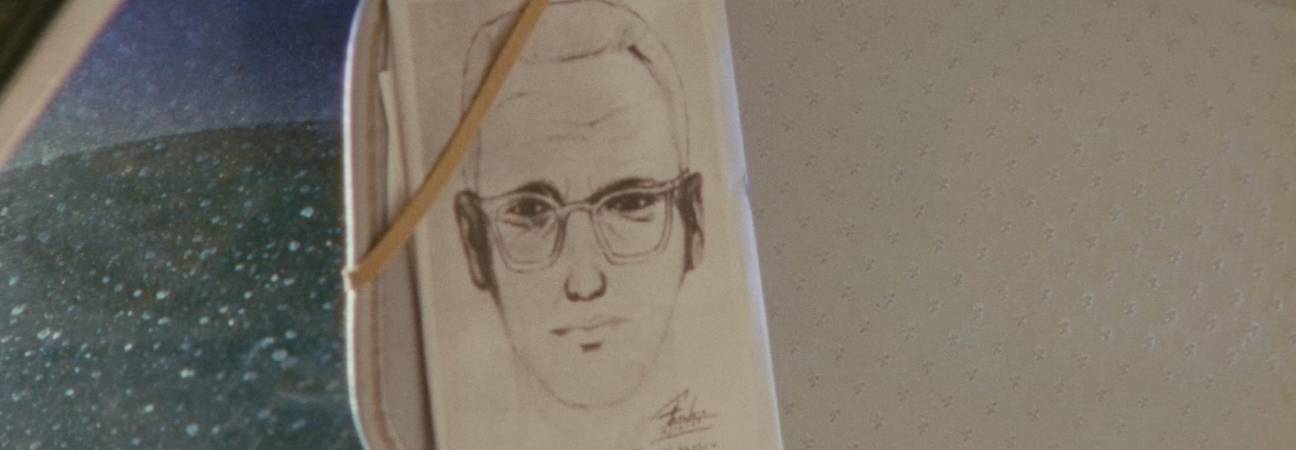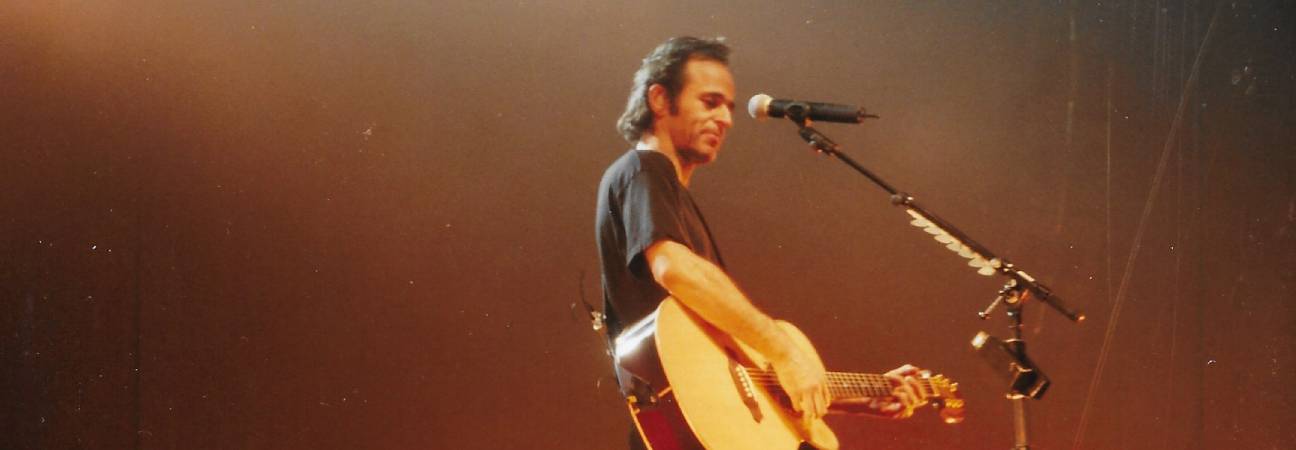Un anniversaire qui bascule en urgence médicale
La journée avait commencé comme une simple virée d’anniversaire entre amies, à Fethiye. En fin d’après-midi, vertiges, maux de tête, jambes qui cèdent. Direction l’hôpital. Les scanners confirment un accident vasculaire cérébral. À l’ouverture des yeux, Cathy découvre une paralysie du côté droit… et une voix qui n’est plus la sienne.
« J’avais une voix britannique, mais je me suis réveillée avec un accent différent. Je ne pense pas que ma voix redevienne comme avant. »
Sa mère est originaire de Thaïlande. L’intonation perçue comme « thaï » pourrait, selon les praticiens, refléter une réorganisation des circuits de la parole, influencée par son histoire personnelle et son environnement affectif. Rien d’ésotérique ici : il s’agit d’un phénomène neurologique.
Qu’est-ce que le syndrome de l’accent étranger ?
Le syndrome de l’accent étranger (Foreign Accent Syndrome) surgit typiquement après une lésion cérébrale : AVC, traumatisme crânien, plus rarement migraine sévère ou trouble fonctionnel. La personne ne « prend » pas volontairement un accent ; son articulation, sa prosodie (rythme, mélodie) et certains sons changent d’une façon qui, à l’oreille des autres, rappelle un accent étranger.
Concrètement : des voyelles se déforment, des consonnes s’aspirent ou se durcissent, les schémas de stress (syllabes accentuées) se déplacent. Le cerveau, en réparation, recrée des raccourcis moteurs pour parler ; le résultat peut ressembler à un accent connu — sans que la personne l’ait appris ni visé.
Rééducation longue : remarcher, puis réapprendre à parler
Après un mois d’hospitalisation en Turquie, Cathy est rapatriée au Royaume-Uni. Deux mois d’hôpital supplémentaires, puis trois mois de rééducation intensive. Elle réapprend à marcher : d’abord aidée par trois personnes et un trépied, puis une béquille, avant de récupérer une autonomie progressive vers l’été 2025.
La voix, elle, résiste. L’orthophonie améliore l’intelligibilité et le souffle, mais ne « remet » pas l’ancienne musicalité. Les spécialistes restent prudents : la récupération vocale est possible, parfois partielle, souvent imprévisible. La priorité est de stabiliser la parole, de réduire la fatigue et de redonner des outils pour se faire comprendre.
Quand la voix touche à l’identité
Parler, c’est aussi se présenter au monde. L’accent porte nos origines, nos appartenances, notre « chez-soi ». Perdre sa voix familière, c’est parfois perdre un repère intime. Cathy le dit sans détour :
« J’ai l’impression d’avoir perdu une partie de mon identité. »
Entourage et collègues doivent composer avec un nouveau son de voix. Le regard des autres, la curiosité, parfois la défiance, s’ajoutent aux efforts de rééducation. Les soignants proposent souvent un accompagnement psychologique pour apprivoiser ce changement durable.
Repères utiles : reconnaître l’AVC, agir vite
Si l’histoire de Cathy intrigue, elle rappelle surtout une évidence : face à un AVC, chaque minute compte. Retenez la règle simple VITE :
- Visage qui s’affaisse (sourire asymétrique)
- Immeubles mots (troubles du langage)
- Trouble d’un bras ou d’une jambe (faiblesse, engourdissement, chute)
- En urgence : appelez les secours sans attendre
Autres signaux : maux de tête fulgurants inhabituels, vertiges, vision double, perte soudaine de la coordination. Même en vacances, même jeune, on appelle. L’AVC ne concerne pas que les seniors.
Pourquoi le cerveau « change d’accent » ?
Plusieurs zones synchronisent la parole : cortex moteur, régions frontales et temporales, insula, voies sous-corticales. Après un AVC, le cerveau tente des détours pour compenser. Ces nouvelles routes modifient la façon dont on enchaîne les sons, les pauses, les intonations. Le résultat peut sembler « étranger ». Ce n’est pas une imitation, mais une reprogrammation motrice.