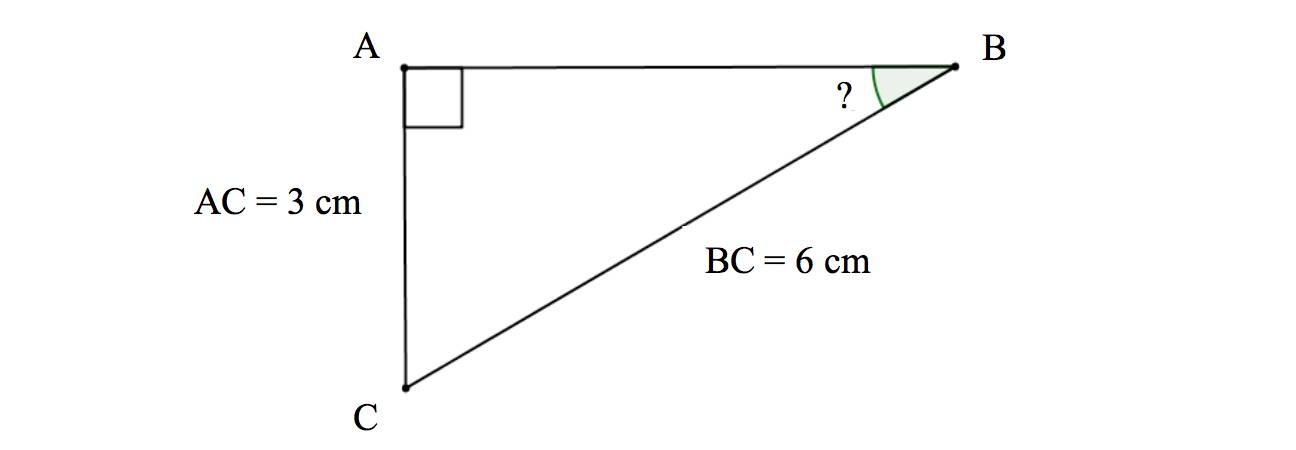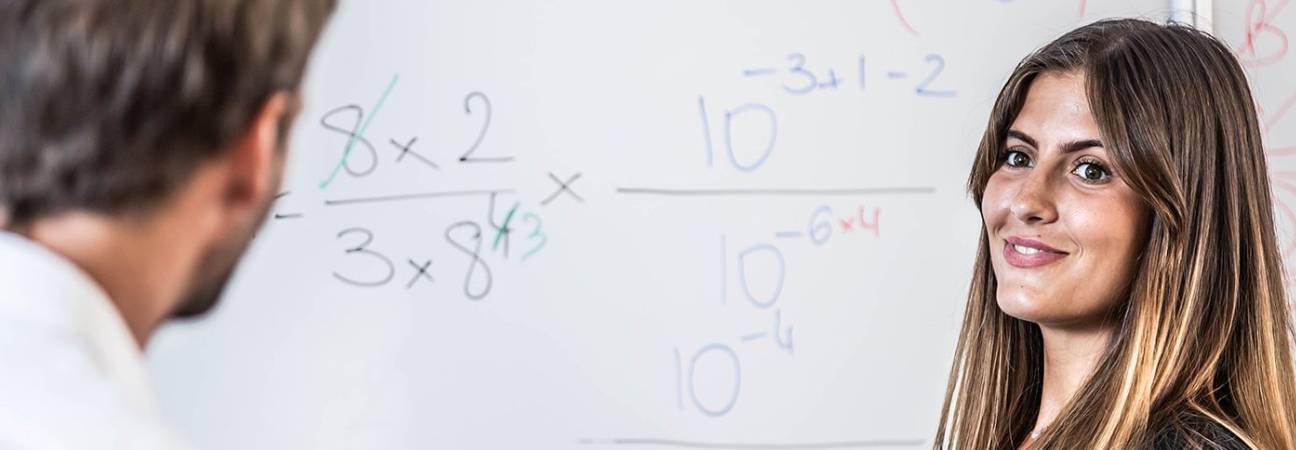Jusqu’à présent, le brevet des collèges représentait un repère important pour évaluer les acquis des élèves en fin de cycle. Désormais, seule la participation à l’examen reste obligatoire, mais un élève pourra entrer en classe de seconde même en cas d’échec, à condition que le conseil de classe estime qu’il est apte à poursuivre sa scolarité au lycée.
Cette réforme illustre une volonté de faire confiance aux enseignants et aux conseils de classe, qui ont la responsabilité d’évaluer globalement les compétences et la motivation des élèves. Le brevet ne devient donc plus qu’un indicateur parmi d’autres dans le parcours éducatif.
Face à cette évolution, le ministère prévoit des mesures spécifiques pour accompagner les élèves en difficulté qui rejoignent le lycée sans avoir obtenu leur brevet. Ces dispositifs visent à compenser les éventuelles lacunes et à garantir une transition réussie vers le second cycle.
- Classes « prépa-seconde » : mises en place depuis 2024, ces classes offrent une année de remise à niveau pour les élèves qui n’ont pas validé leur brevet. L’expérimentation, qui concerne environ 1 300 élèves, sera prolongée et évaluée pour une éventuelle généralisation.
- Parcours renforcés : des projets personnalisés seront développés au sein des établissements pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, notamment en français et en mathématiques.
Ces initiatives s’inscrivent dans une volonté plus large de lutter contre les inégalités scolaires tout en maintenant des exigences académiques adaptées.
À partir de 2026, le mode de calcul de la note finale du brevet évolue. Les épreuves terminales compteront pour 60 % de la note, tandis que le contrôle continu représentera 40 %, contre une répartition égale (50/50) actuellement.
- Contrôle continu : il sera basé sur la moyenne des notes obtenues en classe de troisième.
- Suppression des correctifs académiques : seuls les professeurs seront habilités à attribuer les notes, renforçant ainsi leur rôle dans l’évaluation.
Ces ajustements visent à garantir une évaluation plus représentative des compétences réelles des élèves, tout en réduisant les écarts entre les académies.
L’idée initiale d’imposer l’obtention du brevet pour passer en seconde, proposée par les précédents gouvernements, avait suscité de vives oppositions, notamment de la part des syndicats enseignants. Ces derniers dénonçaient une mesure perçue comme un « tri social », risquant d’exclure les élèves les plus fragiles du système éducatif.
Le retour sur cette décision a été salué par plusieurs acteurs éducatifs. Selon Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, ce changement représente une avancée dans la démocratisation de l’accès au lycée.
Malgré cette réforme, le ministère maintient une exigence élevée dans l’apprentissage des fondamentaux. Les groupes de besoin en sixième et cinquième, mis en place pour accompagner les élèves en français et en mathématiques, seront poursuivis, tandis que leur efficacité sera évaluée à partir de 2025.
En parallèle, des créations de postes dans le secondaire sont prévues pour renforcer l’encadrement pédagogique :
- 500 nouveaux emplois dans le secondaire, avec une création nette de 324 postes.
- 2 000 AESH supplémentaires (accompagnants d’élèves en situation de handicap), témoignant d’un engagement en faveur de l’inclusion scolaire.
Le ministère de l’Éducation nationale anticipe une baisse de près de 12 000 élèves dans le secondaire à la rentrée 2025. Cependant, les moyens alloués aux établissements seront renforcés pour garantir un niveau d’encadrement optimal. Ce choix stratégique vise à maintenir un soutien individualisé, notamment dans les zones défavorisées.
Cette réforme ouvre des perspectives nouvelles pour les élèves, notamment en leur offrant une seconde chance de réussir au lycée malgré d’éventuelles difficultés au collège. Elle repose sur une vision plus inclusive du système éducatif, tout en cherchant à maintenir des exigences adaptées au niveau de chaque élève.
Pour les enseignants, cette réforme implique une responsabilité accrue dans l’évaluation et le suivi des élèves. Les dispositifs de soutien renforceront leur rôle clé dans l’accompagnement pédagogique, mais nécessiteront également des ressources et une formation adaptée.