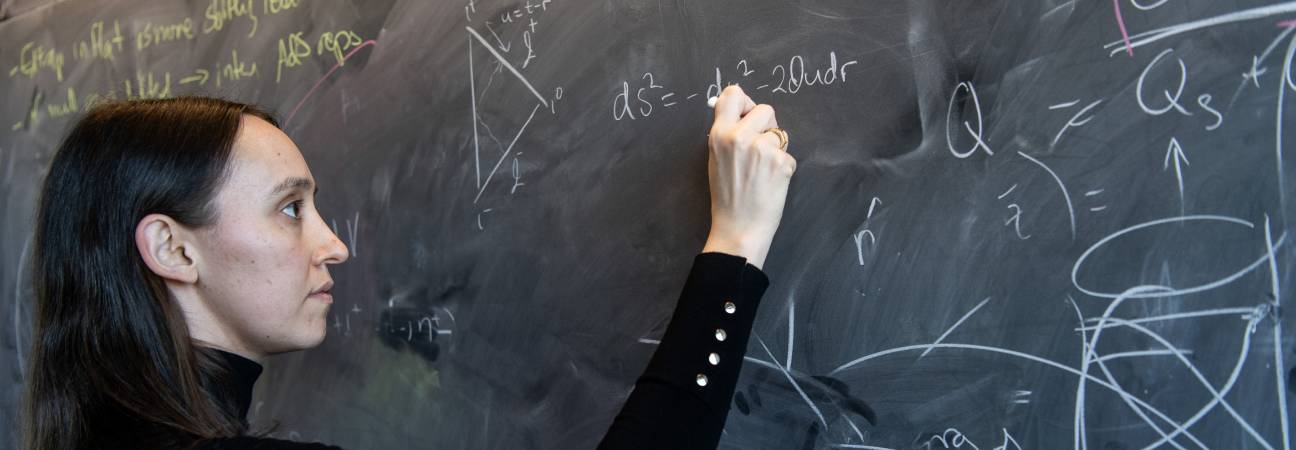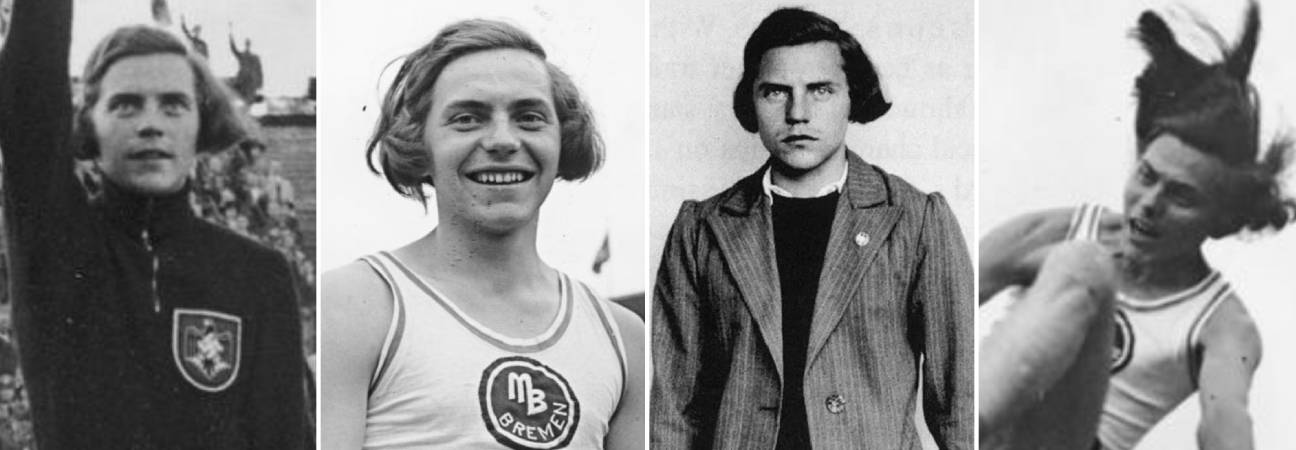Une peur ancienne et souvent innée
Des études ont montré que même des bébés de quelques mois réagissent différemment aux images d’araignées par rapport à d’autres animaux. Leur système nerveux active une réponse de stress, comme s’il identifiait instinctivement un danger. Selon certains chercheurs, cette réaction serait un héritage évolutif : nos ancêtres auraient évité certains animaux potentiellement dangereux, favorisant ainsi leur survie.
Une phobie entretenue par la culture
La peur des araignées n’est pas universelle. En Asie, au Brésil ou en Afrique de l’Ouest, l’araignée est parfois perçue comme un animal positif ou spirituel. En Occident, en revanche, l’imaginaire collectif associe souvent l’araignée à la saleté, à la sorcellerie ou à la maladie. Les films d’horreur, les vidéos virales ou encore les décors d’Halloween renforcent cette vision négative.
Pour la biologiste Christine Rollard, aranéologue au Muséum d’Histoire Naturelle, cette peur repose surtout sur une méconnaissance totale : les araignées ne sont pas dangereuses, ne piquent pas, et aucune espèce française n’est mortelle. Elles jouent même un rôle écologique essentiel, en éliminant d’autres insectes nuisibles.
« Les araignées ne sont ni sales ni agressives. Apprendre à les connaître, c’est déjà commencer à ne plus en avoir peur. »
— Christine Rollard
Quand la peur devient handicap
L’arachnophobie ne se limite pas à une peur passagère. C’est une phobie spécifique qui peut altérer le quotidien : éviter certaines pièces, refuser d’aller en vacances à la campagne, vérifier chaque recoin de la maison… La simple photo d’une araignée suffit parfois à déclencher vertiges, nausées ou palpitations.
- 6 % des Français souffrent de vraie phobie (source : Résilience PSY)
- 40 % avouent ressentir une certaine peur ou gêne en voyant une araignée
- Les femmes sont en moyenne deux à quatre fois plus touchées que les hommes
Des traitements de plus en plus efficaces
Bonne nouvelle : cette phobie se soigne. La thérapie comportementale et cognitive (TCC) est actuellement la méthode la plus utilisée. Elle consiste à désensibiliser progressivement le patient en le confrontant, de façon douce, à ce qui le terrorise. Cela peut commencer par des images ou des vidéos, puis par l’observation d’araignées en plastique ou en réalité virtuelle.
Des approches innovantes
Une application nommée Phobys utilise la réalité augmentée pour afficher des araignées en 3D dans le décor du patient. Une étude de l’Université de Bâle a montré que cette méthode permet une réduction notable de la peur, après quelques séances.
Aller vers l’animal, plutôt que le fuir
Les spécialistes insistent : l’évitement renforce la phobie. En allant à la rencontre de l’objet de sa peur, avec un accompagnement adapté, il est possible de retrouver une vie normale. Dans certains cas, des hypnothérapies ou séances de relaxation guidée peuvent aussi aider à mieux gérer l’angoisse.
La clé : mieux comprendre l’araignée
Plutôt que de fuir à la vue d’une tégénaire sous un meuble, on peut apprendre à la reconnaître, comprendre son utilité, et cohabiter avec elle. Accepter la nature, même dans nos maisons, permet aussi de renouer avec un équilibre plus apaisé.
Araignée du soir, espoir : et si ce dicton populaire retrouvait tout son sens ?
🕷️ 🌍 L'arachnophobie touche 3,5 à 6,1 % de la population pic.twitter.com/YaijwpeAau
— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) July 8, 2025