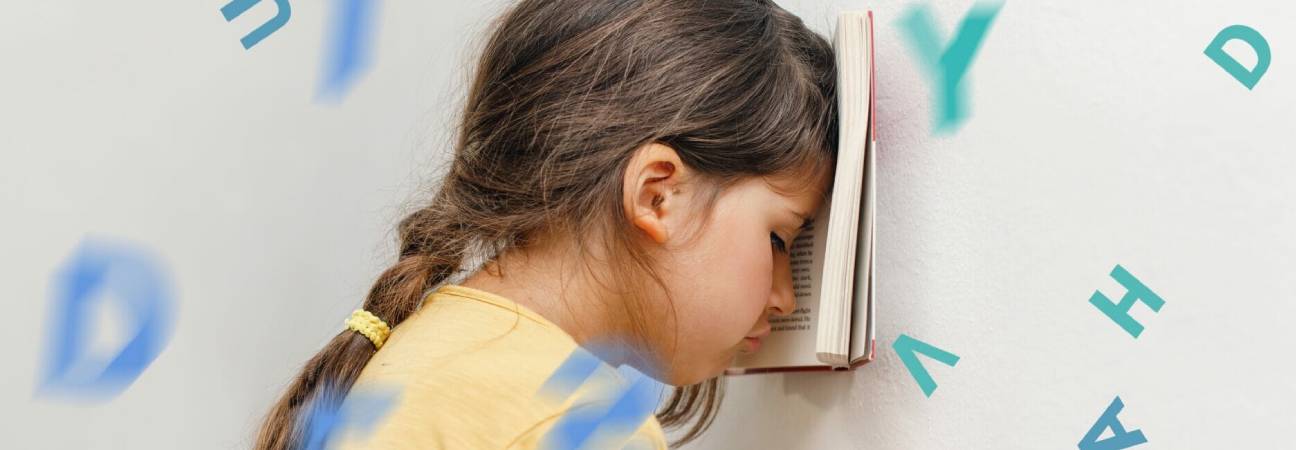Historique : du numerus clausus au numerus apertus
Le numerus clausus : une sélection stricte
Le numerus clausus, littéralement « nombre fermé », a longtemps été l’un des symboles de la sélection rigide dans les études de santé. Instauré au début des années 1970, ce système fixait un nombre maximal d’étudiants pouvant passer en deuxième année après la Première Année Commune aux Études de Santé (PACES). Il était déterminé chaque année par un arrêté ministériel et tenait compte des capacités des universités, des hôpitaux universitaires et des besoins perçus en professionnels de santé.
Cette restriction avait pour but de réguler le nombre de médecins et autres professionnels de santé, en fonction des prévisions de besoins du pays. Cependant, ce système a montré ses limites, notamment en ce qui concerne les inégalités d’accès et les effets sur la santé mentale des étudiants. La sélection étant extrêmement dure, seuls les meilleurs pouvaient continuer, laissant une grande majorité des candidats dans l’incertitude quant à leur avenir.
La réforme des études de santé et l’introduction du numerus apertus
En 2018, dans le cadre du plan « Ma Santé 2022 », le gouvernement français a entrepris une vaste réforme des études de santé, avec pour ambition de supprimer le numerus clausus et de le remplacer par un système plus souple : le numerus apertus. Cette réforme a pris effet à partir de la rentrée universitaire 2020, en parallèle de la suppression de la PACES, remplacée par deux voies d’accès : le PASS (Parcours Accès Santé Spécifique) et la L.AS (Licence Accès Santé).
Le numerus apertus, contrairement à son prédécesseur, ne fixe plus un nombre maximal d’étudiants pouvant accéder à la deuxième année. Il définit désormais un nombre minimal, qui peut être ajusté à la hausse en fonction des besoins locaux et des capacités des établissements de formation. Ce changement de paradigme vise à former davantage de professionnels de santé pour répondre à la pénurie de médecins et autres soignants en France.
Lire aussi : PASS ou L.AS, ce qu’il faut savoir !
Fonctionnement du numerus apertus
Fixation du numerus apertus
Le numerus apertus est fixé en collaboration entre les universités et les Agences Régionales de Santé (ARS). Ces dernières prennent en compte deux principaux critères pour déterminer ce nombre :
Les besoins en soins du territoire : il s’agit d’évaluer les manques en termes de professionnels de santé, notamment dans les zones sous-dotées comme les déserts médicaux.
Les capacités d’accueil des universités et des centres hospitaliers universitaires (CHU) : les établissements doivent être en mesure de fournir une formation de qualité et d’assurer les stages cliniques nécessaires à la formation pratique des étudiants.
Chaque université doit donc adapter son numerus apertus en fonction de ces deux éléments, ce qui permet une plus grande flexibilité dans la gestion du nombre d’étudiants admis en deuxième année.
Augmentation progressive du nombre de places
Avec le numerus apertus, le nombre d’étudiants admis en deuxième année est appelé à augmenter progressivement. Le gouvernement vise notamment une hausse de 20 % du nombre de médecins formés d’ici à 2027. Par exemple, à la rentrée 2020, on comptait environ 11 000 étudiants en deuxième année de médecine, un chiffre qui devrait atteindre 16 000 à l’horizon 2027.
Cette augmentation vise à répondre à la pénurie de médecins dans certaines régions, mais aussi à diversifier les profils des étudiants accédant aux études de santé.
Sélection toujours présente
Malgré cette ouverture, il ne faut pas croire que le numerus apertus supprime la sélection. En réalité, celle-ci est toujours bien présente, mais avec une plus grande flexibilité. Les étudiants doivent toujours passer des examens sélectifs à l’issue de la première année (PASS ou L.AS), et les universités sont libres de fixer des critères d’admission spécifiques en fonction de leur numerus apertus.
Un numerus apertus propre à chaque filière
Le numerus apertus ne concerne pas uniquement les études de médecine. Il est également fixé pour les autres filières du domaine de la santé, comme la maïeutique, la pharmacie, l’odontologie, et la kinésithérapie (regroupées sous l’acronyme MMOPK). Chaque filière dispose de son propre numerus apertus, adapté aux besoins spécifiques en professionnels de santé pour chaque discipline.
Les enjeux du numerus apertus
Combler les déserts médicaux
L’un des principaux objectifs de la mise en place du numerus apertus est de rééquilibrer l’offre de soins sur le territoire français. En augmentant le nombre de places disponibles en deuxième année, le gouvernement espère former plus de médecins et de soignants, ce qui devrait permettre à terme de combattre les déserts médicaux, ces zones où l’accès aux soins est particulièrement difficile en raison du manque de professionnels.
Diversification des profils
Un autre enjeu du numerus apertus est de diversifier les profils des étudiants en santé. Avec la suppression du numerus clausus, qui favorisait souvent les étudiants issus de milieux favorisés capables de suivre des prépas privées, le numerus apertus vise à donner leur chance à un plus grand nombre d’étudiants, issus de parcours différents.
Amélioration du bien-être des étudiants
La réforme vise également à améliorer le bien-être des étudiants, en diminuant la pression liée à la sélection. L’objectif est de permettre à ceux qui ne réussissent pas à intégrer la deuxième année de santé de se réorienter plus facilement, sans perdre une année entière d’études, comme c’était souvent le cas avec l’ancien système.
Les défis du numerus apertus
Capacité d’accueil des universités
Bien que le numerus apertus ait pour ambition d’augmenter le nombre d’étudiants en deuxième année, cela pose des défis logistiques pour les universités. Ces dernières doivent disposer des infrastructures et du personnel nécessaire pour encadrer un nombre croissant d’étudiants. Cela inclut notamment des places de stage en hôpital, qui sont parfois difficiles à obtenir.
Qualité de la formation
Avec l’augmentation du nombre d’étudiants, il est crucial de maintenir un niveau de qualité dans la formation. Cela implique de recruter davantage d’enseignants, de renforcer les équipements universitaires et hospitaliers, et d’assurer que chaque étudiant puisse bénéficier d’une formation pratique adéquate, notamment lors des stages cliniques.
Les critiques
Certains acteurs du milieu médical, ainsi que des étudiants, ont exprimé des réserves quant à la mise en place du numerus apertus. Ils craignent que l’augmentation du nombre d’étudiants ne soit pas suivie par une augmentation proportionnelle des moyens financiers et humains, ce qui pourrait détériorer la qualité de la formation.
D’autres estiment que cette mesure pourrait ne pas suffire à résoudre les problèmes de déserts médicaux, car la répartition des professionnels de santé dépend également de facteurs autres que le nombre de diplômés, comme l’attractivité des zones rurales.