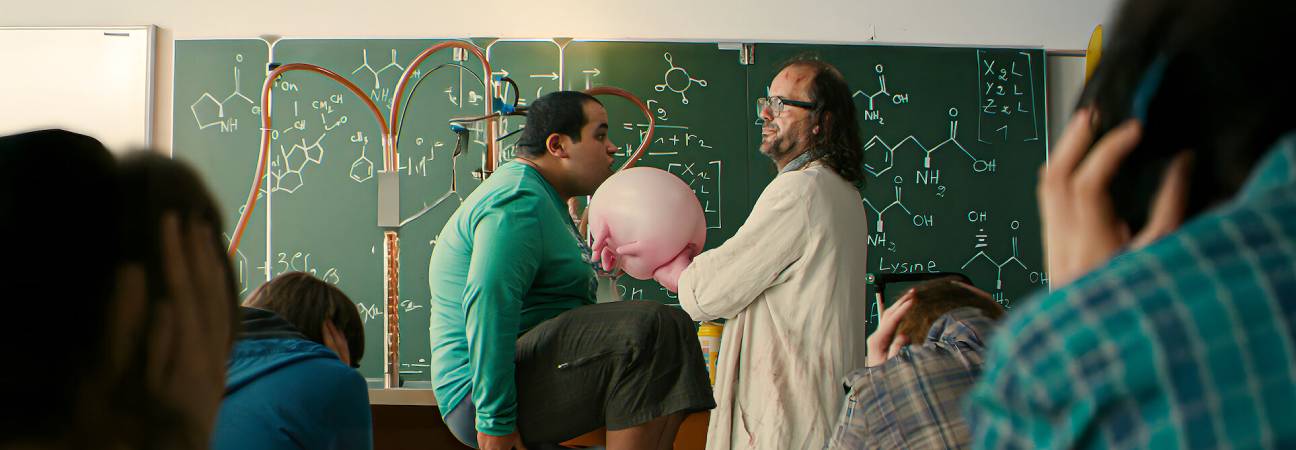L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, bien que rendue obligatoire en 2001 dans les établissements scolaires français, reste largement sous-appliquée. Salima Saa, nouvelle secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a récemment déclaré qu’il était « temps que cette éducation devienne effective ». Ce programme, qui vise à informer et sensibiliser les élèves sur la sexualité, les relations affectives et les questions de santé sexuelle, fait face à des résistances et à un manque de mise en œuvre dans les écoles, collèges et lycées.
La loi de 2001 : des bases solides mais mal appliquées
Adoptée en 2001, cette loi prévoit que les élèves doivent suivre au moins trois séances annuelles sur ces thématiques, y compris une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Pourtant, ces séances sont rarement mises en place, et les associations féministes dénoncent régulièrement ce manque de suivi.
« La loi de 2001 pose des bases intéressantes, mais elle n’est toujours pas appliquée », a souligné Salima Saa lors d’une conférence de presse au Planning Familial à Paris. Selon elle, il est nécessaire de passer à l’action pour garantir que cet enseignement soit intégré aux programmes scolaires.
Les conséquences de cette sous-application sont multiples. Les associations signalent une augmentation des violences sexuelles et une dégradation des connaissances des jeunes sur des sujets tels que le Sida, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les moyens de contraception.
Pour répondre à cette situation, Salima Saa insiste sur l’importance d’ouvrir le débat sur la culture du consentement et de promouvoir une éducation à la santé sexuelle qui soit accessible à tous les élèves. Elle a affirmé qu’il était crucial de trouver de nouvelles approches pour faire de ce programme une réalité dans les écoles françaises.
Le manque d’application de cette loi n’est pas seulement dû à des questions logistiques. Il existe également une frilosité politique face à ce sujet sensible, particulièrement dans les milieux conservateurs. Depuis des années, certains groupes politiques, notamment à droite, s’opposent à l’idée que l’éducation à la vie sexuelle soit enseignée dans les écoles publiques, préférant que ce sujet reste dans la sphère privée.
Ces positions se sont notamment cristallisées autour d’une pétition intitulée « À l’école, enseignez-moi les divisions, pas l’éjaculation ! », signée par plus de 70 000 personnes. Ce mouvement conservateur dénonce une intrusion de l’État dans des sujets jugés trop intimes et inappropriés pour l’école.
Le soutien des associations féministes
Malgré ces résistances, les associations féministes et le Planning Familial plaident en faveur d’une mise en place complète et efficace de cette éducation. Pour Sarah Durocher, présidente du Planning Familial, les attaques contre l’éducation à la sexualité proviennent souvent des mêmes groupes qui s’opposent à d’autres sujets de société, comme le droit à l’avortement. Elle souligne l’importance de prendre ces oppositions au sérieux, mais insiste sur le fait que l’éducation à la vie affective et sexuelle est cruciale pour la protection des jeunes, notamment face aux violences sexuelles.
En mars 2024, le Conseil supérieur des programmes, qui travaille sous l’autorité du ministre de l’Éducation, a proposé un projet de programme pour la rentrée 2024. Cependant, les textes définitifs n’ont pas encore été présentés. Selon le Conseil économique, social et environnemental (Cese), ce retard est partiellement dû à un manque de soutien politique et à une volonté d’éviter des controverses autour de ces sujets délicats.
Le ministre de l’Éducation, Gabriel Attal, avait déjà insisté en début d’année sur la nécessité que cet enseignement soit effectivement appliqué dans les écoles. Cependant, jusqu’à présent, aucune mesure concrète n’a été adoptée pour garantir que ces séances aient lieu régulièrement.
Une volonté de transformation pour la rentrée 2024
Avec l’engagement récent de Salima Saa, le gouvernement semble vouloir accélérer le processus de mise en œuvre. La secrétaire d’État a clairement exprimé son intention de s’attaquer à ce problème et de faire en sorte que l’éducation à la vie affective et sexuelle devienne une priorité dans les écoles françaises.
Elle a notamment souligné la nécessité d’adapter les programmes et de former les enseignants pour qu’ils soient en mesure de traiter ces sujets de manière appropriée et avec sensibilité. Selon elle, il est essentiel de faire en sorte que les jeunes aient accès à des informations précises et fiables sur la sexualité, le consentement, et la santé reproductive, pour les préparer à la vie adulte et prévenir les comportements à risque.