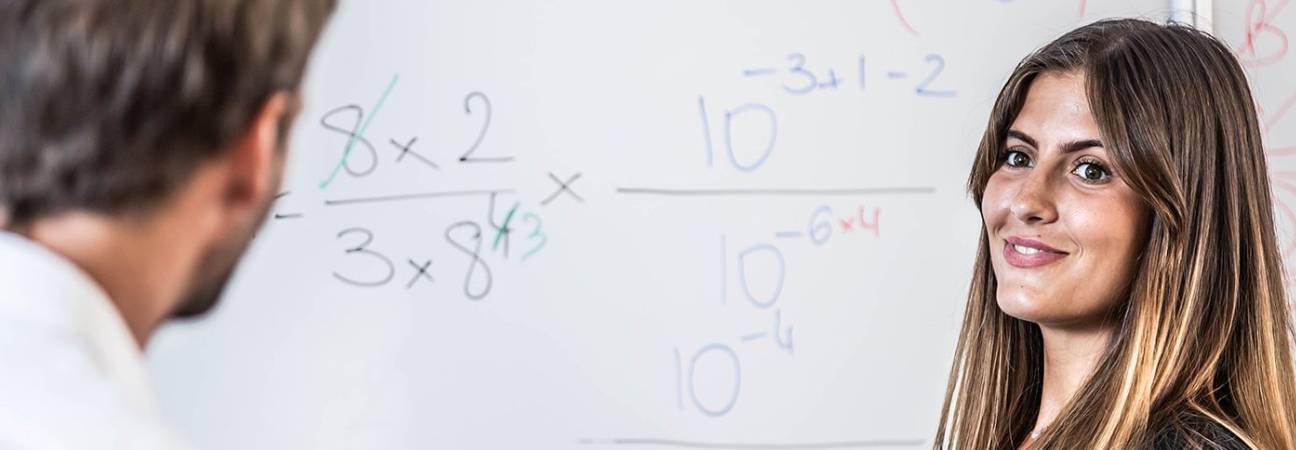Un progrès notable dans l’emploi des personnes handicapées
En 2021, la Dares recensait 628 800 travailleurs handicapés en activité en France. Ce chiffre, en constante progression, reflète une évolution des mentalités : les recruteurs sont aujourd’hui plus sensibles à la diversité, tandis que les personnes concernées ont davantage confiance en leurs compétences. Le mot “handi-capable” illustre bien cette dynamique : il met en avant la capacité avant la différence.
Mais cette évolution ne doit rien au hasard. Depuis plus de trente ans, l’État français s’est engagé à rendre le monde du travail plus accessible. La première grande avancée remonte à 1987 : une loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés. Cette obligation s’applique aussi bien au secteur public qu’au privé, quels que soient les types de contrats proposés.
Le texte s’est renforcé avec la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances, qui a clarifié la notion de handicap et imposé des sanctions plus fermes. Lorsqu’un employeur ne respecte pas cette obligation, il doit verser une contribution financière annuelle à l’Agefiph (secteur privé) ou au FIPHFP (secteur public).
Qui est considéré comme travailleur handicapé ?
Le terme recouvre une grande diversité de situations. Est reconnu comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont limitées en raison d’une altération de fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Cette reconnaissance passe souvent par une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé), attribuée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
La RQTH ouvre l’accès à de nombreux avantages :
| Avantage | Description |
|---|---|
| Accès facilité à l’emploi | Les entreprises disposent de dispositifs de recrutement ciblés pour les travailleurs handicapés. |
| Aménagement du poste | Possibilité d’adapter le matériel, les horaires ou les missions selon les besoins médicaux. |
| Formation professionnelle | Accès prioritaire à certaines formations ou reconversions financées par les organismes dédiés. |
| Aides financières | Subventions ou compensations pour l’achat d’équipements ou le transport adapté. |
Malgré ces avancées, le handicap au travail reste un sujet sensible. De nombreux stéréotypes persistent, notamment autour des performances ou de la productivité. Pourtant, les études montrent que les salariés en situation de handicap ont un taux de fidélité plus élevé et un engagement souvent supérieur à la moyenne.
Le handicap dans l’enseignement supérieur
La question du handicap ne s’arrête pas aux portes des entreprises. Dans l’enseignement supérieur, des milliers d’étudiants suivent aujourd’hui leur formation avec des troubles physiques, psychiques ou cognitifs. Pour les accompagner, des dispositifs d’accueil et d’accompagnement se sont généralisés dans les universités et écoles.
Chaque établissement dispose d’une structure dédiée : Mission handicap, Relais handicap ou encore Cellule handicap. Leur objectif est d’adapter les conditions d’étude à la situation de chaque étudiant. Ces services proposent notamment :
- Des aménagements pédagogiques : temps supplémentaire aux examens, utilisation d’un ordinateur personnel, preneur de notes, etc.
- Des aides humaines : accompagnant, interprète en langue des signes, ou tuteur référent.
- Un soutien psychologique pour les étudiants souffrant de troubles anxieux ou dépressifs.
Ces accompagnements visent à garantir une égalité réelle des chances et à éviter toute forme de décrochage. Les demandes se font généralement en début d’année universitaire, sur présentation de certificats médicaux, et sont étudiées par un médecin référent ou une commission d’aménagement.
Une évolution des mentalités encore en marche
Si la France a fait de grands progrès en matière d’inclusion, beaucoup reste à faire pour atteindre une égalité complète. Le handicap reste souvent perçu à travers le prisme de la compassion plutôt que de la compétence. Pourtant, la société évolue : les campagnes de sensibilisation, les témoignages sur les réseaux sociaux et l’engagement d’associations comme APF France Handicap ou l’Adapt contribuent à changer les regards.
« Le handicap ne se résume pas à une incapacité : c’est la société qui doit s’adapter, pas l’inverse. » — slogan de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.
Au travail comme à l’université, le message est clair : le handicap n’est plus un frein, mais une réalité à prendre en compte. Grâce aux aménagements, aux aides financières et à la volonté politique, chacun peut désormais envisager un avenir professionnel ou académique à la hauteur de ses ambitions.