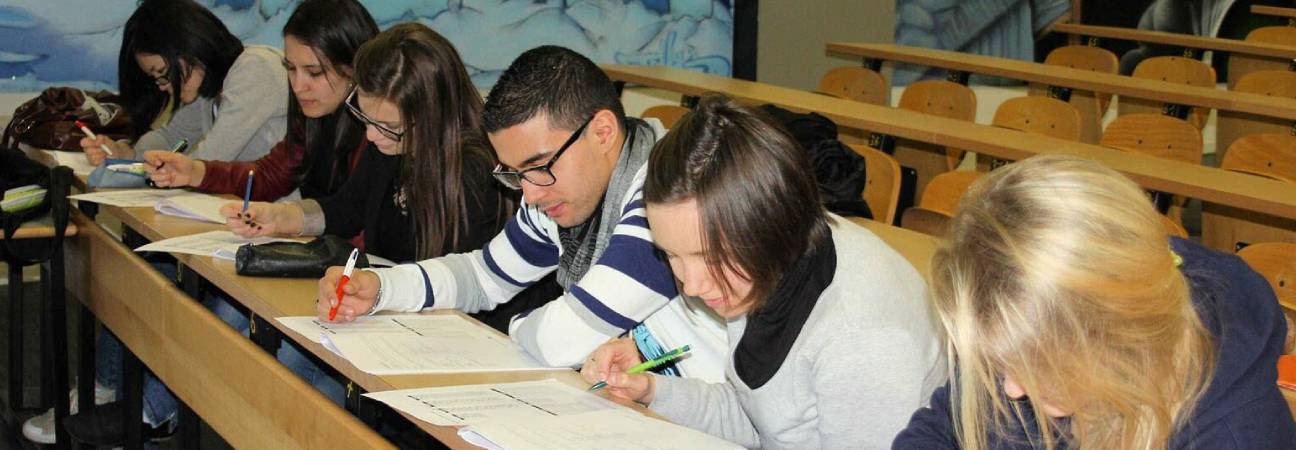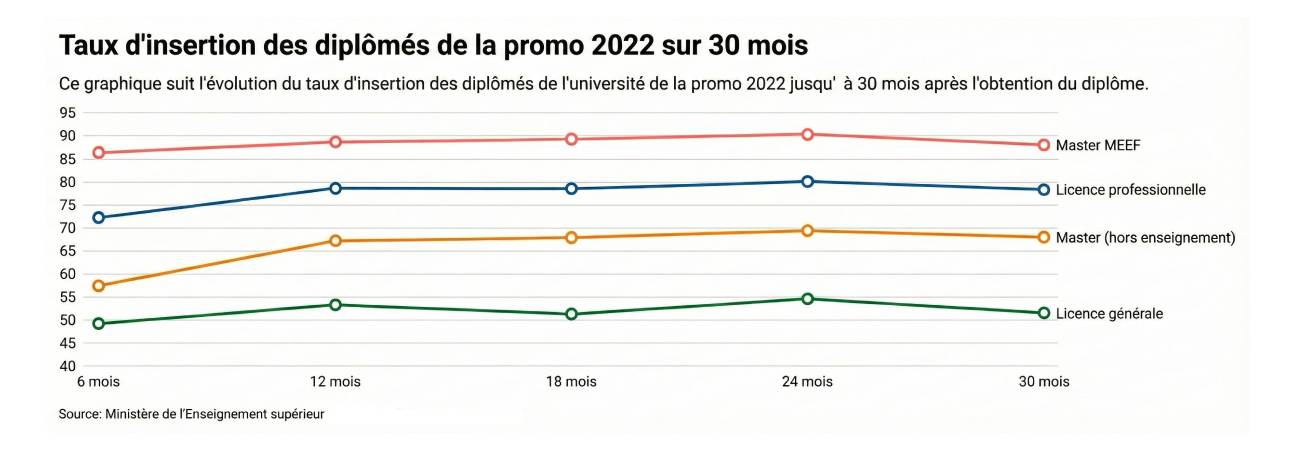Le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) a récemment relancé le débat sur la suppression du financement public des écoles privées sous contrat. Cette demande s’inscrit dans un contexte où plusieurs études mettent en lumière une répartition inégale des dotations horaires globales (DHG) entre le secteur public et le privé. Ces inégalités, largement documentées, soulèvent des questions quant à l’équité du système éducatif en France.
Les inégalités entre public et privé en matière de dotations
Pour comprendre l’ampleur des inégalités, il faut s’attarder sur l’indicateur H/E, qui représente le nombre d’heures d’enseignement par élève. Plus le H/E est élevé, plus l’établissement est en mesure de proposer des cours avec des effectifs réduits, une meilleure offre de formation, et une plus grande diversité de matières optionnelles. En théorie, cet indicateur devrait être équitablement réparti entre établissements publics et privés sous contrat, mais la réalité est tout autre.
Selon une enquête menée par France Info, plusieurs académies montrent que les lycées privés sous contrat bénéficient d’un H/E supérieur à celui des établissements publics. Par exemple, dans les académies d’Aix-Marseille et de Montpellier, le H/E des établissements privés dépasse celui du public de 0,09 point. Cela peut sembler faible, mais à l’échelle du nombre total d’élèves, cela se traduit par des milliers d’heures supplémentaires accordées aux établissements privés chaque semaine. Ces différences permettent aux lycées privés d’offrir des classes moins chargées et plus de cours en petits groupes, améliorant ainsi les conditions d’apprentissage.
En plus des inégalités en termes de H/E, il est important de noter que les élèves des établissements privés sont souvent issus de milieux plus favorisés. En 2023-2024, l’indice de position sociale (IPS) moyen des élèves des établissements privés était de 117,4, contre 99,9 dans les établissements publics. Cela signifie que les établissements privés accueillent une population d’élèves bénéficiant déjà d’un environnement socio-économique plus favorable, renforçant encore l’inégalité entre les deux secteurs.
Les impacts sur l’éducation prioritaire
Dans certaines zones prioritaires, les établissements publics, qui accueillent pourtant des élèves plus défavorisés, se trouvent sous-dotés par rapport aux établissements privés. Par exemple, à Roubaix, où la majorité des collèges sont classés REP+ (Réseau d’Éducation Prioritaire renforcé), plusieurs établissements privés sous contrat bénéficient d’un H/E équivalent à celui de l’éducation prioritaire, bien qu’ils ne fassent pas partie de ce réseau. Cela pose un sérieux problème d’équité, car les établissements publics qui devraient être prioritaires pour recevoir des ressources supplémentaires se retrouvent à faire face à un manque de moyens.
Les inégalités dans les dotations ne concernent pas seulement le clivage public-privé, mais aussi des disparités géographiques marquées. Par exemple, dans l’académie de Mayotte, où tous les collèges sont en REP+, le H/E moyen n’est que de 1,10, contre une moyenne nationale de 1,17. Cette différence montre que les moyens attribués aux académies les plus défavorisées sont insuffisants pour combler les écarts avec le reste du territoire.
Le positionnement du SNES-FSU
Face à ces inégalités croissantes, le SNES-FSU plaide pour une réforme profonde du système de financement des établissements scolaires. Le syndicat réclame l’abrogation de la loi Debré, qui permet le financement public des établissements privés sous contrat. Adoptée en 1959, cette loi est à l’origine du dualisme scolaire en France, où des fonds publics sont alloués à des établissements privés tout en maintenant une séparation avec le secteur public.
Le SNES-FSU propose de mettre en place un grand service public unifié de l’éducation, qui serait gratuit et laïque. L’idée est de nationaliser les établissements privés sous contrat, afin d’éliminer les disparités de dotations et d’offrir les mêmes conditions d’enseignement à tous les élèves, quel que soit leur milieu social. Selon le syndicat, cette mesure permettrait non seulement de rétablir l’égalité entre élèves, mais aussi de renforcer la mixité sociale au sein des écoles.
Les critiques du financement des écoles privées
De nombreuses voix, y compris celles d’anciens responsables du ministère de l’Éducation, critiquent la manière dont les dotations sont réparties entre le public et le privé. Le fait que les réseaux d’enseignement privé, notamment l’enseignement catholique, jouent un rôle si important dans la répartition des dotations est perçu comme problématique. Selon certains experts, ce système favorise délibérément le privé, notamment dans les zones où le secteur public est en difficulté, afin de maintenir une offre privée concurrentielle.
Le processus de répartition des dotations est également dénoncé pour son manque de transparence. Chaque académie dispose d’une certaine marge de manœuvre pour allouer les heures d’enseignement, et des négociations avec les représentants de l’enseignement privé sont monnaie courante. Ce système, selon Claire Guéville du SNES-FSU, crée des inégalités structurelles et rend difficile la mise en place d’un véritable équilibre entre public et privé.