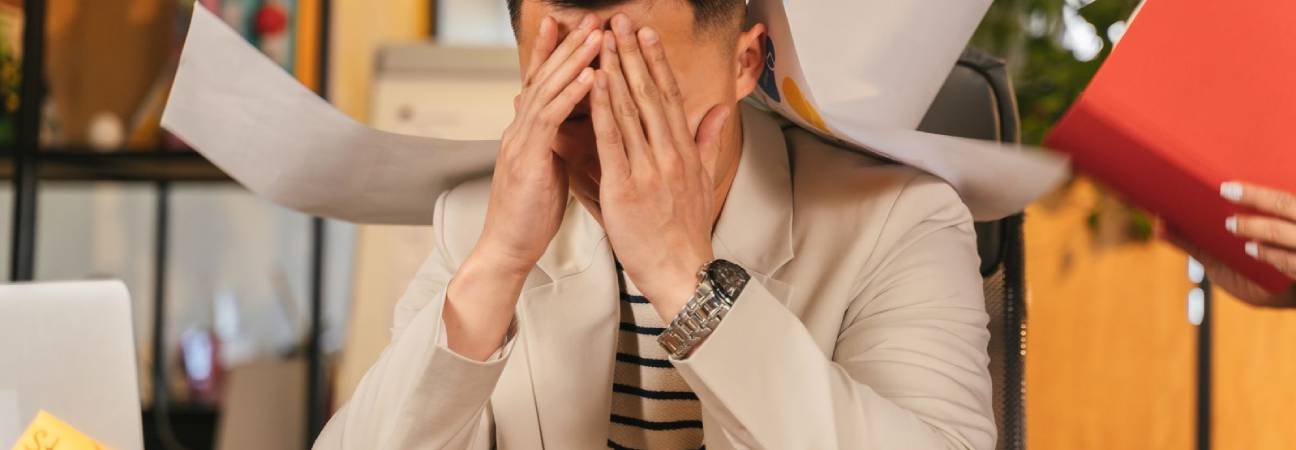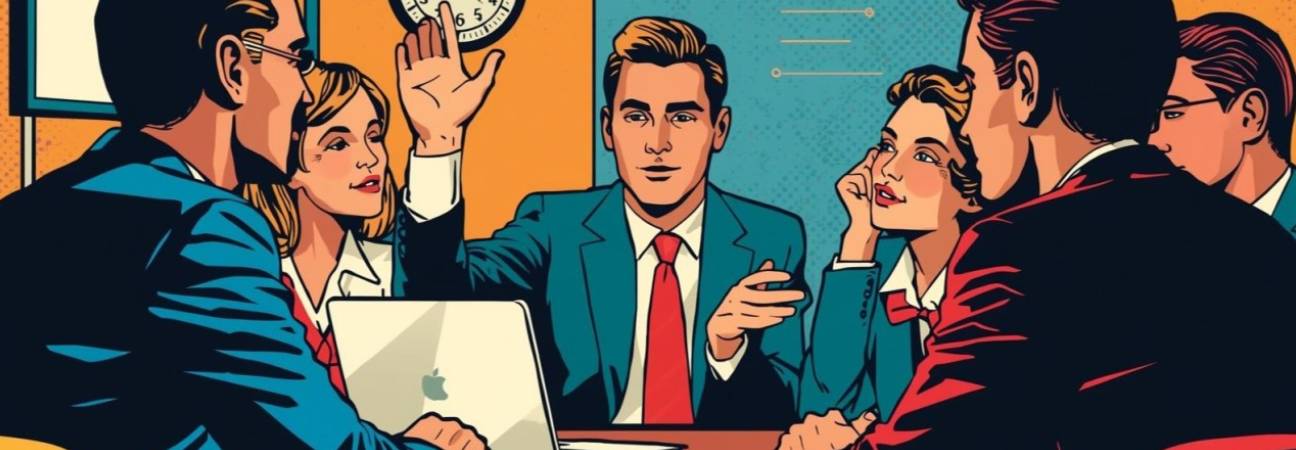Les missions courtes ne sont pas imposées aux chômeurs longue durée
La réforme pour le plein emploi, entrée en vigueur début 2025, a modifié les conditions d’attribution du RSA. Désormais, les allocataires doivent s’engager dans 15 heures d’activités hebdomadaires : il peut s’agir de formation, d’immersion professionnelle, de bénévolat ou de démarches administratives. Aucune obligation spécifique n’impose d’accepter des missions courtes.
Ce contrat encadre l’accompagnement par France Travail. Il est signé entre le bénéficiaire et son conseiller, selon son projet professionnel, ses compétences et ses contraintes personnelles. Les parcours sont adaptés et individualisés. L’idée d’imposer systématiquement des CDD ou missions d’intérim à tout chômeur est donc infondée.
Les vraies sanctions prévues par la loi
En 2025, les sanctions ne tombent pas automatiquement en cas de refus d’un contrat court. La loi distingue entre les situations : seules les absences répétées ou le non-respect des 15 heures d’activité peuvent entraîner une suspension des droits. Le système se veut désormais plus souple et progressif, notamment avec la mise en place des sanctions dites « suspension-remobilisation ».
Refuser une mission courte n’est pas interdit. Ce qui compte, c’est la cohérence de l’offre avec le profil du demandeur : diplôme, expérience, secteur, localisation. Deux refus consécutifs d’une offre jugée « raisonnable » peuvent mener à une radiation, mais encore faut-il que l’offre corresponde réellement aux critères légaux.
France Travail : entre accompagnement et objectifs chiffrés
Avec la transformation de Pôle emploi en France Travail, l’État a renforcé son ambition de ramener un maximum de personnes vers l’emploi. Mais dans les faits, les moyens humains sont en baisse : 500 postes supprimés d’ici la fin 2025. Les agents sont donc fortement sollicités, avec une pression accrue sur le suivi des bénéficiaires.
Pour optimiser les parcours, des algorithmes de tri sont utilisés. Mais certains dénoncent une logique de rendement plutôt que d’insertion. Le Défenseur des droits alerte d’ailleurs sur le risque de voir les publics fragiles mis à l’écart à cause d’objectifs chiffrés difficilement compatibles avec la réalité du terrain.
Le retour à l’emploi reste l’objectif, pas le flicage
Depuis avril 2025, le calcul des allocations a changé : elles sont désormais mensualisées sur une base de 30 jours. Cette simplification vise à apporter plus de clarté aux demandeurs d’emploi. Les profils seniors bénéficient aussi de droits renforcés, avec une durée d’indemnisation plus longue et sans dégressivité.
Pour inciter les retours progressifs à l’emploi, la loi permet de tester un nouveau poste pendant 88 jours sans perdre ses droits si l’expérience tourne court. Ce point est essentiel pour les personnes qui acceptent des missions d’essai ou des contrats précaires. Ce n’est pas une contrainte, mais une souplesse accordée.