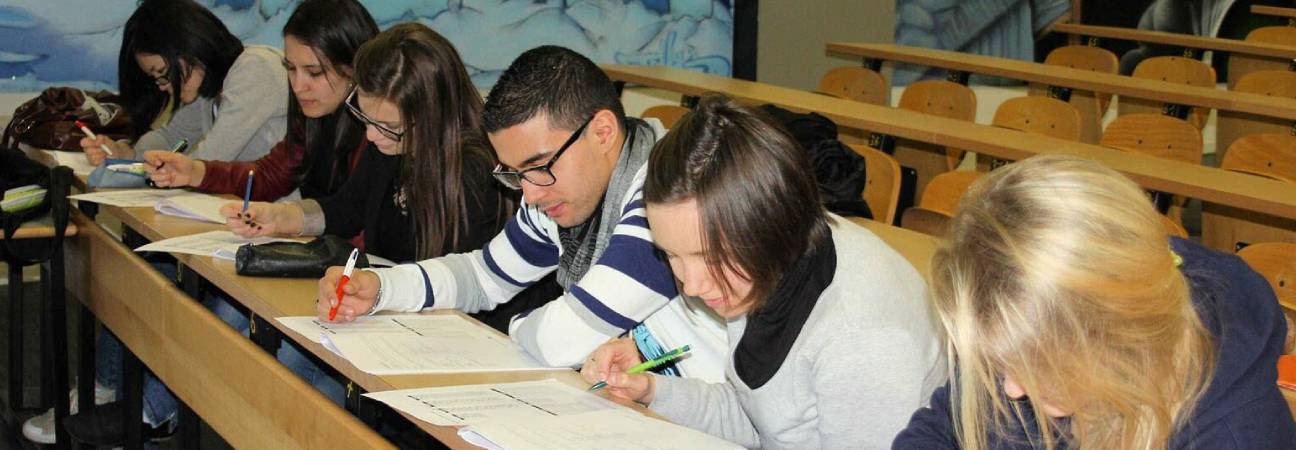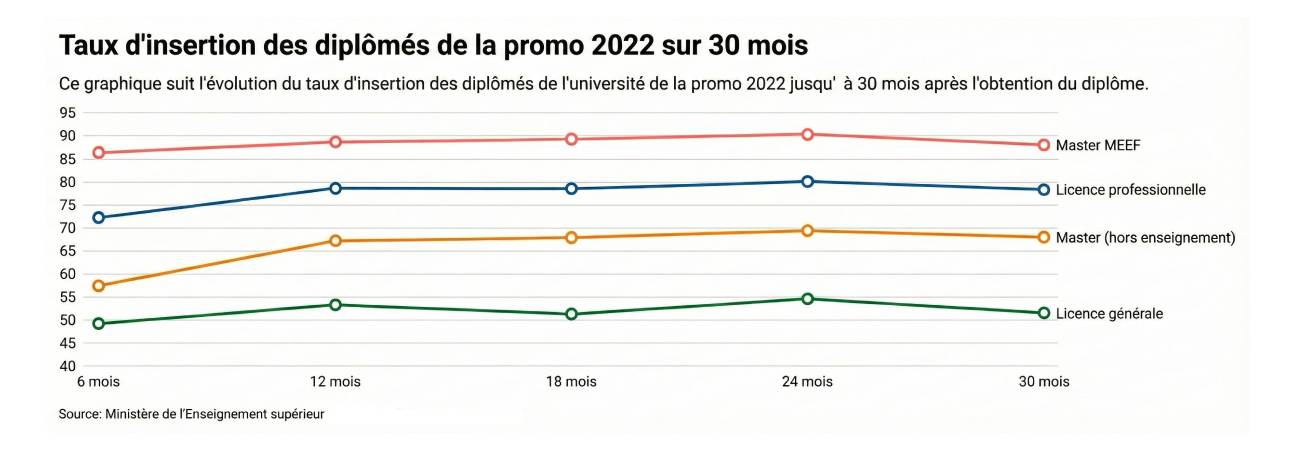Un engouement étudiant qui change les priorités
La volonté d’entreprendre touche aujourd’hui une grande partie des étudiants. De nombreuses écoles ont adapté leur communication en valorisant l’entrepreneuriat comme un pilier de leur pédagogie. Certaines comme HEC ou l’EMLyon affichent des slogans explicites et investissent des lieux emblématiques comme Station F.
En 2024, plus de 5 800 étudiants bénéficient du Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE). Ce chiffre illustre une vraie dynamique, mais il ne dit rien sur le taux de réussite ou la solidité des projets lancés. C’est souvent ici que le décalage commence.
Les écoles enseignent-elles vraiment à entreprendre ?
Les cours de création d’entreprise, les business plans en groupe ou les concours de pitch ne remplacent pas la confrontation au marché. Apprendre à entreprendre dans un cadre académique pose problème : la prise de risque réelle, les échecs et la pression quotidienne ne s’enseignent pas avec des notes sur 20.
Les étudiants acquièrent des bases solides : juridique, finance, stratégie, marketing digital. Mais maîtriser ces outils n’est pas suffisant pour faire décoller une entreprise. Le manque d’exercices de terrain reste un point faible récurrent.
L’importance de l’écosystème autour de l’étudiant
Ce qui fait vraiment la différence, c’est l’environnement mis à disposition par l’école : incubateur, mentorat, réseau d’alumni, accès à des investisseurs. Dans les écoles les plus reconnues, ce réseau peut valoir plus que le programme lui-même.
Un étudiant incubé à Station F a accès à des opportunités que d’autres n’auront jamais. Malheureusement, ces programmes sont souvent réservés aux profils qui ont déjà un bon réseau ou un dossier solide. La majorité des étudiants doivent encore faire leurs preuves seuls.
Des modèles à succès qui ne reflètent pas la norme
Les écoles mettent souvent en avant des alumni qui ont monté des startups à succès. Ces exemples inspirent, mais ils masquent une réalité : la majorité des projets étudiants échouent ou stagnent. Lancer une entreprise est difficile, même avec un diplôme d’école de commerce.
Les jeunes entrepreneurs sont rarement préparés à gérer l’échec, l’incertitude, la pression financière ou la solitude. Ces compétences viennent du terrain, pas des cours magistraux. Et c’est souvent là que les écoles montrent leurs limites.
Vers des formats plus immersifs
Certains établissements évoluent. Des formats comme la pédagogie par projet, l’immersion en startup ou les stages de césure entrepreneuriale sont de plus en plus répandus. Ils permettent aux étudiants de vivre l’aventure entrepreneuriale plutôt que de l’apprendre de façon théorique.
L’ESCP propose un master en innovation avec un semestre à San Francisco. L’EM Normandie combine incubation et entrepreneuriat social. Ces programmes vont dans le bon sens, mais ils restent minoritaires dans le paysage global des grandes écoles.
Le rôle clé des entreprises dans la formation
Face aux limites des écoles, les entreprises peuvent jouer un rôle complémentaire essentiel. En proposant des stages, du mentorat ou des retours d’expérience, elles permettent aux étudiants de se confronter à la vraie vie d’entrepreneur.
Les jeunes attendent qu’on leur parle de gestion d’équipe, de problèmes concrets, de doutes et de ratés. Pas seulement de business models. C’est ce que certaines entreprises comme BFG Capital essayent d’apporter, en intervenant dans les écoles et en transmettant une vision réaliste de l’entrepreneuriat.
Créer son entreprise demande plus que des compétences
Les étudiants ont besoin d’une éducation entrepreneuriale complète : à la fois théorique, pratique et mentale. Être capable de lire un bilan est utile. Mais savoir prendre des décisions rapides, gérer la pression et rebondir après un échec l’est encore plus.
Les écoles peuvent jouer un rôle de tremplin, mais c’est à chacun de transformer l’essai. L’entrepreneuriat ne suit pas un parcours tracé : il se construit jour après jour, en expérimentant, en échouant, en s’adaptant.