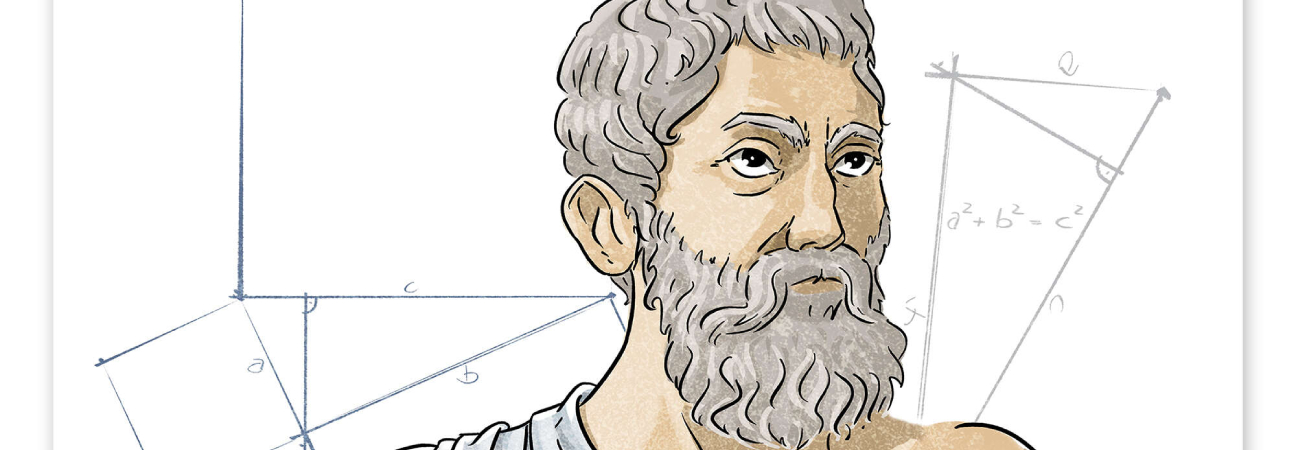Pythagore, ce nom vous évoque sans doute des cauchemars de collège où vous tentiez de comprendre pourquoi a² + b² = c². Mais derrière cette formule se cache un personnage fascinant, moitié mathématicien, moitié philosophe… et peut-être même un brin mystique. Plongeons dans la vie de cet homme qui, sans jamais rien écrire lui-même, a marqué l’histoire à jamais.
La naissance d’une légende
Pythagore est né vers 570 avant J.-C. sur l’île de Samos, en Grèce, dans une famille modeste. Sa mère, Pythais, et son père, Mnésarque, un commerçant de bijoux, ne se doutaient probablement pas qu’ils donnaient naissance à un des esprits les plus brillants de leur époque. Son prénom aurait été inspiré par la Pythie de Delphes, une prêtresse célèbre pour ses prophéties. En résumé : Pythagore était déjà voué à la grandeur dès sa naissance (et peut-être à quelques énigmes aussi).
L’homme aux mille voyages
Dès son jeune âge, Pythagore quitte son île pour explorer le monde et apprendre des meilleurs penseurs de son temps. Il aurait voyagé en Égypte, en Babylonie, et même en Inde, absorbant toutes les connaissances disponibles comme une éponge bien décidée à conquérir l’univers… mathématique.
- En Égypte : il apprend la géométrie auprès des prêtres égyptiens, qui utilisent des cordes nouées pour mesurer des champs. La fameuse « corde à 13 nœuds » pour former des triangles rectangles le marque profondément.
- En Babylonie : il découvre les mathématiques avancées des Mésopotamiens, notamment des tablettes qui mentionnent déjà des relations triangulaires.
- En Inde : selon certaines sources, il s’imprègne de philosophie et d’idées sur la transmigration des âmes. Oui, Pythagore croyait en la réincarnation bien avant que ce soit « à la mode ».
Pythagore : le philosophe et mathématicien
En rentrant de ses voyages, Pythagore s’installe à Crotone, dans le sud de l’Italie actuelle, où il fonde une école qui mélange mathématiques, philosophie et… un soupçon de mysticisme. L’école pythagoricienne n’était pas qu’une salle de classe, mais une véritable communauté (certains diraient « secte »), où l’on vénérait les nombres comme des divinités.
Les croyances pythagoriciennes
Pour Pythagore et ses disciples, « tout est nombre ». Selon eux, l’univers tout entier pouvait être décrit et compris à travers les mathématiques. Ils classifiaient même les nombres :
- Les nombres carrés : 1, 4, 9, 16, etc.
- Les nombres triangulaires : 1, 3, 6, 10, 15, etc.
- Les nombres parfaits : comme 6 (la somme de ses diviseurs : 1 + 2 + 3).
Mais Pythagore a rencontré un problème majeur : les nombres irrationnels. Imaginez le choc ! Lorsqu’il a découvert que la diagonale d’un carré de côté 1 ne pouvait pas être exprimée par une fraction, cela a ébranlé les bases de son monde. Cette découverte, pourtant révolutionnaire, a été gardée secrète… à tel point que le disciple qui l’a révélée aurait mystérieusement disparu. (Note pour vous : évitez de trahir un pythagoricien.)
Les contributions de Pythagore
Alors, parlons de l’éléphant dans la pièce : le théorème de Pythagore. Ce principe, selon lequel dans un triangle rectangle, le carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, n’était pas une invention de Pythagore. Les Babyloniens et les Chinois l’avaient déjà découvert bien avant lui. Mais il fut probablement le premier à en fournir une démonstration rigoureuse et à le formaliser.
Un jour, dans une forge, Pythagore entend les marteaux produire des sons différents selon leur taille. Fasciné, il établit une connexion entre les longueurs des cordes et les hauteurs des sons. Il découvre ainsi que la musique obéit à des lois mathématiques. Résultat ? Il crée la première gamme musicale basée sur des intervalles précis, donnant naissance à l’idée de l’harmonie des sphères. Oui, pour lui, même les planètes chantaient une mélodie cosmique (heureusement, on ne pouvait pas encore les entendre, sinon ça aurait été Spotify avant l’heure).
Lire aussi : le théorème de Pythagore
Une école mystique : la fraternité pythagoricienne
Organisation de l’école
L’école de Pythagore à Crotone était divisée en deux groupes :
- Les Acousmaticiens : ces élèves devaient rester silencieux pendant cinq ans et se contentaient d’écouter les enseignements.
- Les Mathématiciens : les initiés qui participaient activement à la réflexion et aux démonstrations.
Règles de vie (parfois étranges)
La communauté pythagoricienne suivait des règles strictes, certaines plutôt… surprenantes :
- Ne pas manger de fèves (peut-être parce qu’elles ressemblent à des embryons ?).
- Ne pas marcher sur des traces de pas.
- Toujours se chausser du pied droit en premier.
Et si vous pensiez que votre prof de maths était sévère, sachez que chez Pythagore, le moindre écart pouvait entraîner l’exclusion.
La fin d’une légende
Vers 510 avant J.-C., l’école de Pythagore est attaquée par des opposants politiques, et la communauté est dissoute. Pythagore s’exile à Métaponte, où il finit ses jours dans l’ombre. Malgré cela, son influence survit à travers les siècles, portée par ses disciples et leurs contributions.
Aujourd’hui, Pythagore est surtout connu pour son théorème, mais son impact va bien au-delà. Ses idées sur les nombres, l’harmonie et la philosophie ont jeté les bases de la science moderne. Que ce soit dans une salle de classe, une partition musicale ou un laboratoire scientifique, son héritage est partout.
Et vous, la prochaine fois que vous entendrez parler d’hypoténuse, pensez à ce génie voyageur qui voyait l’univers comme une symphonie de nombres. Peut-être que les mathématiques ne sont pas si ennuyeuses, après tout.