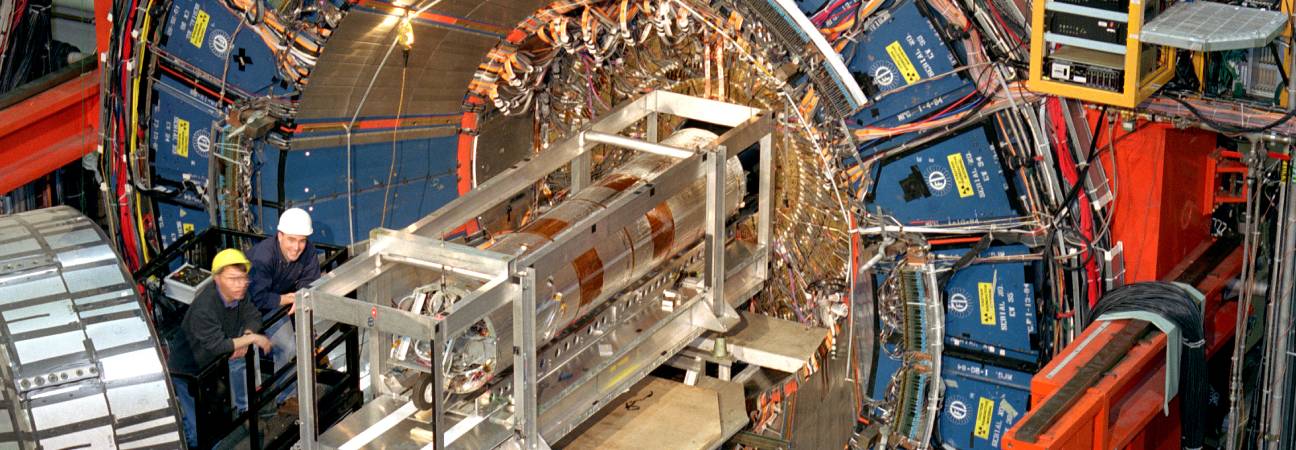Le principe : trois corps, une ombre et un alignement serré
Une éclipse se produit quand trois astres s’alignent idéalement. Selon qui cache qui, tu vois soit la Lune s’assombrir (éclipse lunaire), soit le Soleil disparaître partiellement ou totalement derrière la Lune (éclipse solaire). Tout se joue sur la géométrie :
- Éclipse de Lune : le Soleil éclaire la Terre, la Terre projette un cône d’ombre, la Lune y passe. Résultat : la Lune s’assombrit et peut virer au rouge.
- Éclipse de Soleil : la Lune se place entre la Terre et le Soleil, masque la lumière, projette son ombre sur la surface terrestre. Résultat : le jour baisse, parfois jusqu’à la nuit noire.
La clé, c’est l’alignement. Or les orbites ne sont pas exactement dans le même plan : celle de la Lune est inclinée d’environ 5°. C’est pourquoi il n’y a pas d’éclipse tous les mois, même si on a une nouvelle Lune et une pleine Lune tous les 29,5 jours.
Les mots à connaître (vraiment utiles)
- Ombre : zone où la lumière est totalement bloquée. Pour la Lune plongée dans l’ombre de la Terre, on obtient une éclipse lunaire totale.
- Pénombre : la lumière est seulement partiellement bloquée. L’assombrissement est plus discret.
- Nœuds lunaires : points où l’orbite de la Lune coupe le plan Terre–Soleil. Les éclipses surviennent quand nouvelle Lune ou pleine Lune se produisent près de ces nœuds.
Éclipse de Lune : la “Lune rouge” expliquée sans formule

Lors d’une éclipse lunaire, la Terre se place entre le Soleil et la Lune. Le Soleil ne peut plus éclairer directement la face visible de la Lune. Selon la précision de l’alignement, on observe :
- Éclipse totale de Lune : la Lune entre entièrement dans le cône d’ombre de la Terre. Elle prend une teinte rouge cuivré — la fameuse Lune de sang. Pourquoi rouge ? Car la lumière solaire traverse l’atmosphère terrestre qui diffuse davantage le bleu et laisse passer plus de rouge. Cette lumière filtrée se projette sur la Lune.
- Éclipse partielle : seule une portion de la Lune est dans l’ombre. On voit une “morsure” sombre sur le disque.
- Éclipse pénombrale : la Lune ne passe que dans la pénombre de la Terre. L’assombrissement est léger, parfois difficile à percevoir sans photo.
Pourquoi c’est plus “facile” à vivre qu’une éclipse de Soleil
- Durée : une éclipse de Lune peut durer plusieurs heures. Tu as le temps d’observer, de faire des pauses, de revenir regarder.
- Zone de visibilité : elle est visible depuis toute la partie de la Terre plongée dans la nuit. La moitié du globe peut donc en profiter.
- Sécurité : on peut regarder une éclipse lunaire à l’œil nu, aux jumelles ou au télescope. Zéro risque pour les yeux.
Comment la savourer
Repère le début en observant la Lune qui “grise” très doucement (pénombre), puis la véritable entrée dans l’ombre terrestre : la bordure sombre est nette et arrondie — c’est littéralement l’ombre de la Terre, preuve de sa rotondité. Pendant la totalité, guette les nuances : parfois orange clair, parfois brique foncé, selon la transparence de l’atmosphère (poussières, aérosols) qui filtrent la lumière.
Tips d’observation rapides
- Matériel : tes yeux suffisent, mais des jumelles 8×42 ou 10×50 subliment les couleurs et les détails.
- Photos : un trépied, un zoom (200–300 mm), ISO modérés, bracketing d’exposition. Inclure un premier plan (toit, arbre, monument) rend la photo plus vivante.
- Ambiance : au maximum de l’éclipse, le ciel s’assombrit un peu, laissant réapparaître les étoiles autour de la Lune. Magique.
Éclipse de Soleil : quand le jour baisse d’un coup
Une éclipse solaire se produit quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Selon la distance apparente Lune–Soleil et ta position sur le globe, tu verras :
- Éclipse totale : la Lune masque entièrement le Soleil. En totalité, la lumière tombe, la température peut baisser de quelques degrés, les oiseaux se taisent, la couronne solaire devient visible. C’est très court (quelques minutes maximum) mais absolument inoubliable.
- Éclipse partielle : la Lune ne mord qu’un morceau du disque solaire. Le ciel s’assombrit peu, mais les croissants de lumière sont saisissants à travers les feuillages (effet camera obscura naturel).
- Éclipse annulaire : la Lune est un peu plus loin de la Terre, donc visuellement plus petite. Elle ne couvre pas tout le Soleil, laissant un anneau de feu autour d’elle.
- Éclipse hybride : très rare, l’éclipse est annulaire sur certaines zones, totale sur d’autres, selon la courbure de la Terre et la distance apparente au fil de la trajectoire.
Pourquoi elles sont plus “rares” pour toi
Les éclipses solaires se produisent chaque année quelque part sur Terre, mais la bande de totalité est étroite (une centaine de kilomètres de large). Pour voir la totalité, il faut souvent voyager pour se placer pile dans l’ombre de la Lune. En dehors de cette bande, on n’observe qu’une éclipse partielle.
Règle d’or : ne jamais regarder le Soleil sans protection
Oui, même si “il fait sombre”. Une éclipse solaire reste dangereuse pour tes yeux hors du court instant de totalité (et seulement si tu te trouves dedans). Il faut impérativement :
- utiliser des lunettes d’éclipse certifiées (norme EN ISO 12312-2), sans rayures ni pliures,
- ou une projection indirecte (sténopé / boîte à trous, jumelles projetées sur une feuille, etc.),
- ou un filtre solaire adapté monté sur l’instrument (jamais un filtre vissé à l’oculaire).
“Tu ne regardes jamais le Soleil à l’œil nu. Éclipse ou pas éclipse.”
Checklist sécurité express
- Pas de lunettes de soleil “classiques” : elles ne protègent pas suffisamment.
- Pas de vision prolongée au smartphone, appareil photo, jumelles sans filtre devant l’objectif.
- On enlève les lunettes d’éclipse uniquement pendant la totalité, si et seulement si tu es dans la bande de totalité. On les remet avant le retour de la lumière.
Pourquoi il n’y a pas d’éclipse tous les mois
L’orbite de la Lune est inclinée d’environ 5° par rapport au plan Terre–Soleil (l’écliptique). La plupart du temps, la Lune passe un peu au-dessus ou au-dessous de l’alignement parfait. Les moments favorables se concentrent autour des nœuds lunaires — deux points opposés où les plans se croisent. Quand la nouvelle Lune ou la pleine Lune tombent près d’un nœud, les conditions sont réunies. D’où des “saisons d’éclipses” espacées dans l’année.
Combien d’éclipses par an ?
- En tout, entre 4 et 7 éclipses (solaires + lunaires) par année civile.
- Sur un même lieu, tu verras plus souvent des éclipses de Lune (visibles par tout l’hémisphère de nuit) que des éclipses totales de Soleil (bande très étroite).
Fun fact qui calme : la fin des éclipses totales… un jour
La Lune s’éloigne de la Terre d’environ 3 à 4 cm/an. D’ici quelques centaines de millions d’années, son diamètre apparent sera trop petit pour recouvrir totalement le Soleil. Les éclipses annulaires deviendront la norme. Pas d’urgence, mais c’est vertigineux.
Calendrier, repérage, météo : comment bien préparer
Deux choses font (presque) tout : connaître la date et soigner la logistique.
- Dates & zones : vérifie les prochaines échéances et cartes de visibilité. Par exemple, en 2025, une éclipse partielle de Soleil a lieu le 21 septembre (non visible depuis la France), tandis qu’une éclipse totale de Lune a pu être vue localement le 7 septembre. En 2026, une totale de Lune est annoncée le 3 mars; côté Soleil, surveille aussi l’été 2026 en Europe pour une forte partielle. Les détails locaux changent selon ta ville, donc pense aux cartes précises.
- Météo : ciel dégagé prioritaire. Si tu peux, prévois un plan B à 30–100 km pour fuir les nuages le jour J.
- Lieu : horizon dégagé (pour le lever/coucher), sécurité, accès simple. Les toits, parcs, collines fonctionnent très bien.
- Timing : note l’heure de début, le maximum, la fin, et la hauteur de l’astre. Arrive tôt, installe-toi confortablement.
Matériel minimaliste mais malin
- Lunaire : yeux + jumelles (si possible), veste, siège pliant, boisson chaude. Une appli d’étoiles pour repérer le décor autour de la Lune.
- Solaire : lunettes d’éclipse pour tout le monde, sténopé ou miroir troué pour projeter des croissants, chapeau, crème solaire (oui), trépied si tu filmes.
- Photo : trépied, déclencheur, batteries pleines; en solaire, filtre ND solaire devant la lentille. En lunaire, pense au bracketing pour capturer la dynamique.
Ce que tu vas voir (et ressentir)
Signes qui ne trompent pas en solaire
- Lumière étrange : les contrastes deviennent métalliques. En forte partielle, les ombres s’affinent; en totalité, le crépuscule tombe d’un coup.
- Thermique : baisse de température sensible, petit vent qui tourne.
- Vie : oiseaux silencieux, insectes perturbés, réactions humaines (cris, larmes, applaudissements… c’est normal).
Le charme lent de la lunaire
- Palette de rouges : brique, cuivre, parfois presque brun — c’est la météo globale qui peint la Lune.
- Ciel étoilé : au maximum, de nombreuses étoiles redeviennent visibles autour du disque rougeoyant.
Idées reçues à ranger
- “Une éclipse, c’est dangereux en soi.” Faux. Ce qui est dangereux, c’est de regarder le Soleil sans protection. La Lune, elle, ne blesse personne.
- “On peut utiliser des lunettes de soleil.” Non. Elles n’arrêtent pas les UV/IR nocifs. Seules les lunettes d’éclipse certifiées conviennent.
- “On peut improviser un filtre avec un CD, du verre fumé, une radiographie.” Non plus. C’est insuffisant et trompeur.
- “L’éclipse totale dure longtemps.” Non. La totalité dure quelques minutes au mieux. Le phénomène complet peut durer des heures, mais la magie absolue est brève.
Pourquoi la Lune ou le Soleil “disparaissent” à nos yeux
Ce n’est évidemment pas l’astre qui s’éteint. C’est notre perception qui change, parce que l’astre est occulté (caché) ou plongé dans une ombre :
- En éclipse de Soleil, la Lune bloque la lumière solaire qui nous parvient. Notre région passe sous l’ombre (ou la pénombre) de la Lune. D’où l’impression de disparition du Soleil.
- En éclipse de Lune, la Terre bloque la lumière du Soleil qui éclaire normalement la Lune. La face lunaire visible est alors dans l’ombre de la Terre, mais reste rougie par la lumière solaire filtrée par notre atmosphère. D’où l’impression que la Lune s’éteint puis s’embrase en rouge sombre.
Le hasard cosmique qui rend tout possible
La Lune est ~400 fois plus petite que le Soleil, mais aussi ~400 fois plus proche de nous. Résultat : leur taille apparente dans le ciel est similaire. C’est ce coup de bol géométrique qui permet aux éclipses totales de Soleil d’exister sur Terre.
Petit mode d’emploi pour la première fois
- Choisis ton camp : solaire (adrénaline, sécurité stricte, logistique serrée) ou lunaire (zen, longue durée, facile).
- Bloque la date : note les heures clés et la hauteur de l’astre. Prépare un rappel.
- Prévois le spot : horizon dégagé, accès simple, plan B météo.
- Pense au confort : siège, plaid, thermos, musique douce, amis. L’ambiance fait beaucoup.
- Prends soin de tes yeux : lunettes d’éclipse pour le Soleil, rien d’obligatoire pour la Lune.
- Profite : lève parfois le nez des écrans. Vis le moment.
Photographier sans (trop) se compliquer

Éclipse lunaire
- Smartphone : pose de nuit, app “pro” si possible, appuie-toi sur un support, déclencheur retardé. Cadre avec un bâtiment ou un arbre.
- APN : trépied, 200–300 mm, ISO 400–1600, f/5.6–f/8, vitesses entre 1/60 s et 1 s selon la phase. Fais plusieurs expositions.
Éclipse solaire
- Filtre solaire devant l’objectif (type feuille Astrosolar). Jamais sans filtre hors totalité.
- Focale : 400–800 mm pour cadrer le disque; sinon, cadre large + ambiance.
- Réglages : ISO bas, trépied, rafale légère au maximum. Retire le filtre uniquement pendant la totalité et remets-le avant le retour du premier rayon.
À retenir
- Une éclipse, c’est un alignement : Terre, Lune, Soleil.
- Lunaire : la Lune passe dans l’ombre de la Terre. Sûre, longue, souvent visible par beaucoup.
- Solaire : la Lune masque le Soleil. Puissante, courte, bande étroite, protection obligatoire.
- Pas d’éclipse tous les mois à cause de l’inclinaison de l’orbite lunaire.
- Le “hasard” des tailles apparentes rend la totalité possible… pour quelques centaines de millions d’années encore.