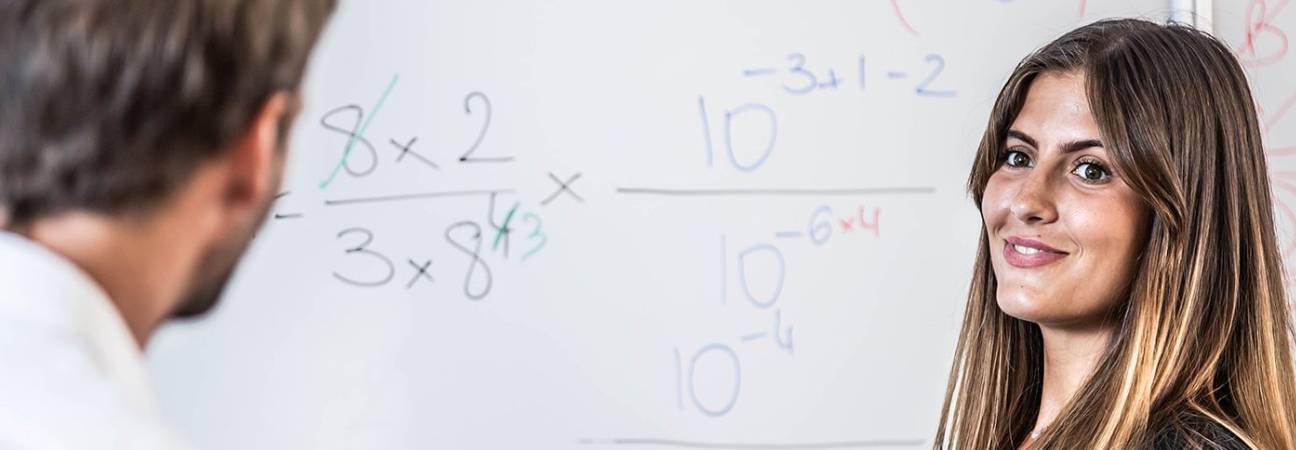Le parcours PASS et LAS
La première étape pour intégrer des études de médecine en France commence avec le PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) ou la LAS (Licence Accès Santé). Ces deux parcours remplacent depuis peu l’ancienne PACES (Première Année Commune aux Études de Santé).
Le PASS est une filière principalement dédiée aux études de santé. Elle est plus axée sur des matières médicales et scientifiques, avec des enseignements propres aux disciplines de santé telles que la médecine, la pharmacie, l’odontologie, la kinésithérapie et la maïeutique (sage-femme). Le PASS est particulièrement sélectif, et une grande partie des candidats ne passe pas en deuxième année.
La LAS, quant à elle, offre aux étudiants la possibilité de suivre une licence classique (en biologie, en chimie, en droit, en psychologie, etc.) tout en suivant des enseignements spécifiques liés à la santé. Cette option permet de garder une certaine flexibilité si les étudiants ne réussissent pas à intégrer la deuxième année de médecine, leur permettant ainsi de se réorienter plus facilement vers un autre domaine.
L’accès à la deuxième année de médecine est très compétitif. Les étudiants doivent réussir des examens tout au long de leur première année et atteindre un certain niveau pour intégrer la suite du cursus. Ce processus est régulé par un numerus apertus, c’est-à-dire un nombre limité de places, qui varie selon les régions et les besoins en professionnels de santé.
Le premier cycle : deux années de fondamentaux médicaux
Après avoir franchi avec succès la première étape de sélection, les étudiants entament le premier cycle des études médicales. Ce cycle comprend la deuxième et la troisième année de médecine.
Contenu des enseignements
Ces deux années sont principalement consacrées à l’acquisition des connaissances scientifiques fondamentales. Les étudiants apprennent à comprendre le fonctionnement normal du corps humain et à appréhender les bases des pathologies. Les disciplines abordées incluent :
- La physiologie
- L’anatomie
- La biochimie
- La sémiologie (étude des signes cliniques)
- La microbiologie
- La pharmacologie
Ces matières permettent aux futurs médecins de maîtriser les bases nécessaires pour comprendre le corps humain en bonne santé, ainsi que les perturbations causées par les maladies.
Stages et premiers contacts avec le milieu hospitalier
Dès le premier cycle, les étudiants effectuent un stage infirmier de quatre semaines, suivi de stages en milieu hospitalier. Cette première immersion dans le monde professionnel est essentielle pour comprendre le rôle du médecin dans un environnement clinique. Les étudiants doivent aussi réaliser un service sanitaire, où ils participent à des actions de prévention auprès de populations spécifiques.
À l’issue de la troisième année, les étudiants obtiennent le Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM), qui leur permet d’entrer en quatrième année.
Le second cycle : trois années d’externat
Le second cycle, souvent appelé externat, se déroule sur trois ans (de la quatrième à la sixième année). Il permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances cliniques et d’acquérir une formation complète.
Formation théorique et pratique
Pendant cette période, les étudiants alternent entre des cours à l’université et des stages en milieu hospitalier. Ils se spécialisent dans des domaines spécifiques tels que :
- La pédiatrie
- La gériatrie
- La neurologie
- La cardiologie
- La cancérologie
Ces matières permettent aux étudiants de toucher à diverses spécialités et de préparer les épreuves classantes nationales informatisées (ECNi), un concours national qui détermine leur futur domaine de spécialisation et leur lieu d’exercice.
Rémunération et statut d’étudiant hospitalier
Les externes passent la moitié de leur temps à l’hôpital, où ils participent activement aux soins sous la supervision de médecins confirmés. Ce statut d’étudiant hospitalier leur permet de percevoir une rémunération, qui augmente au fur et à mesure qu’ils progressent dans leurs études. Les externes doivent également réaliser au moins 25 gardes en trois ans, souvent dans des services d’urgence.
Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales (DFASM)
À la fin du second cycle, les étudiants obtiennent le Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales (DFASM), un diplôme de niveau master. Mais ils ne sont pas encore autorisés à exercer la médecine : pour cela, il faut passer par la dernière étape, celle de l’internat.
Le troisième cycle : l’internat et la spécialisation
Le troisième cycle des études de médecine est celui de l’internat. Sa durée varie en fonction de la spécialité choisie, mais il dure généralement entre 3 et 6 ans. Ce cycle permet aux futurs médecins de se spécialiser dans un domaine particulier.
Spécialités médicales
Il existe 44 spécialités médicales en France, réparties en différentes catégories :
- Spécialités médicales (comme la psychiatrie, la pneumologie, la radiologie)
- Spécialités chirurgicales (comme la neurochirurgie, la chirurgie orthopédique)
- Biologie médicale
La spécialité de médecine générale est la plus accessible en termes de places disponibles. À titre d’exemple, pour l’année universitaire 2023-2024, il y avait 3 645 places en médecine générale, contre seulement 28 places en neurochirurgie.
Organisation de l’internat
L’internat est divisé en trois phases :
- La phase socle (1 an) : Elle permet aux internes de revoir les bases de leur spécialité et de s’initier à leur futur domaine d’expertise.
- La phase d’approfondissement (1 à 2 ans) : Les internes commencent à pratiquer de manière plus autonome sous la supervision d’un médecin senior.
- La phase de consolidation (1 à 2 ans) : Les internes, sous le statut de docteur junior, acquièrent une autonomie complète et peuvent effectuer des actes médicaux sous la surveillance indirecte d’un senior.
Diplôme d’État de docteur en médecine
À la fin de l’internat, les étudiants soutiennent une thèse d’exercice. Après validation de leurs stages, enseignements et thèse, ils obtiennent le Diplôme d’État de docteur en médecine (DE). Pour les médecins spécialistes, ils doivent également décrocher un Diplôme d’Études Spécialisées (DES) dans leur domaine pour exercer en tant que spécialiste.
Études complémentaires : les DESC et sur-spécialisations
Même après l’obtention du DE et du DES, de nombreux médecins choisissent de prolonger leur formation pour se spécialiser davantage. Ils peuvent suivre un Diplôme d’Études Spécialisées Complémentaires (DESC), qui dure généralement entre 1 et 3 ans. Ces diplômes permettent d’approfondir certaines spécialités ou de se former à des disciplines très spécifiques, comme :
- La médecine du sport
- L’addictologie
- La médecine tropicale
Une carrière longue, mais gratifiante
Devenir médecin en France nécessite 9 à 12 ans d’études, selon la spécialité choisie. Ce parcours, bien que long et exigeant, aboutit à l’un des métiers les plus respectés et gratifiants. Que ce soit en tant que médecin généraliste ou spécialiste, les professionnels de santé jouent un rôle essentiel dans la société.