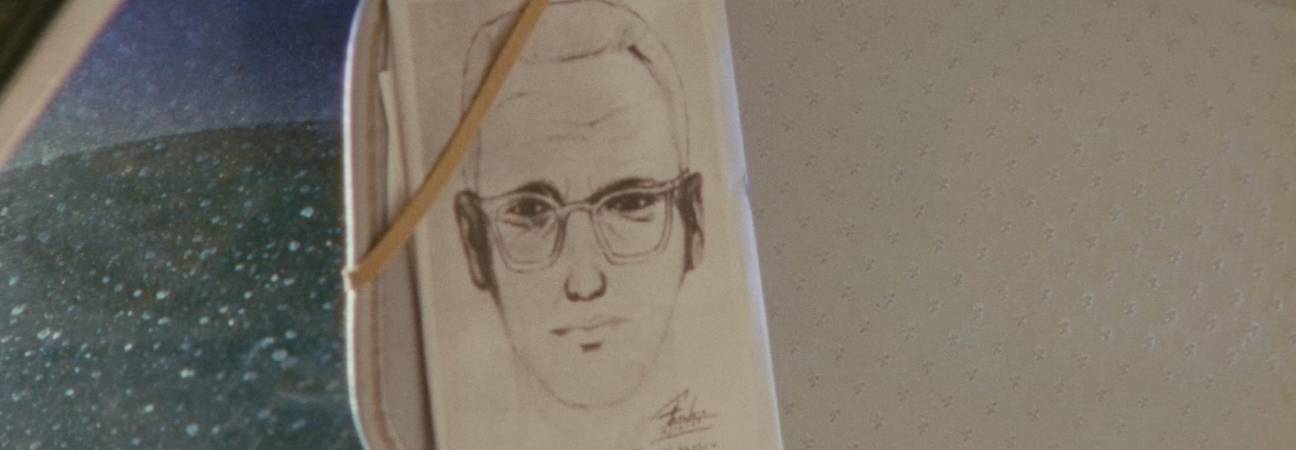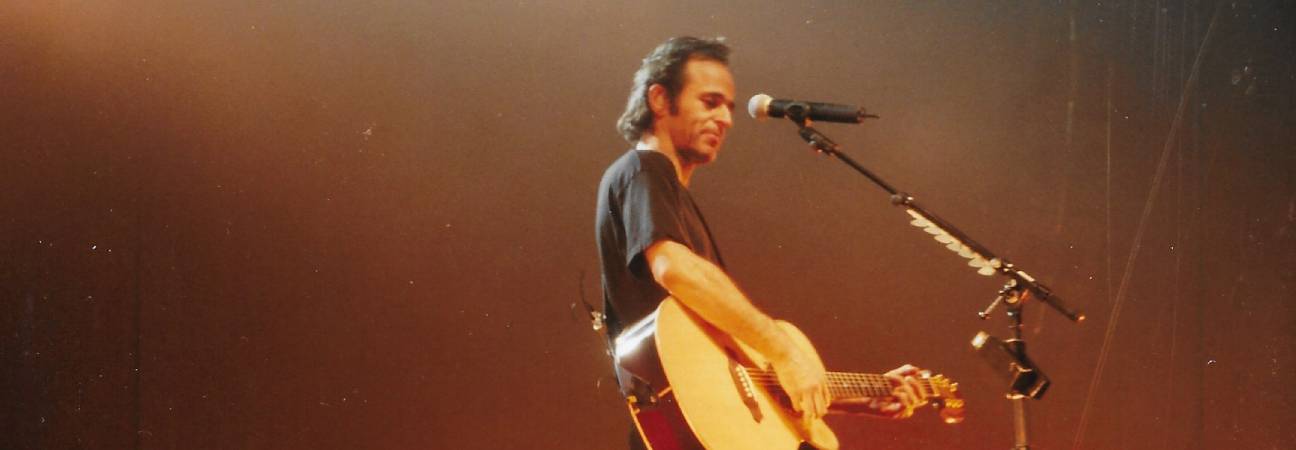Preet Inder Singh, âgé de 30 ans, était un jeune homme célibataire, diagnostiqué avec un lymphome non hodgkinien, un type de cancer du sang, en juin 2020. Sur les conseils des médecins de l’hôpital Ganga Ram à New Delhi, il avait décidé de cryoconserver son sperme avant de débuter une chimiothérapie, un traitement qui risquait d’affecter sa fertilité. Malheureusement, il est décédé quelques mois plus tard, en septembre 2020.
Après sa mort, ses parents, Harbir Kaur et Gurvinder Singh, ont demandé à l’hôpital de leur remettre l’échantillon de sperme de leur fils. Toutefois, l’établissement a refusé, arguant que les parents ne pouvaient pas être considérés comme les héritiers légaux du sperme de leur fils. Face à ce refus, le couple a décidé de saisir la justice.
La Haute Cour de Delhi a finalement donné raison aux parents, soulignant que le droit indien ne prohibe pas la reproduction posthume, à condition que le propriétaire des gamètes ait donné son consentement. La juge Prathiba Maninder Singh a précisé que, puisque Preet Inder Singh n’était ni marié ni père, ses parents devenaient les héritiers légaux de son sperme, conformément à la loi indienne sur la succession hindoue (Hindu Succession Act).
Ce jugement ouvre la voie à une nouvelle réflexion sur la reproduction posthume en Inde, un sujet qui reste controversé et peu encadré par la législation. Il est important de noter qu’en Inde, la gestation pour autrui commerciale est interdite depuis 2021, mais l’utilisation de mères porteuses à des fins altruistes reste autorisée.
Harbir Kaur et Gurvinder Singh ont déclaré à la presse que leur démarche n’était motivée que par le désir de perpétuer l’héritage de leur fils et de conserver un lien avec lui à travers un petit-enfant. Le couple, âgé d’une soixantaine d’années, a également précisé que, si nécessaire, les deux sœurs de Preet se sont engagées à assumer la responsabilité de l’enfant.
« Nous avons été très malchanceux en perdant notre fils. Mais grâce à cette décision, nous allons pouvoir récupérer une part de lui », a confié Harbir Kaur à la BBC. Elle a également précisé que la famille ferait appel à une mère porteuse, déjà identifiée au sein de la famille.
Cette affaire n’est pas unique en Inde ni dans le monde. En 2018, une situation similaire s’était produite lorsqu’une femme avait utilisé le sperme de son fils décédé pour concevoir des jumeaux. Dans d’autres pays comme les États-Unis et Israël, des lois existent déjà concernant la reproduction posthume, souvent sous conditions strictes, notamment avec un consentement préalable du défunt.
Cependant, le cadre juridique autour de la reproduction posthume reste flou dans de nombreux pays. En France, par exemple, cette pratique est interdite, même en cas de consentement écrit du défunt. En Inde, ce jugement pourrait faire jurisprudence et ouvrir un débat sur la régulation de la procréation posthume.
Cette décision soulève des questions éthiques complexes autour du droit à la reproduction après la mort, de l’héritage familial et du rôle des parents dans la procréation de leurs enfants décédés. Pour de nombreux observateurs, bien que la loi ait tranché en faveur des parents, la question de l’intérêt supérieur de l’enfant à naître reste primordiale. Ce débat pourrait inciter l’Inde à légiférer plus précisément sur la question de la reproduction posthume, à l’instar de nombreux pays qui tentent de trouver un équilibre entre le respect des volontés des défunts et les droits des parents et futurs enfants.
En attendant, Harbir Kaur et Gurvinder Singh se préparent à accueillir ce petit-enfant, qu’ils considèrent comme un cadeau précieux qui leur permettra de garder vivante la mémoire de leur fils.