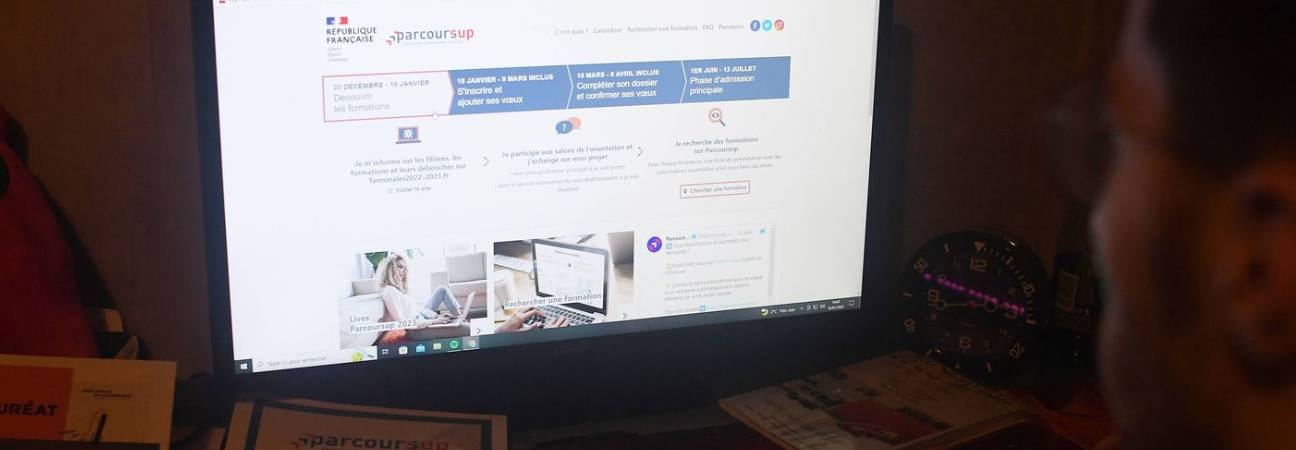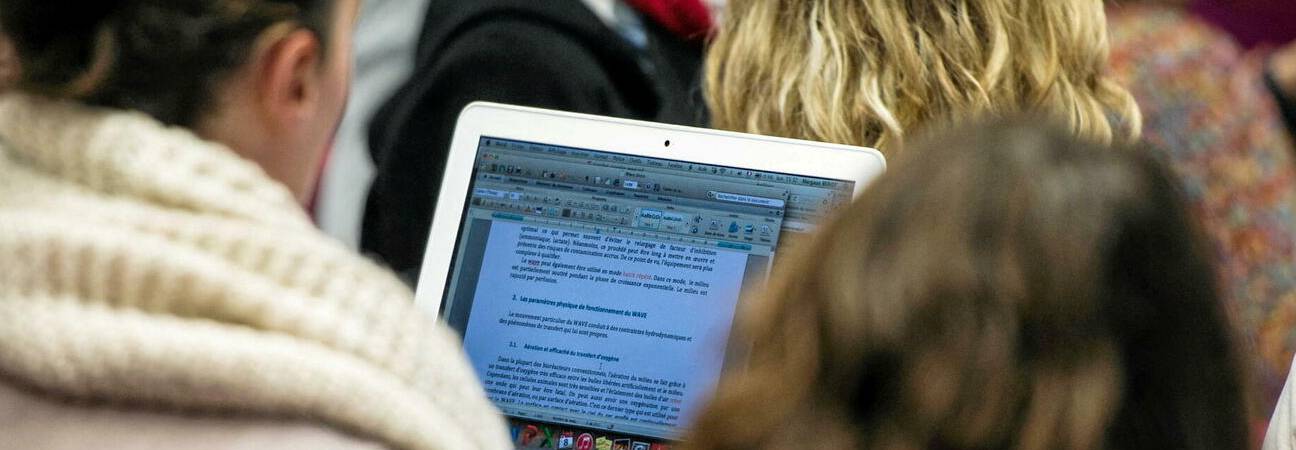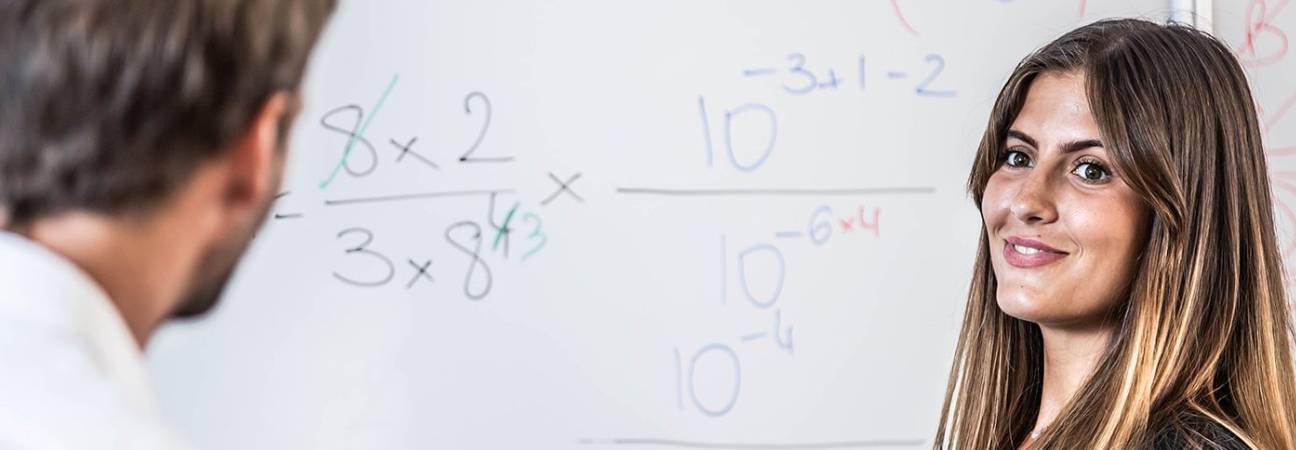Un chemin spirituel, mais aussi hiérarchique
Être prêtre, la première étape indispensable
On ne devient pas pape du jour au lendemain. Tout commence par le sacerdoce. Le futur souverain pontife doit être prêtre, c’est-à-dire ordonné après plusieurs années de séminaire. Cette formation comprend généralement :
- des études de philosophie
- des cours de théologie
- une formation pastorale
Il est aussi très fréquent que le futur prêtre poursuive ses études jusqu’à obtenir une licence canonique ou un doctorat en théologie.
Devenir évêque, une fonction clé
Un prêtre qui se distingue par son engagement, ses compétences pastorales ou sa contribution intellectuelle peut être nommé évêque. Un évêque dirige un diocèse, une région ecclésiastique qui regroupe plusieurs paroisses. Il est responsable de l’enseignement, de la célébration des sacrements et de la vie chrétienne sur ce territoire.
L’archevêque : l’étape supérieure
Certains évêques deviennent archevêques. Ils dirigent des archidiocèses, souvent plus grands et plus importants. Cette fonction implique une dimension plus politique et symbolique au sein de l’Église. Elle est souvent un tremplin vers une fonction encore plus haute : celle de cardinal.
Être cardinal : la dernière marche avant le trône pontifical
Le cardinalat n’est pas un ordre sacré, mais une dignité. Le pape lui-même choisit les cardinaux parmi les évêques. Les cardinaux forment un collège chargé de conseiller le pape, et surtout, d’élire son successeur. C’est parmi eux que le futur pape est choisi. En général, un cardinal est :
- un évêque ou un archevêque
- responsable d’un grand diocèse ou d’une fonction importante au Vatican
Lorsqu’un pape meurt ou démissionne, le collège des cardinaux se réunit à Rome. C’est ce qu’on appelle le conclave.
Le conclave : un vote sous clé
Le mot conclave vient du latin cum clave : « sous clé ». Ce terme désigne le huis clos dans lequel les cardinaux sont enfermés pendant l’élection du pape. Ils vivent alors entre la chapelle Sixtine pour les votes et la résidence Sainte-Marthe pour dormir. Aucun contact avec l’extérieur n’est autorisé : pas de téléphone, pas de journaux, pas d’Internet.
Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent voter. Ils sont en général entre 100 et 140. L’un d’entre eux est élu pape s’il obtient au moins deux tiers des voix. Si ce seuil n’est pas atteint, de nouveaux tours sont organisés, jusqu’à l’élection.
Chaque cardinal inscrit le nom de son candidat sur un papier et vient le déposer dans une urne placée sur l’autel de la chapelle Sixtine. Le dépouillement est ensuite effectué à huis clos. Après chaque vote :
- une fumée noire indique qu’aucun pape n’a été élu
- une fumée blanche signale l’élection d’un nouveau pape
Le cardinal élu doit donner son accord. Il choisit alors un nom de pape, en hommage à un saint ou à un prédécesseur. Ensuite, les cloches sonnent et le cardinal doyen annonce : « Habemus Papam ».
Qui peut devenir pape ?
En théorie, tout homme baptisé catholique peut être élu pape. Mais en pratique, l’élu est toujours un cardinal. Pour être pressenti, il faut être ce qu’on appelle un papabile : un cardinal influent, respecté, parfois déjà mentionné dans la presse. On évalue ses positions, son parcours, son profil spirituel, diplomatique ou intellectuel.
Les critères que les cardinaux prennent en compte :
- la fidélité à la doctrine de l’Église
- l’ouverture aux défis contemporains : climat, inégalités, paix
- la capacité à rassembler : charisme, multilinguisme, vision globale
Exemples de parcours : François, Benoît XVI, Jean-Paul II
Le pape François
Jorge Mario Bergoglio est né en Argentine. Avant d’entrer au séminaire, il étudie la chimie. Il devient prêtre en 1969, évêque en 1992, archevêque de Buenos Aires en 1998, puis cardinal en 2001. Il est élu pape en 2013. Il parle notamment l’espagnol, l’italien, le français, l’allemand et le portugais.
Le pape Benoît XVI
Joseph Ratzinger est né en Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, il étudie la philosophie et la théologie. Il obtient un doctorat sur saint Augustin en 1953. Professeur reconnu, il est nommé archevêque de Munich en 1977, puis cardinal. Il est élu pape en 2005. Il maîtrise six langues, dont l’allemand, le français et l’anglais.
Le pape Jean-Paul II
Karol Wojtyła, d’origine polonaise, commence par des études de lettres. Pendant la guerre, il travaille en usine tout en poursuivant secrètement le théâtre et la philosophie. Ordonné prêtre en 1946, il obtient un doctorat sur saint Jean de la Croix, puis un second sur Max Scheler. Il devient évêque en 1958, cardinal en 1967, et pape en 1978. Il parlait plus de dix langues.
Quel est le rôle du pape aujourd’hui ?
Le pape est à la fois chef spirituel de plus d’un milliard de catholiques, évêque de Rome et chef d’État du Vatican. Il nomme les évêques, convoque les synodes, prend des positions publiques sur les grandes crises. Il vit au Vatican, dans le Palais apostolique ou la résidence Sainte-Marthe.
Ses missions :
- unité doctrinale
- représentation de l’Église dans le monde
- dialogue avec les autres religions
Ses privilèges :
Le pape ne perçoit pas de salaire. Mais il bénéficie d’un logement, d’un entourage dédié et d’une influence immense. Il peut voyager, recevoir des chefs d’État, ou écrire des encycliques. À sa mort, un nouveau conclave est convoqué. Et tout recommence.